Dossier : Quel avenir de la zone Euro ?

Quel avenir en Europe ?
Le Député Sylvain Waserman a sollicité l’équipe ERMEES afin de produire une analyse sur l’avenir de la zone Euro. En effet, étant chargé de rédiger un rapport sur ce sujet, il a souhaité également intégrer une approche économique. ERMEES a alors répondu à cette demande en analysant les limites actuelles que connait la zone Euro, sur les plans des convergences réelle et sociale, les questions monétaires et financières, les enjeux budgétaires ainsi que les questions relatives au marché du travail.
Convergence
Convergence en zone €
De quelle convergence parlons-nous ?
La stratégie initiée depuis le Pacte de Stabilité et de Croissance (PSC) a été une promotion de la convergence nominale (taux d’intérêt, inflation, déficit, dette) : les états membres de l’UE doivent mener des politiques macroéconomiques « saines » afin d’éviter les déséquilibres macroéconomiques. Cette approche a été renforcée après la Grande Récession de 2008-2009 avec la création du Semestre Européen (2011). Dernièrement, le « Rapport des 5 présidents » (2015) va également en ce sens en mettant en avant la création d’un système d’autorités nationales de la compétitivité de la zone Euro, un renforcement des procédures concernant les déséquilibres macroéconomiques et un nouveau renforcement du Semestre européen. Toujours dans cette optique, l’UE connait un début de convergence fiscale avec le seuil minimal de TVA fixé à 15%, et l’évocation d’un rapprochement des taux d’IS entre la France et l’Allemagne (2018).
Cette stratégie devait aboutir à la « Convergence réelle » : En clair, les autorités européennes ont misé sur le fait que si tous les pays membres de l’UE menaient ces politiques macroéconomiques « saines », les performances de croissance seraient convergentes, ce qui mènerait vers l’homogénéisation des niveaux de PIB/hab. Cette homogénéisation des niveaux de vie mènerait ensuite à une convergence vers le haut des politiques sociales dans l’esprit de la déclaration du sommet de Goteborg (2017) sur « l’European Pillar of Social Rights (EPSR) », ce qui rendrait ensuite possible une homogénéisation des politiques sociales possible (Salaire minimum européen, …).
Dans cet article, nous allons faire un rapide état des lieux de ce processus de convergence réelle en Zone Euro (Z€) (première partie). Nous allons ensuite rappeler les politiques européennes déjà existantes en soutien de cette convergence réelle (seconde partie). Nous allons enfin établir quelques propositions pour le soutien de la convergence réelle en Z€ (troisième partie).
Etat des lieux de la convergence réelle en zone €
Comment évolue la convergence réelle en Z€ ?
Depuis 2008, on assiste à un décrochage des économies du Sud de la Z€. Ainsi, le Pib/hab grec correspondait à 85% de celui de la zone Euro en 2008, cette valeur est de 63% en 2017. Pour l’Italie, la baisse est de 5 points (97% à 92%), 6 points pour l’Espagne (93% à 87%). A l’inverse, le PIB/hab allemand a gagné 9 points (107% à 116%), la France est restée à un niveau stable légèrement inférieur à 100%. Le Graphique 1 explicite ces faits. [1]
Les théoriciens de la croissance économiques mettent en évidence 3 sources de croissance :
- L’augmentation du facteur de production travail (nombre d’individus avec un emploi).
- L’augmentation du facteur de production capital (outils, machines, …).
- Le progrès technique (innovations permettant d’augmenter la productivité de ces deux facteurs).
La démographie européenne étant déclinante, la croissance économique de la Z€ est principalement conduite par le progrès technique et l’augmentation du capital, et ces deux variables dépendent largement du niveau d’investissement réalisé. Or, comme le montre le graphique 2, depuis 2008, le niveau d’investissement de la Z€ a reculé de quelques 2.5 points de pourcentage. Cette baisse est cependant beaucoup plus marquée pour les pays d’Europe du Sud : -4.6 points en Italie, -6.2 points au Portugal, -8.7 points en Espagne et -11.2 points en Grèce. Dans le même temps, ce dernier est resté stable en Allemagne et a reflué de quelque 1 point en France.

source : Eurostat
Ce reflux significatif en Europe du Sud a des implications négatives sur le niveau de croissance de long terme. Le processus de convergence réelle semble donc être compromis à moyen et long terme étant donné que les économies du Sud réduisent leur potentiel de croissance comparativement aux économies du Nord. Les estimations de croissance pour 2019 et 2020 montrent d’ailleurs qu’en dépit des 2 récessions survenues en 2008-2009 et 2012-2013, l’effet de rebond qui devrait bénéficier aux économies du Sud est modeste. L’Italie est même en deçà du niveau moyen de la zone Euro pour les deux années à venir.
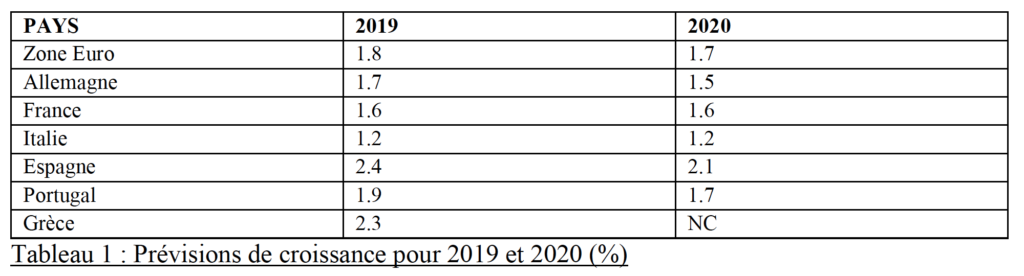
Sources : Chiffres Zone Euro (BCE (2018)), Chiffres Allemagne (Bundesbank (2018)), Chiffres France (BdF (2018)), Chiffres Italie (BoI (2018)), Chiffres Espagne (BoS (2018)), Chiffres Portugal (BoP (2018)), Chiffres Grèce (BoG (2018)).
Quelles sont les conséquences de la panne de la convergence réelle ?
- Menaces sur la stabilité économique de la Z€: la baisse du niveau de croissance ralentit le processus de désendettement, ce qui rend fragile la stabilité budgétaire de la Z€ au vu du niveau d’endettement public des économies du Sud, notamment ceux de la Grèce (178.6% du PIB en 2017), l’Italie (131.8%), du Portugal (125.7%), de l’Espagne (98.3%).[2]
- Menaces sur la stabilité politique de la Z€ : Le maintien d’une contrainte budgétaire forte prolonge les politiques d’austérité héritées de la crise de la Z€ de 2011-2013, et la dégradation de la situation sociale (marché du travail notamment) sont sources d’instabilité politique avec la montée des partis eurosceptiques.
- Panne durable de l’harmonisation sociale (impossibilité d’un SMIC européen, …).
Politiques de l’UE existantes en soutien à la convergence réelle
Les fonds européens structurels et d’investissement (FESI)
L’Espagne, le Portugal ou la Grèce sont des gagnants de la politique régionale européenne. Ceci peut être illustré par un solde net positif de leurs contributions au budget européen :
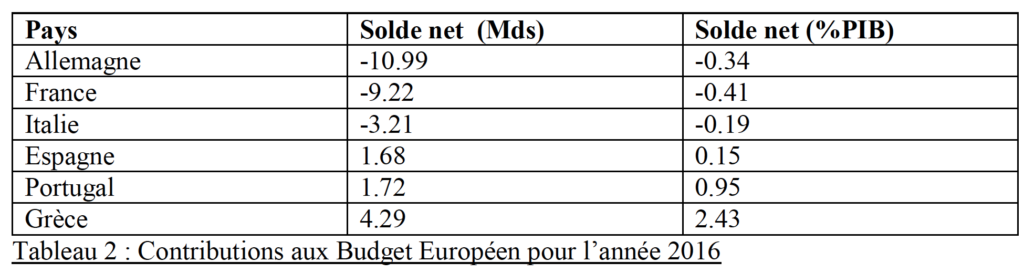
L’Italie est quant à elle un contributeur net, mais dans une bien moindre mesure que la France ou l’Allemagne. Cette situation peut d’ailleurs évoluer pour le prochain cadre financier pluriannuel (2021-2027) dans la mesure où le PIB/hab italien est désormais bien en deçà de celui de la moyenne de l’UE.
Les plus grands gagnants de la politique régionale sont la Pologne et la Roumanie, avec des soldes nets de respectivement 6.98 Mds (1.71% du PIB) et de 5.97 Mds (3.62% du PIB), notamment grâce à des transferts budgétaires importants liés aux FESI.
Ces FESI représentent environ 34% du budget européen pour la période 2014-2020. Ils constituent des investissements en capital physique et humain, ce qui permet d’augmenter le potentiel de croissance économique des pays receveurs.
Globalement, la littérature économique met en avant un effet conditionnel des FESI sur la croissance. Par exemple, les FESI augmentent de manière plus importante la croissance d’un pays si ce dernier a des institutions de bonne qualité (pas de corruption, faible bureaucratie,), un niveau de dette publique faible, … Il est à noter aussi que beaucoup d’études d’impact des FESI sur la croissance sont conduites à l’échelle régionale, plutôt qu’à l’échelle nationale.

Source : Commission européenne.
Plan Juncker (2015) : Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (FEIS)
Pour faire face à la baisse significative du taux d’investissement en UE et en Z€, la Commission Européenne a lancé le FEIS en 2015. L’UE et la BEI apportent des garanties pour des projets d’investissements (16+5 Mds). Un effet levier est ainsi escompté via des financements provenant d’acteurs privés (*15). Le montant total d’investissements générés se situeraient donc à 315 Mds d’euros pour mi-2018, l’objectif est de 500 Mds pour 2020.
Les premiers bilans ont montré, que relativement à leur PIB, les pays d’Europe du Sud sont parmi les plus grands bénéficiaires de ce plan : la Grèce (#1), le Portugal (#3), l’Espagne (#7) ou encore l’Italie (#10). Le FEIS a globalement participé au financement de grands projets dans le secteur de l’énergie (21% du total), de la R&D (21%), du numérique (11%) et a apporté un soutien aux PME innovantes (31%). En d’autres termes, ce fonds a soutenu la création de capital et le progrès technique, soient les deux moteurs de croissance principaux de la Z€ et de l’UE. En étant orienté vers les économies périphériques, le FEIS participe à favoriser l’investissement dans les pays ayant subi les plus fortes chutes des taux de FBCF depuis 2008.
Proposition de soutien à la convergence réelle en zone €
Dans le cas où elle est réalisée, la proposition d’une Europe à 2 vitesses pourrait notamment aboutir à la création d’un budget propre à la zone Euro (Déclaration de Meiseberg du 19/06/2018).
Nous avons vu que la chute de niveau de croissance en Europe du Sud ralentit considérablement le processus de désendettement, participe à la montée des partis eurosceptiques et aboutit à un phénomène de divergence des PIB/hab. Nous soutenons donc ici, qu’en plus d’une fonction macroéconomique stabilisatrice de court terme de type « Assurance chômage européenne », le Budget de la zone Euro doit aussi soutenir le processus de convergence réelle dans une optique de moyen-long terme. Une partie du budget de la Z€, acyclique, pourrait donc permettre d’augmenter le niveau d’investissement des états périphériques afin de dynamiser la productivité et la croissance potentielle des pays périphériques pour soutenir la convergence réelle. (Point explicitement mentionné dans le Compte Rendu de Philippe Martin).
« A euro area budget could ensure broader objectives, covering both convergence and stabilisation, and would need a stable revenue steam » p.26 du Rapport de la Commission Européenne sur la Zone Euro, 2017.
Quels types de soutien à la convergence réelle peuvent être mis en place ?
Dans la continuité des FESI, une part du budget peut être allouée pour financer des projets d’investissements dans les états périphériques de la zone Euro. L’idée est donc ici de renforcer la politique régionale européenne. (Option privilégiée dans le CR de Jérôme Créel). Mais la contrainte politique semble forte : l’Allemagne, plus grand contributeur au budget européen, est opposée à cette approche. Ce projet est aussi rejeté dans le « Rapport des 5 Présidents » : « En effet, dans une union monétaire telle que l’UEM, il n’est pas prévu de transferts budgétaires de grande ampleur entre les membres », chapitre 2.)
Une deuxième option est l’« European Investment Protection Scheme » qui permettrait d’assurer un niveau d’investissement public minimal de 2% du PIB pour la zone Euro. Il s’agit d’une solution hybride entre le soutien à la convergence réelle dans le long terme et la fonction macroéconomique stabilisatrice de court terme. En effet, durant les récessions, le niveau d’investissement public pourrait être préservé, ce qui permet de limiter la baisse du PIB. Et à long terme, on assure un soutien à la croissance permanent. Dans l’optique d’un soutien à la convergence réelle, cet outil ne doit pas être appliqué uniformément à tous les pays membres de la Z€. L’idée de seuils différenciés est évoquée (3% en Grèce, 1.5% en Allemagne, …) afin de stimuler plus fortement la croissance dans les pays périphériques. Ce projet irait dans le sens de vouloir développer les infrastructures dans des secteurs à fortes externalités et économie d’échelle dans une optique d’approfondissement du marché unique. Sont notamment évoquées les infrastructures dans le secteur de l’énergie pour le financement de la transition énergétique (« Croissance Durable », Stratégie Europe 2020) et les infrastructures dans le secteur numérique pour accompagner la révolution numérique comme la 5G en Europe, … (« Croissance Intelligente », Stratégie Europe 2020). Mais là encore, cette seconde option pourrait être soumise aux même contraintes politiques que la première.
Une dernière option, moins ambitieuse et ne nécessitant pas forcément une part du futur budget de la zone €, est celle des « Project bonds », évoqués dans le document (Convergence et Zone Euro (2017)) pour financer de grands projets d’infrastructures, prioritairement dans les pays d’Europe périphérique. Ce mécanisme permettrait donc de soutenir le niveau d’investissement de ces économies, et donc leur niveau de croissance. Concrètement, il s’agit d’obligations souscrites par l’ensemble des membres de la zone Euro. Lorsque qu’un investisseur privé souscrirait une obligation « Project bond », son créancier serait cette autorité propre à la zone Euro, ce qui permet de faire disparaître le risque souverain. Cette troisième voie pourrait être la plus réalisable pour les raisons suivantes :
- Que gagnent les pays periphériques ? Cette forme de mutualisation du risque leur est tout de même avantageuse puisqu’elle permet d’éviter de payer des taux d’intérêt trop élevés. Une partie du budget zone Euro pourrait même être allouée au paiement de ces taux d’intérêt afin de financer ces infrastructures « à taux zéro ».
- Que gagnent les pays riches ? Il s’agit ici d’une redistribution en faveur des pays périphériques à moindre coût. Le surplus de croissance généré dans les pays d’Europe périphérique aurait également des effets positifs sur le niveau d’activité des pays riches (« spillover effects »).
L’Europe en panne de convergence réelle
Nous assistons à une panne de la convergence réelle dans la Z€ depuis une dizaine d’année, notamment à cause de la baisse significative des niveaux de croissance en Europe périphérique. Ce phénomène ralentit considérablement le processus de désendettement, participe à la montée des partis eurosceptiques. Les stabilités économique et politique de la Z€ sont donc menacées. La chute de la croissance en Europe du Sud met à mal l’harmonisation des politiques sociales à l’échelle européenne.
Cette convergence doit être relancée et doit passer par un soutien durable à la croissance, prioritairement dans les pays d’Europe périphérique sous forme d’un soutien à l’investissement. Ce soutien peut passer par une allocation du futur budget zone Euro dans l’optique d’un prolongement de la politique de cohésion de l’UE. Mais cette option semble peu réalisable au vu des contraintes politiques des états contributeurs nets. Les mêmes contraintes s’appliqueraient dans le cadre de l’« European Investment Protection Scheme » qui permet pourtant d’allier stabilisation macroéconomique de court terme et soutien à la croissance à long terme.
Une troisième voie, moins ambitieuse, les « Project Bonds » permettrait de soutenir le niveau d’investissement des pays d’Europe périphérique, et donc de rehausser leur niveau de croissance, tout en répondant aux objectifs de la stratégie de croissance de la Commission Européenne. Enfin, il s’agit ici d’une forme de redistribution plus limitée qui permettrait de passer au-delà des contraintes politiques propres aux deux premières options.
Références
- Becker, S.O., P. Egger, and M. von Ehrlich, ‘Going NUTS: The Effect of EU Structural Funds on Regional Performance’, Journal of Public Economics 94(9–10), 2010, pp. 578–90.
- Becker, S.O., P. Egger, and M. von Ehrlich, ‘Absorptive Capacity and the Growth Effects of Regional Transfers: a Regression Discontinuity Design with Heterogeneous Treatment Effects’, University of Warwick CAGE Working Paper No 89, 2012a.
- Becker, S.O., P. Egger, and M. von Ehrlich, ‘Too Much of a Good Thing? On the growth effects of the EU’s regional policy’, European Economic Review 56, 2012b.
- Crescenzi, R, and M. Giua, ‘Spatial discontinuity for the impact assessment of the EU Regional Policy. How does the net impact of the Policy differ across countries?’ Paper presented at the Second EU Cohesion Policy Conference, Riga, 5-6 February, 2015.
- Fratesi, U. and G. Perucca, ‘Territorial capital and the Effectiveness of Cohesion Policy: an Assessment for CEE Regions’, Investigaciones Regionales, 29, 2014.
- Maynou, L. et al., ‘The Impact of Structural and Cohesion Funds on Eurozone Convergence 1990-2010’, Regional Studies, 2014.
- Pellegrini, G. et al., ‘Measuring the Impact of the European Regional Policy on Economic Growth: a Regression Discontinuity Approach’, Papers in Regional Science, Vol. 92, No 1, March 2013
- Rodriguez-Pose, A. and E. Garcilazo, ‘Quality of Government and the Returns of Investment: Examining the Impact of Cohesion Expenditure in European Regions’, OECD Regional Development Working Papers, 12, OECD Publishing, 2013.
- Rodríguez-Pose, A. and K. Novak, ‘Learning processes and economic returns in European Cohesion Policy’, Investigaciones Regionales, 25, 2013, pp. 7-26.
- Tomova, M. et al., ‘EU governance and EU funds – testing the effectiveness of EU funds in a sound macroeconomic framework’, European Commission, DG ECFIN, European Economy, Economic Papers No 510, 2013.
Notes
[1] Cette dynamique peut aussi être illustrée par le décrochage des gains de productivité multifactorielle dans ces économies. Une des raisons couramment invoquée est la spécialisation de ces économies dans les secteurs des services (tourisme, …), qui ont un potentiel de gains de productivité inférieur au secteur industriel.
[2] Nous pouvons noter que les marchés financiers commencent déjà à s’inquiéter de la situation budgétaire italienne avec le relèvement de la prévision de déficit budgétaire à 2.4% du PIB pour 2019, 2020 et 2021.
Convergence sociale dans la zone euro et norme salariale européenne
La convergence sociale est un des sujets majeurs à moyen terme pour l’avenir de la zone euro. Les questions convergence fiscale jouent en effet sur la mobilité des travailleurs, la lutte contre le dumping social et surtout sur l’acceptation par les peuples d’une intégration plus forte si la convergence sociale se fait par le haut. L’un des enjeux à ce sujet est le salaire minimum légalqui au-delà de la mobilité et de l’acceptation permet de jouer sur la consommation et l’harmonisation du coût du travail.
Avec notamment l’instauration d’un salaire minimum par l’Allemagne ou encore les débats liés au détachement des travailleurs, l’instauration d’un salaire minimum au sein de la zone euro est identifié comme l’un des leviers de son développement. Un mécanisme de salaire minimum en Europe aurait une double vertu, économique et sociale, et devrait pouvoir répondre aux deux objectifs de convergence salariale et de lutte contre la pauvreté.
Actuellement
Il est possible de distinguer quatre groupes de pays au sein de la zone euro :
- Tout d’abord ceux qui n’ont pas de de salaire minimum légal car car attachéàla négociation collective : l’Italie, Chypre, l’Autriche, la Finlande
- Ensuiteles pays ayant un salaire minimum relativement faible, allant en 2018[1] de 400 euros par mois pour la Lituanie à 502,6 euros par mois pour la Pologne, Lettonie (430€), Slovaquie (480€) et Estonie (500€).
- Puis les pays ayant un salaire minimum moyen, allant de 676,7€ par mois pour le Portugal à 735,9€ pour l’Espagne, Grèce (683,8€), Malte (747,5€) et Slovénie (842,8€).
- Enfin, les pays ayant un salaire minimum fort, allant de 1497,8€ pour l’Allemagne à 1998,6€ par mois pour le Luxembourg, France (1498,5€), Belgique (1562,6€) et Irlande (1641€).
Cependant ce comparatif ne tient pas compte de la réglementation liée au salaire minimum ni du pouvoir d’achat qu’offre ces montants dans chacun de ces pays. Ainsi, comme le fait remarqué Eurostats[2], les divergences en matière de salaire minimum s’estompent lorsque les salaires minimums des États membres de la zone euro sont comparés en Parité de Pouvoir d’Achat (PPA). La PPA permet de faire des comparaisons internationales en matière de pouvoir d’achat. Cette méthode cherche à estimer le prix d’un panier de biens dans différents pays afin de déterminer le pouvoir d’achat de chaque monnaie. Par extrapolation, il est possible de déterminer le pouvoir d’achat d’un euro dans chaque pays de la zone euro. Dans ce cas-là, l’écart entre le salaire minimum le plus faible et le plus élevé passe de 1 : 5 à 1 : 2,64[3].
Une autre manière de prendre en compte les différences structurelles de chaque pays de la zone euro est de comparer la part du salaire médian que représente le salaire minimum de chaque pays. Le salaire est généralement préféré au salaire moyen car il permet de mieux prendre en compte les inégalités d’une économie. De ce point de vue-ci, l’Estonie est le pays ayant le salaire minimum le plus faible de la zone euro, puisque le salaire minimum estonien représente moins de 40% du salaire médian de l’Estonie. A l’inverse, la Slovénie, le Portugal et la France sont les trois pays avec le salaire minimum le plus important qu’il représente plus de 60% du salaire médian de chaque économie. Le Luxembourg ne présente alors plus qu’un salaire minimum inférieur à 60% de son salaire médian. Néanmoins, si une fois encore les divergences sont moindres de ce point de vue-ci, trois catégories de pays sont toujours identifiables : les pays ayant un salaire minimum proche de 40 de leur salaire médian ; les pays ayant un salaire minimum proche de 50% de leur salaire médian ; et les pays ayant un salaire moyen proche de 60% de leur salaire médian[4].
Théorie économique
Le déploiement d’un salaire minimum au sein de la zone euro permettrait de garantirun niveau de salaire permettant à chaque travailleur de vivre décemment de son travail. S’oppose à cela le risque de réduire la compétitivité prix du pays et donc la capacité des entreprises domestiques à exporter. Il en résulte une situation sous-optimale où, sans aller jusqu’à parler de dumping social, les États peuvent être tenté par une réduction du salaire minimum afin d’accroitre à moindre frais la compétitivité prix de leurs entreprises domestiques.
Cependant, étant donné qu’une grande partie du commerce extérieur des pays de la zone euro se fait au sein de la zone euro, cet argument n’est plus valable si l’ensemble des pays de la zone euro adopte un salaire minimum[5]. Les coûts en termes de compétitivités prix seront moindres si l’ensemble de la zone euro réalisent conjointement des avancées sociales que si un seul pays cherchait à les réaliser unilatéralement. A l’inverse, un pays refusant alors de réaliser ces avancés sociales pourrait alors être taxé de mener une politique économique non coopérative.
La seconde raison est que si le salaire minimum a des effets opposés sur l’emploi, à la fois d’un point de vue empirique et théorique, ses effets sur la production et sur la demande agrégée semblent plus consensuels. En effet, selon les théories néo-classiques, le salaire minimum, en augmentant le coût pour les entreprises, désincitent ces dernières à créer de nouveaux emplois. Ce faisant, un chômage dit volontaire apparaitrait. Pour ces économistes, le salaire minimum n’est bénéfique que lorsque le marché du travail est en situation de monopsone ou s’en rapproche, c’est-à-dire lorsque le peu d’entreprises présentes sur un secteur ont un pouvoir de marché leur permettant de fixer un salaire en deçà du niveau permettant le plein emploi. En dehors de cette situation, le salaire minimum est, pour ces économistes, un frein à l’emploi et à l’activité. Les théories plus récentes du marché du travail tendent à confirmer cette vision. En effet, les modèles de search and matchingmontrent que le salaire minimum a tendance à désinciter les entreprises à créer de nouveaux emplois et demander aux travailleurs d’être plus productifs encore pour compenser l’augmentation du coût du travail.
Néanmoins si certaines études tendent à montrer que le salaire minimum réduit le niveau de l’emploi, d’autres tendent à montrer le contraire. Doucouliagos and Stanley (2009)[6]ont cependant réalisé une synthèse d’un grand nombre d’articles académiques et concluent de la manière suivante : plus les études sont précises et plus l’effet constaté du salaire minimum sur l’emploi est nul. Wolfson et Belman (2014)[7]ont également réalisé une large revue de la littérature empirique sur ce thème et parviennent à la même conclusion : les effets négatifs du salaire minimum sur l’emploi sont trop faibles pour être statistiquement significatifs. Ainsi, le salaire minimum permettrait aux travailleurs d’être mieux rémunérés sans pour autant que cela soit un frein à l’emploi.
Propositions
Les modèles économiques récents étudiant les cycles économiques, les modèles d’Équilibre Général Dynamique et Stochastique, montrent que le salaire minimum, même s’il a un effet négatif sur l’activité économique en augmentant le coût de production des entreprises, permet aux ménages de moins réduire leur niveau de consommation en période de croissance, puisque leur revenu du travail ne peut pas descendre en deçà d’un certain niveau. Cette pression positive sur la consommation des ménages, et donc sur l’activité, est d’autant plus précieuse pour la zone euro en cas de chocs asymétriques. Cela est d’autant plus vrai que le salaire minimum concerne par définition des ménages avec des revenus relativement faible et dont la propension marginale à consommer est élevée. Par ailleurs, l’instauration généralisé d’un salaire minimum permettrait de créer une demande intérieure de la zone euro durable, rendant cette zone moins sensible aux variations de la demande extérieure.
Toutefois, compte tenu des divergences présentées ci-dessus, il n’est pas envisageable ni pertinent de vouloir se fixer comme règle de convergence un niveau de salaire minimum nominal. En effet, soit l’objectif à atteindre est trop faible et l’intérêt même du salaire minimum serait dévoyé, soit l’objectif est trop élevé pour les économies les plus faibles puissent l’atteindre sans déstabiliser leur économie. Brischoux et al. (2014)[8]proposent ainsi de mettre en place une norme salariale minimum. Cette norme consisterait à déterminer un pourcentage du salaire médian (plutôt que du salaire moyen, afin de mieux prendre en compte les inégalités au sein de chaque économie) minimum à atteindre. Cette norme a ainsi l’avantage de prendre en compte les différences structurelles de chaque économie. Elle permet également aux économies les plus faibles de conserver une certaine compétitivité prix, favorisant ainsi la convergence en termes d’activité. Par ailleurs, cela incite les économies les plus fortes à se tourner vers la compétitivité hors prix via la recherche et le développement, davantage sources de croissance. Finalement, en choisissant le pourcentage exact à atteindre, cette norme forcera les pays de la zone euro à ouvrir plus largement le débat sur la question sociale au sein de l’UE.
Attention cependant un salaire minimum au sein de la zone euro ne peut être mis en place que si un budget est créé pour la zone. En effet, la politique monétaire relevant de la BCE, les pays ont perdu la capacité de réaliser des dévaluations compétitives, certains pays de la zone euro, pour redresser leurs économies après la crise, ont eu recours à une dévaluation par les salaires pour regagner en compétitivité[9]. S’ils sont privés de ce levier et du levier monétaire les États touchés par un choc asymétrique auront besoin d’un budget de la zone euro pour compenser le choc.
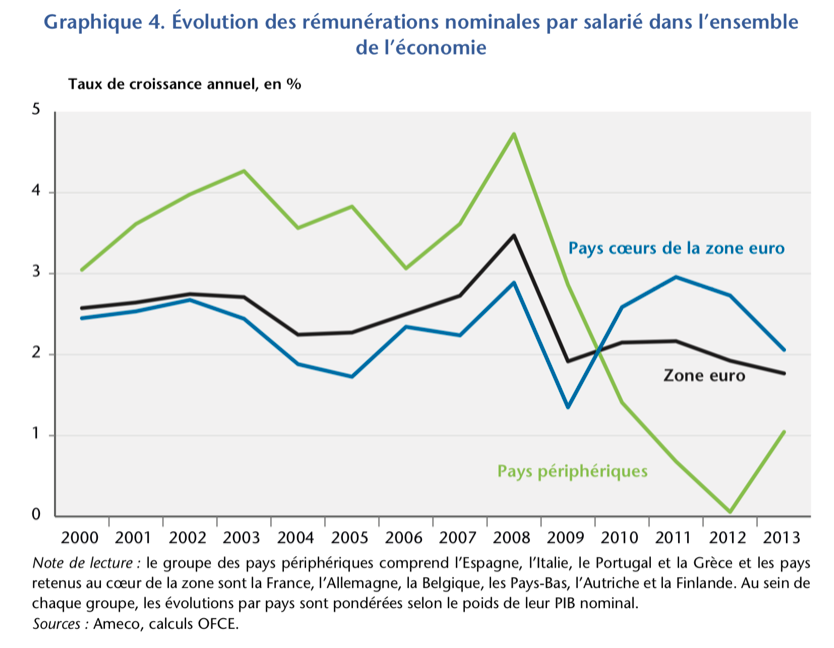
Notes
[1]Voir « Industrial relations – Statutory minimum wages 2018 », Eurofound, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2018
[2]Voir http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Minimum_wage_statistics#Minimum_wages_expressed_in_purchasing_power_standards, EuroStat, Février 2018
[3]Voir «http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do, Eurostat, 31 janvier 2018 : Belgique – 1 493, 89€ ; Allemagne – 1 450, 31€ ; Estonie – 664, 02€ ; Irlande – 1 304, 57€ ; Grèce – 813, 41€ ; Espagne – 938, 11€ ; France – 1 388, 68 ; Letonnie – 604, 270€ ; Lituanie – 636, 430€ ; Luxembourg – 1 597, 17€ ; Malte – 911, 45€ ; Pologne – 897,52€ ; Portugal – 787, 83€ ; Slovenie – 1 005, 60€ ; Slovaquie- 705, 88€.
[4]Voir http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Minimum_wages_as_a_proportion_of_median_gross_earnings,_2014_(%25).png, Eurostat, 2014
[5]À titre d’exemple, les pays de l’ensemble de l’UE réalisent 78% d’exportations de plus vers l’UE que vers les autres pays du monde. Voir http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods/fr#Commerce_de_biens_intra-UE.
[6]Voir Hristos Doucouliagos et T.D. Stanley, “Publication Selection Bias in Minimum-Wage Research?” British
Journal of Industrial Relations (2009), vol, 47. no. 2, pp. 406-428.
[7]Voir Paul Wolfson et Dale Belman, “What Does the Minimum Wage Do?” Kalamazoo, MI: Upjohn Institute for Employment Research, 2014.
[8]Voir Brischoux, Gouardo, Jaubertie, Lissot, Lellouch, Sode, “Pistes pour l’instauration d’une norme de salaire minimum européenne », Trésor Eco, 2014
[9] https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/documents/prev/prev1014/es3291014.pdf
Monnaie
Modifier la mission de la BCE et envisager une union bancaire plutôt qu’une union budgétaire ?
Les leçons de la crise financière pour la politique monétaire
Faut-il revoir, pour l’élargir, le mandat des banques centrales?
Jusqu’à une période récente, la mission des banques centrales contemporaines portait essentiellement sur la stabilité des prix à travers la stabilisation des taux d’intérêt à court terme (de un jour à quelques semaines), soit par des opérations d’achat de titres auprès des banques, soit par des opérations de repo (contrat par lequel un investisseur institutionnel ou une entreprise peut échanger, pour une durée déterminée, ses liquidités contre des titres financiers), tandis que les marchés financiers se chargeaient de fixer les prix des autres actifs (obligations publiques de maturité plus longue, actions, obligations d’entreprises).
Mais les initiatives prises par les grandes banques centrales depuis le début de la dernière crise financière conduisent à s’interroger sur la nature de leur mission.
Une modification significative des politiques monétaires est-elle opportune et pertinente, non seulement pour faire face à une situation exceptionnelle en temps de crise, mais pour mieux jouer leur rôle afin de contribuer à favoriser la croissance d’une économie globalisée qui a fondamentalement changé depuis vingt ans?
Il s’agit là d’un débat complexe, car les politiques monétaires récemment mises en oeuvre présentent des risques, mais aussi des avantages.
Depuis le début de la crise de 2007, les banques centrales ont sensiblement élargi leur champ d’action en volant au secours du système bancaire.
Cependant, à l’occasion de cette crise, on a pu voir émerger successivement les trois rôles possibles des banques centrales vis-à-vis des banques et des marchés financiers :
- le rôle traditionnel de « prêteur en dernier ressort» qui consiste à restaurer, lorsque c’est nécessaire, la liquidité des banques ;
- le rôle d’assureur de la stabilité financière en évitant les paniques bancaires à travers leur action de prêteur en dernier ressort sur laquelle nous reviendrons ;
- le rôle de superviseur et organisateur des activités des banques. Cette responsabilité est fréquemment conduite à travers des institutions spécialisées plus ou moins indépendantes de la banque centrale.
La Banque Centrale Européenne en tant que préteur en dernier ressort ?
La théorie du « prêteur en dernier ressort » est ancienne. Les premiers principes ont été énoncés en 1873 à la suite de l’ouvrage de Walter Bagehot intitulé Lombard Street. Celui-ci considère que l’action de prêteur en dernier ressort est l’essence de l’art de la banque centrale.
En effet, la fonction de prêteur en dernier ressort implique que la BCE doit injecter dans le marché monétaire autant de liquidités que nécessaire pour permettre son bon fonctionnement. Rappelons que la liquidité est ici interprétée comme la monnaie émise par la banque centrale.
Cependant, une telle intervention de la BCE est justifiée par le fait qu’elle assure un bon fonctionnement du marché. Dans cette perspective, le « prêteur en dernier ressort » est une assurance collective qui prend appui sur le pouvoir discrétionnaire de la banque centrale. Ce pouvoir discrétionnaire réside dans sa capacité à créer de manière illimitée de la monnaie centrale afin de répondre à la menace d’effondrement du système bancaire suite à une crise.
La BCE doit cependant faire face au « phénomène d’aléa moral » engendré par son intervention. En effet, si les agents savent que la banque centrale interviendra pour aider le marché, ils peuvent être incités à prendre plus de risques. Dans cette perspective, un certain nombre de principes directeurs guident l’action de la banque centrale. Tout d’abord, le prêteur en dernier ressort doit répondre à un souci de stabilité du système bancaire dans son ensemble et non de santé d’une banque en particulier.
On doit ici en déduire la distinction entre les situations d’ « illiquidité » et d’ « insolvabilité ». Seules les banques illiquides doivent faire l’objet d’une intervention de la banque centrale. Les banques insolvables doivent faire faillite puisqu’en situation structurellement défavorables.
Les premières peuvent continuer à faire face à leurs engagements sous réserve qu’elles puissent faire face à la crise de liquidité qui, temporairement, les empêche de fonctionner correctement. Les secondes ont un bilan tellement dégradé que l’action du prêteur en dernier ressort ne ferait que retarder leur disparition, ce qui pourrait alors nuire aux ajustements nécessaires au sein du système bancaire.
Pour cela, le « prêteur en dernier ressort » doit exiger des collatéraux calculés à partir de la valeur des actifs avant la crise pour éviter qu’une institution insolvable bénéficie de son intervention.
En outre, il doit prêter à des taux pénalisants afin d’empêcher les institutions non touchées par une crise de liquidité de bénéficier indirectement de prêts avantageux.
Ensuite, le prêteur en dernier ressort doit manier avec soin ce que l’on appelle «l’ambiguïté constructive». Cela signifie que les autorités monétaires doivent en permanence laisser planer le doute sur leur intervention afin d’inciter les acteurs du marché financier à se comporter selon des principes de saine gestion. Autrement dit, le prêteur en dernier ressort ne supporte pas l’automatisme, c’est-à-dire « la règle », notion fondamentale dans la littérature en faveur de la crédibilité de la banque centrale sur laquelle a été fondé l’édifice de la Banque Centrale Européenne.
Cependant, personne ne s’émeut de voir les banques centrales jouer le rôle de prêteuses en dernier ressort. Partout dans le monde, les autorités monétaires ont retenu la leçon des épisodes de la grande crise de 1929 aux États-Unis ou des années 1990 au Japon quand le refus des banques centrales d’injecter suffisamment de liquidités avait déclenché les crises bancaires.
La seule inquiétude sur ce point porte sur la « stratégie de sortie» (exit strategy) : à savoir, comment les banques centrales parviendront-elles à détruire l’excès de liquidité lorsque les économies repartiront? Ceci n’est pas un problème technique, mais bien un problème politique qui n’est pas si simple à résoudre: l’expérience passée montre que les autorités monétaires ne parviennent jamais à la détruire à temps.
La stabilité financière doit faire partie des objectifs de la BCE ?
Une question qui est devenue extrêmement importante à la suite de la dernière crise financière est si les banques centrales, comme la BCE, doivent-elles, dans la conduite de leur politique monétaire, prendre en compte comme objectif aussi la stabilité financière ?
Pour répondre à cette question, il faut tenir compte de la doctrine dominante qui prévalait avant la crise financière et qui est fondée sur une démarcation nette entre stabilité des prix et stabilité financière, ce que l’on appelle le « principe de séparation ».
Le principe de séparation
Les difficultés rencontrées par les banques centrales pour faire face à l’inflation élevée des années 1970 a conduit à un changement profond de la manière de concevoir la politique monétaire. On est ainsi passé d’un modèle où les banques centrales étaient dépendantes des autorités politiques et avaient des stratégies non fondées sur des règles où la banque centrale est devenue statutairement indépendante.
Dans ce nouveau modèle, l’objectif premier de la politique monétaire est la stabilité des prix, celle-ci étant définie comme un objectif d’inflation à court ou moyen terme. Cette nouvelle approche s’est accompagnée d’un recul marqué de l’inflation.
Selon cette conception, l’évolution des prix des actifs n’est une préoccupation pour la banque centrale que dans la mesure où elle peut exercer une influence sur l’évolution future des prix à la consommation.
Les implications de cette doctrine dominante sont importantes et au nombre de deux :
D’une part, la banque centrale ne doit pas chercher à prévenir les bulles financières en poursuivant le principe d’y «aller contre le vent» (leaning against the wind), mais seulement corriger les effets sur l’activité de son éclatement en menant des politiques expansionnistes.
D’autre part, il existe une séparation nette entre les fonctions liées à la stabilité monétaire et celles liées à la stabilité financière. La première relève de la banque centrale à travers son objectif de stabilité des prix. La seconde est du ressort d’institutions en charge des politiques de régulation et de supervision des agents et des marchés financiers.
Le point important est que ces deux fonctions n’ont pas besoin d’être remplies par la même entité institutionnelle, à savoir, par la banque centrale (par exemple, la BCE).
La remise en cause du principe de séparation
Nous venons de constater que la dernière crise financière mondiale a eu un impact significatif sur l’activité économique de nombreux pays. Analysant l’évolution de la doctrine concernant les objectifs des banques centrales après la crise financière mondiale, on peut mettre en avant trois points d’accords entre les experts :
Premièrement, l’idée selon laquelle la stabilité monétaire et la stabilité financière vont de pair a été clairement remise en cause. Cela signifie que, contrairement aux présupposés de la doctrine dominante, assurer la stabilité monétaire (la stabilité des prix) ne garantit pas l’obtention de la stabilité financière.
Deuxièmement, la stratégie visant à intervenir après l’éclatement de la crise financière rencontre d’importantes limites. En effet, la politique de bas taux d’intérêt (des taux qui ont de fait atteint la limite de 0%) est insuffisante pour répondre aux coûts des crises financières et permettre une reprise soutenue de l’activité.
Troisièmement, la réglementation et la surveillance des institutions individuelles (ce que l’on appelle la politique micro-prudentielle) ne sont pas suffisantes pour assurer la stabilité du système financier dans son ensemble. La crise financière a montré la nécessité de développer une politique macro-prudentielle dotée d’outils spécifiques.
En dépit de cette convergence, les débats quant à l’articulation entre stabilité monétaire et stabilité financière ont fait émerger deux principales positions différentes.
La première position repose sur une simple inflexion de la doctrine dominante. Celle-ci est fondée sur trois principaux postulats :
- Tout d’abord, la politique monétaire (à travers le taux d’intérêt à court terme) n’a qu’un effet limité sur le crédit et le comportement de prise de risque des agents économiques.
- Ensuite, les instruments de politique monétaire n’ont qu’un effet limité sur les déséquilibres financiers.
- Enfin, la politique macro-prudentielle est en mesure de mettre en oeuvre des instruments précis et efficaces. Ces derniers étant différents de ceux de la politique monétaire, le principe de séparation demeure pertinent. La dimension amendée de la doctrine dominante réside dans l’idée que politique de stabilité monétaire et politique de stabilité financière devraient faire l’objet d’une coordination.
La deuxième position considère que les banques centrales doivent adopter une politique monétaire du type «leaning against the wind» systématique. Ainsi, la stabilité financière devient le second objectif de la politique monétaire.
Dans la mesure où les cycles financiers ont une durée plus longue que les cycles économiques, cela implique de rallonger l’horizon de référence de la politique monétaire.
Pour répondre à la question si la stabilité financière devrait faire partie des objectifs de la BCE, on doit dire que la crise financière mondiale a montré deux choses très importantes :
- D’une part, la stabilité monétaire n’est pas une condition nécessaire et suffisante pour obtenir la stabilité financière. En fait, comme le suggère la Grande modération, l’accent mis sur la stabilité des prix peut conduire les banques centrales à adopter des politiques excessivement expansionnistes au regard de l’accumulation des déséquilibres financiers.
- D’autre part, les crises financières ont des coûts macroéconomiques très élevés susceptibles de remettre en cause l’efficacité de la politique monétaire. Ce sont ces deux évolutions qui impliquent la prise en compte de la stabilité financière par les banques centrales. Cependant, les bases du principe de séparation demeurent.
Union bancaire versus Union budgétaire dans la zone euro : L’Europe a-t-elle vraiment besoin d’une union budgétaire et politique ou d’une union bancaire?
L’union monétaire exigerait une union politique. Aucune voie intermédiaire n’est possible. Ceci révèle le sentiment grandissant d’une nécessité d’union budgétaire puis politique, si l’euro entend se maintenir sans mettre à mal la performance économique ou les valeurs démocratiques.
Selon Dani Rodrik (Does Europe Really Need Fiscal and Political Union? Project Syndicate, December 11, 2017), il existe néanmoins une alternative, une vision beaucoup moins ambitieuse, dans laquelle l’union budgétaire et politique n’est pas nécessaire. Dans cette conception, il s’agirait davantage de dissocier la finance privée de la finance publique, pour isoler l’une de la malfaisance de l’autre.
Grâce à cette séparation, la finance privée pourrait être pleinement intégrée au niveau européen, tandis que la finance publique relèverait des États membres dans leur individualité. Les États pourraient ainsi profiter de tous les bénéfices de l’intégration financière, tandis que les autorités politiques nationales resteraient libres dans la gestion de leur propre économie. Bruxelles ne serait plus l’épouvantail auquel beaucoup reprochent d’imposer l’austérité budgétaire, et de causer du tort aux pays présentant un taux de chômage élevé ainsi qu’une faible croissance. [6]
Martin Sandbu (du Financial Times) est un fervent partisan de cette conception dans laquelle une union monétaire et financière opérationnelle n’exigerait pas une intégration budgétaire. Il considère en effet que la réforme la plus essentielle consisterait à empêcher les sauvetages de banques par les autorités publiques. Le coût des faillites bancaires serait alors supporté par les propriétaires des banques et par les créanciers : les renflouements deviendraient internes plutôt qu’externes. Pour Martin Sandbu, ceci permettrait non seulement d’isoler la finance publique de la folie des banques, mais produirait également un équilibre équivalent à un partage des risques budgétaires entre les pays emprunteurs nets et les pays prêteurs nets. En cas de faillite des banques chez les emprunteurs, le coût serait supporté par les prêteurs. Alors, on peut affirmer que « avec l’union bancaire, nul besoin d’une union budgétaire ».
Par ailleurs, l’économiste Barry Eichengreen de l’Université de Californie de Berkeley, prône également une renationalisation de la politique budgétaire, qu’il considère essentielle pour endiguer la vague populiste européenne. (Barry Eichengreen : The Populist Temptation: Economic Grievance and Political Reaction in the Modern Era, Oxford University Press, 2018). Barry Eichengreen estime que restituer la politique budgétaire aux autorités nationales exigerait d’empêcher les banques de détenir une dette publique trop importante, afin de minimiser le risque de voir la mauvaise gestion budgétaire bouleverser le système bancaire. Les gouvernements entrant en faillite devraient alors restructurer leur dette, plutôt que de bénéficier d’un sauvetage de la part d’autres États de l’UE.
Ceux qui souhaitent défaire le noeud gordien qui lie la finance privée à la finance publique reconnaissent que l’approche des gouvernements à l’égard des banques devra radicalement changer, si cette séparation entend fonctionner. Nul ne sait néanmoins si les remèdes qu’ils proposent fonctionneront. Tant que la politique économique relèvera de la compétence des gouvernements nationaux, le risque souverain continuera probablement de distendre le fonctionnement de la finance transfrontalière. Les États souverains peuvent toujours modifier les règles a posteriori, ce qui signifie qu’une pleine intégration financière est impossible. En outre, les coûts des chocs financiers locaux ne peuvent être diversifiés aussi facilement.
Références
- Allegret J.-P. : « Le renouvellement de la politique monétaire (II) : quelle place pour la stabilité financière dans les objectifs de la banque centrale ? » (http://ses.ens-lyon.fr/articles/), 2017
- Bénassy-Quéré A., Cœuré B., Jacquet P. et Pisani-Ferry J., Politique économique , Paris-Louvain-la-Neuve, De Boeck Université, 3e édition, 2011.
- Betbèze J.-P., Bordes C., Couppey-Soubeyran J. et Plihon D, « Banques centrales et stabilité financière », Rapport du Conseil d’analyse économique, n° 96, Paris, La Documentation française, 2011.
- Le Héron E., « Les limites des politiques non conventionnelles de la Banque centrale européenne », La Documentation française, 6 juillet 2016.
Les trilemmes de la zone euro : quelles issues possibles ?
“Economists have bigger brains than ordinary mortals. Whereas most people are flummoxed by dilemmas, economists wrestle with trilemmas.” Edward Chancellor, le 6 novembre 2011, Financial Times.
La crise financière globale de 2008 et la double crise bancaire et de la dette souveraine au sein de la zone euro de 2010-2012 ont révélé que les contraintes de la zone euro réduisent considérablement la possibilité des États membres de faire face aux conséquences macroéconomiques des crises financières. Pour sortir de la crise, l’Union économique et monétaire (UEM) européenne a dû renoncer à appliquer strictement certaines de ses règles. Mais cela ne suffit pas. En effet, l’UEM souffre d’un certain nombre de déficiences : les situations disparates en matière de croissance, de déficits et d’endettement publics, et les déséquilibres externes croissants des différents pays membres. Les réflexions récentes des économistes ont montré qu’il existe un certain nombre de trinités impossibles face auxquelles les décideurs politiques doivent faire des réformes afin de réduire le risque de mettre en péril la zone euro[1].
Politique monétaire indépendante, souveraineté budgétaire et clause de non-renflouement
Au sein de l’UEM, la BCE est chargée de mener de façon indépendante la politique monétaire unique pour l’ensemble des pays de la zone euro. L’objectif principal de la BCE est la stabilité des prix dans la zone euro. Elle ne peut soutenir la croissance que si l’inflation moyenne de la zone euro est maîtrisée. Étant donnée l’hétérogénéité des économies des pays membres, cette politique unique pourrait être trop expansionniste pour certains et trop restrictive pour d’autres. En plus, elle ne peut pas être coordonnée avec les politiques budgétaires menées par les gouvernements nationaux de manière souveraine. Toutefois, cette souveraineté budgétaire est limitée par le Pacte de stabilité et de croissance (PSC). A cette dernière s’ajoute la clause de non-renflouement selon laquelle un État membre ne devait pas secourir financièrement un autre alors que la BCE s’interdit de monétiser les dettes des États[2].
Il existe une trinité impossible entre l’indépendance de la BCE, la souveraineté budgétaire et la clause de non renflouement[3]. La clause de non-renflouement vise à supprimer l’aléa moral, car l’assurance de renflouement par l’Union incite un État membre à accroître sa dette souveraine. Un tel comportement détruira tôt ou tard les fondements de l’UEM. Par contre, imposer une telle clause permet en théorie de laisser la souveraineté en matière de politique budgétaire aux États-membres. Cependant, la politique budgétaire a tendance à prendre en otage la politique monétaire si les déficits budgétaires et l’endettement public des États membres ne sont pas limités. Comme la récente crise de la dette souveraine l’a montré, la BCE ne pouvait pas refuser de jouer le rôle du prêteur en dernier ressort auprès des États membres surendettés au risque de faire éclater l’UEM. Cela fait perdre son indépendance. Bien que le PSC et la clause de non-renflouement aient pour objectif de rendre la zone euro stable, le non-respect du premier a pour conséquence que le respect du second augmente le risque de l’éclatement de la zone euro. Brandissant les menaces de sortie de la zone euro, les pays à l’endettement public élevé peuvent faire pression sur l’UEM pour renoncer à la clause de non-renflouement et abandonner l’indépendance de la BCE.
Il convient de noter que réaliser ces trois objectifs simultanément correspond aux trois désirs incompatibles de l’Allemagne qui insiste constamment que la zone euro soit préservée avec un taux d’inflation faible tout en limitant ses contributions aux renflouements des pays membres en crise de la dette souveraine (Chancellor 2011).
Les contradictions soulevées ci-dessus pourraient être atténuées en réduisant les ambitions de chacun des trois objectifs. Par exemple, sur le plan de la politique monétaire, la BCE a été contrainte d’appliquer un « assouplissement quantitatif » en achetant massivement des obligations souveraines dans le but de protéger la zone euro contre les risques de déflation et de son éclatement. Sur le plan financier, le mécanisme européen de stabilité (MES), mis en place durant la crise de la zone euro, apporte une aide financière aux États surendettés fondée sur la stricte conditionnalité et la soutenabilité de la dette. Par ailleurs, en introduisant le Pacte pour l’euro, l’UEM oblige les États membres à améliorer leur compétitivité et leurs finances publiques par des réformes. Enfin, la création de l’union bancaire permet de casser la « boucle diabolique » (diabolic loop) selon la terminologie de Brunnermeier et al. (2011, 2016) entre la crise de la dette souveraine et la crise bancaire au niveau d’un pays membre de l’UEM. Malgré ces réformes, si les Etats membres n’abandonnent pas leur souveraineté budgétaire, il y aurait toujours un risque de crise pour l’UEM à long terme, impliquant que soit l’État membre en difficulté quitte la zone euro, soit des règles strictes applicables aux défaillances souveraines soient promulguées.
Mobilité des capitaux, stabilité financière et flexibilité de la politique budgétaire
Les dynamiques récentes caractérisant l’économie de la zone euro suggèrent l’existence d’un nouveau trilemme politique auquel sont confrontés les pays membres (Obstfeld (2013). Il y a un arbitrage entre la libre circulation des capitaux, la stabilité financière et la flexibilité de la politique budgétaire. Les pays membres ne peuvent pas réaliser pleinement ces trois objectifs simultanément. Ce trilemme s’applique aussi bien à un pays individuel qu’à l’ensemble des pays de l’UEM. Comme dans le trilemme précédent, il existe ici aussi un conflit sous-jacent entre la politique monétaire de la BCE indépendante et la politique budgétaire nationale. Comme les gouvernements partagent la même monnaie, ils sont incités à surutiliser la politique budgétaire, efficace pour stimuler l’économie nationale en cas de chocs négatifs idiosyncratiques. En effet, contrairement à une petite économie ouverte hors de l’UEM, les déséquilibres de la balance des paiements des pays membres de l’UEM surutilisant les instruments budgétaires pourraient être temporairement masqués.
La surutilisation de l’instrument budgétaire pourrait conduire à une crise de surendettement de l’État et éventuellement à une crise bancaire[4]. Pour assurer une discipline budgétaire et favoriser la coordination des politiques, des règles et des institutions ont été créées dans la zone euro. Mais il n’existe pas de mécanismes qui empêchent définitivement les gouvernements nationaux de conduire la politique budgétaire dans une perspective de court terme incompatible avec la stabilité de l’économie nationale et de la zone euro à long terme.
Avant la crise de la zone euro, la BCE accepte de prendre en pension les dettes des pays membres sans distinction de leur risque, ce qui a rendu pendant un moment les opérateurs financiers moins vigilants et a favorisé la convergence des taux d’intérêt des pays membres jusqu’à la grande crise financière globale de 2008. Cette crise ainsi que la crise de la zone euro en 2010-2012 nous rappellent que les marchés financiers apprécient la discipline budgétaire. Lorsque la dette d’un pays atteint un niveau élevé, la liberté d’utiliser les instruments budgétaires pourrait être fortement limitée. Ceci est d’autant plus vrai si les marchés financiers sont en crise, la mobilité des capitaux est forte, le budget de l’Union est faible, et on est en l’absence d’une union bancaire permettant de couper le lien entre la crise bancaire et la crise de la dette souveraine au niveau national.
Les interactions entre les marchés financiers et la politique budgétaire rendent difficile la coexistence de la liberté des flux de capitaux, de la stabilité financière et de l’indépendance budgétaire. Canale et al. (2018) ont montré empiriquement que les pays de la zone euro sont contraints par un tel trilemme, ce qui justifie la mise en œuvre d’une surveillance financière centralisée et des réformes budgétaires et monétaires afin de renforcer l’UEM.
Réformes structurelles pour sauvegarder les systèmes de protection sociale européens
La crise de 2008 et celle de la zone euro de 2010-2012 ont élevé largement le niveau de dette publique dans tous les pays membres de la zone euro. Cette situation a conduit l’UEM à renforcer la discipline budgétaire dans un contexte de croissance lente. Pour certain pays membres, il n’y a guère d’autre choix que de maintenir une politique budgétaire prudente et de mettre en place des mesures de réformes structurelles pour résorber les déséquilibres internes (chômage de masse persistent) et externes (déficits croissants de la balance courante).
Les mesures de réforme structurelles ont comme effet une dépréciation interne, qui se traduit par la dépréciation du capital humain via parfois la baisse des salaires nominaux. Ces mesures soulèvent des troubles sociaux à un moment où le modèle social européen est de plus en plus mis à rudes épreuves. Des régimes de protection sociale ont notamment connu des déficits importants à cause de la faiblesse de la croissance, ce qui induit un effet de ciseaux sur leur situation financière avec une cotisation en baisse et une dépense sociale en hausse. Le processus d’ajustement et de réforme introduit après la crise de la zone euro affecte considérablement la redistribution des revenus, ce qui pose des questions d’équité et implique qu’il est nécessaire de repenser les systèmes de protection sociale européens en conséquence. Toutefois, il est difficile de mettre en œuvre toutes les réformes nécessaires permettant aux pays membres en difficulté de retrouver une croissance vigoureuse ou encore de rendre leurs régimes de protection sociale moins sujets aux déficits chroniques.
Il existe donc une trinité impossible entre la conduite de politiques budgétaires saines, la mise en place de systèmes de protection sociale financièrement soutenables, et la poursuite des réformes structurelles peu ambitieuses qui entraîneront les économies de l’UEM dans un piège de la stagnation séculaire (Buti 2014). Si on veut maintenir la discipline budgétaire sans des réformes structurelles de grande envergure, cela ne se fera qu’au prix d’un démantèlement, ou du moins d’une érosion progressive du modèle social européen, ce qui peut à terme saper la cohésion sociale et l’intégration européenne et est donc difficilement acceptable sur le plan politique. La seule solution pour résoudre ce trilemme est de mener des réformes structurelles ambitieuses centrées sur la compétitivité pour retrouver une croissance forte et durable. Une croissance équilibrée dans les pays membres, indispensable pour la stabilité à long terme de la zone euro, nécessite une accélération des réformes non seulement dans les pays ayant connu des difficultés durant les crises récentes mais aussi dans les pays moins vulnérables mais susceptibles de connaître des difficultés à moyen terme.
Inflation faible, dette publique élevée et faible compétitivité dans les pays vulnérables
Du fait des crises, le taux d’intérêt nominal compatible avec une croissance forte et l’objectif d’inflation de la BCE était largement en-dessous de zéro, ce que la BCE ne peut pas atteindre même si elle peut marginalement descendre le taux d’intérêt directeur à un niveau négatif. Ceci explique pourquoi, la zone euro ne peut pas réaliser une croissance forte et une inflation suffisamment élevée grâce uniquement aux stimulants monétaires conventionnels et non conventionnels.
La zone euro fait face à un défi majeur pour soutenir la croissance et maîtriser les vulnérabilités macroéconomiques. Dans l’après-crise de la zone euro, beaucoup de pays membres ont connu une croissance réelle faible et un taux d’inflation bas, qui résultent en partie d’un réajustement inévitable des bilans du secteur privé afin de tirer les conséquences d’une crise financière aussi importante et pour rendre ces bilans conformes aux nouvelles régulations financières plus strictes. Cette croissance faible devient particulièrement préoccupante lorsque les économies doivent faire face à un surendettement important alors qu’un taux d’inflation faible implique une baisse limitée du taux d’intérêt réel.
En plus, ces pays doivent relever le défi de restaurer la compétitivité et rééquilibrer les comptes extérieurs. Sans retourner à une monnaie nationale, ce défi ne peut être relevé qu’en modifiant les prix relatifs dans la zone euro. Le rétablissement de la compétitivité dans les économies avec déficits courants nécessite une inflation plus élevée et une hausse de salaire nominal plus faibles que dans les pays excédentaires.
Les objectifs de rendre la dette soutenable et de rétablir l’équilibre externe peuvent entrer en conflit tant que l’inflation de la zone euro demeure bien en deçà de l’objectif d’inflation de 2 % de la BCE, qui est un seuil à ne pas franchir et qui est lui-même faible au regard des pratiques des banques centrales dans le monde. Le taux d’inflation moyen faible au niveau de la zone euro peut se traduire par une déflation dans certains pays périphériques vulnérables. Ce biais déflationniste affecterait négativement la dynamique de l’économie et celle de la dette publique dans la périphérie, particulièrement pour les pays très endettés ayant un besoin d’ajustement plus important pour gagner en compétitivité.
Ce conflit entre les objectifs politiques et les réalités économiques constitue une trinité impossible : les pays vulnérables de la zone euro ne peuvent pas réduire simultanément leur fardeau de la dette et gagner en compétitivité dans un environnement où l’inflation moyenne de la zone euro reste faible (Buti 2014). Ou alternativement, il existe un conflit entre la stabilité des prix définie par la BCE, le rééquilibrage dans la zone euro et les évolutions de la compétitivité non-coordonnées (Buti et Turrini 2017).
Ce trilemme appelle la BCE à trouver de nouveaux moyens d’intervention dans un contexte où le taux d’intérêt directeur est déjà négatif pour redresser le taux d’inflation moyen dans la zone euro et pour permettre aux pays périphériques de sortir d’une situation de faible croissance et de déflation. Il appelle aussi les pays qui ne souffrent pas de vulnérabilités à entreprendre des réformes pour stimuler la croissance en faisant augmenter le pouvoir d’achat des salariés, et en soutenant l’investissement public et privé. Cette approche équilibrée de la politique macroéconomique avec un ajustement plus symétrique permet de remédier aux principales vulnérabilités de la zone euro. Cette approche réduit les risques d’instabilité politique dans les pays périphériques qui souffrent ainsi moins des réformes structurelles grâce à un partage des charges d’ajustement.
Conflits entre la surveillance nationale du secteur financier vulnérable et l’absence du prêteur en dernier ressort
Dans la zone euro, le système bancaire national est constitué des banques à la fois fragiles et trop grandes pour qu’un État souverain puisse les soutenir confortablement. L’origine de la crise de la zone euro de 2010-2012 se trouve dans ce qu’on appelle « l’étreinte mortelle » (deadly embrace) selon la terminologie de De Grauwe (2013) entre les banques et leurs Etats souverains.
La zone euro est caractérisée par la fragmentation des systèmes financiers sur le plan réglementaire. Les États membres ont le devoir de surveiller leur propre système bancaire et de secourir les banques en difficulté. Une dette publique élevée peut faire perdre la confiance des opérateurs financiers dans la solvabilité de l’État concerné. Ceci entraîne une hausse du taux d’intérêt sur la dette souveraine. Les banques nationales qui détiennent majoritairement la dette nationale comme réserves de liquidité sont pénalisées et risquent de faire l’objet d’une ruée bancaire. Le sauvetage par l’État de ces banques aggrave la crise de dette publique et donc la crise bancaire.
A cause de ce lien étroit entre la dette publique souveraine et la santé financière du secteur bancaire, les conditions de crédit sont devenues très divergentes dans la zone euro, ce qui entrave la reprise de la croissance et compromet les canaux de transmission monétaire dans les économies les plus vulnérables malgré les mesures de politique monétaire extrêmement accommodantes.
Ce défi politique représente une autre trinité impossible, liée au fait que la stabilité financière et l’intégration des marchés financiers ne peuvent être atteintes que si l’étreinte mortelle entre les banques et les dettes souveraines est rompue (Obstfeld 2013, Buti 2014). Pisani-Ferry (2012) a développé une version modifiée de ce trilemme, en mettant en évidence l’incompatibilité entre une banque centrale qui ne monétise pas les déficits budgétaires, l’absence de coresponsabilité sur les dettes publiques, et un système bancaire surveillé au niveau national et secouru en cas de crise par le gouvernement national.
Modifier le mandat de la BCE en faveur de financement monétaire sans remettre en cause sa crédibilité ne semble pas viable. Une union budgétaire permet de résoudre ce trilemme mais il serait difficile d’atteindre ce niveau d’intégration à l’heure actuelle. Ainsi, ce trilemme suggère que l’objectif de stabilité financière au sein d’un marché financier unique intégré, compétitif et dynamique ne peut être atteint qu’en permettant une plus grande responsabilité mutuelle pour les problèmes du secteur bancaire. C’est le fondement d’une union bancaire avec une surveillance commune, une résolution de crise bancaire unique et un corpus réglementaire unique, qui est développée et mise en place progressivement depuis 2012.
D’autres trinités impossibles
Pour Benczes (2013), la crise de la dette souveraine européenne a clairement indiqué que la conception originale de la gouvernance économique européenne n’est plus viable. La crise a contraint les Européens à admettre que le consentement implicite du Traité de Maastricht est confronté à un triple déni en ce qui concerne l’UEM, à savoir pas de clause de sortie, pas de renflouement des pays membres, et pas de défaut de paiement. Ce triple déni n’est plus tenable suite à la crise de la zone euro et l’un des trois objectifs devrait être sacrifié pour que la monnaie unique survive à la double crise bancaire et de la dette souveraine. Ou encore, les institutions supranationales devraient exercer un plus grand contrôle sur la résolution des crises, ce qui justifie la création de l’Union bancaire européenne.
En considérant le potentiel de la croissance, Villeroy de Galhaus (2017) relève qu’il y a une trinité impossible entre l’objectif pour les pays de la zone euro d’atteindre leur plein potentiel de croissance, celui de maintenir l’autonomie de leurs politiques économiques au niveau national et celui de maintenir inchangé le cadre de coordination de la zone euro. Ce dernier objectif signifie maintenir le statu quo avec une coopération entre pays fondée uniquement sur des règles sans institutions et sans stratégie commune. L’un de ces trois objectifs doit être abandonné pour pouvoir atteindre pleinement les deux autres. Il propose que la zone euro modifie le fonctionnement de sorte qu’il y a trois objectifs compatibles : les réformes structurelles nationales, une union financière pour l’investissement et l’innovation, un policy-mixpour la zone euro fondé sur une meilleure coordination des politiques macroéconomiques.
La zone euro, en tant qu’économie ouverte, souffre aussi du trilemme financier. Selon Schoenmaker (2011, 2013), les trois objectifs, à savoir la stabilité financière, la non-intervention dans les flux financiers transfrontaliers et le contrôle national de la supervision et de la réglementation financière, ne sont pas tous mutuellement compatibles. En effet, d’après Rodrik (2000), au fur et à mesure que l’intégration économique internationale progresse, le pouvoir politique des États nations doit être exercé sur un domaine beaucoup plus étroit et le « fédéralisme » mondial augmentera.
Conclusion
Les différents trilemmes revus ici correspondent à des visions partielles d’un problème complexe qui est de rendre l’UEM stable. C’est une schématisation des différents choix qui se révèlent incompatibles à un moment ou à un autre pour assurer le bon fonctionnement de l’UEM. On constate que les pays membres de l’UEM, pour échapper au triangle d’incompatibilité de Mundell, ont choisi d’entrer dans une zone euro. Face à une mobilité parfaite imposée par l’intégration financière opérée au niveau européen et mondial, beaucoup de pays de l’UE préfèrent un taux de change irrévocablement fixe en adhérant à la zone euro.
L’UEM a privé ces pays membres de la souveraineté monétaire tout en imposant des contraintes institutionnelles et politiques : le Pacte de stabilité et de croissance et la clause de non renflouement ainsi que la responsabilité des États membres dans la surveillance du système bancaire national. Sous ces contraintes, les conflits entre la politique monétaire unique et les politiques budgétaires nationales, qui étaient très actives pour répondre aux conséquences de la crise financière globale de 2008 et aux autres chocs nationaux spécifiques, ont directement conduit à la double crise bancaire et de la dette souveraine de la zone euro de 2010-2012. Les réactions à cette dernière et les propositions de réformes pour résoudre les problèmes de viabilité de la zone euro ont entraîné un certain nombre d’autres conflits qu’on peut formuler également sous forme de trilemmes.
Les différents ajustements, tels que les réformes structurelles, institutionnelles et politiques ou encore des changements de culture politique, nécessaires pour rendre l’UEM viable, devraient être très importants et parfois impossible à réaliser. Sans faire suffisamment de réformes, l’UEM risque d’être confrontée à de nouvelles crises. Pour accompagner ces réformes structurelles, la BCE devrait ne pas mettre l’accent uniquement sur l’objectif de la stabilité des prix, elle doit mieux prendre en compte l’objectif de croissance dans ses décisions en lui attribuant un poids plus important et en relevant son objectif de l’inflation qui est pour l’instant de 0 à 2 % seulement.
Références bibliographiques
- Beck, Hanno, and Aloys Prinz (2012), “The Trilemma of a Monetary Union: Another Impossible Trinity,” Intereconomics, 47(1), 39-43.
- Benczes, István (2013), “The impossible trinity of denial: European economic governance in a conceptual framework,” Transylvanian Review of Administrative Sciences, No. 39 E/2013, 5-21.
- Brunnermeier, M. K., L. Garicano, P. R. Lane, M. Pagano, R. Reis, T. Santos, S. Van Nieuwerburgh, and D. Vayanos (2011), “ESBies: A realistic reform of Europe’s financial architecture,” 25 October, www.voxeu.org.
- Brunnermeier, Markus K., Luis Garicano, Philip R. Lane, Marco Pagano, Ricardo Reis, Tano Santos, David Thesmar, Stijn Van Nieuwerburgh, and Dimitri Vayanos (2016), “Breaking the Sovereign-Bank Diabolic Loop: A Case for ESBies,” American Economic Review, Papers and Proceedings (May), 1-11.
- Buti, Marco (2014), “A consistent trinity for the Eurozone,” Vox CEPR Policy Portal, 8 January.
- Buti, Marco, and Alessandro Turrini (2017), “Overcoming Eurozone wage inertia,” Vox CEPR Policy Portal, 06 October.
- Canale, Rosaria Rita, Paul De Grauwe, Pasquale Foresti, & Oreste Napolitano (2018), “Is there a trade-off between free capital mobility, financial stability and fiscal policy flexibility in the EMU?,” Review of World Economics 154, 177–201.
- Chancellor, Edward (2011), “Germany’s eurozone trilemma,” Financial Times, November 6.
- De Grauwe, P (2013), “Design failures in the Eurozone: can they be fixed?,” European Economy, Economic Papers No. 491.
- Obstfeld, Maurice (2013), “Finance at a center stage: Some lessons for the euro-crisis,” European Economy, Economic Papers 493, April.
- Obstfeld, Maurice, and Alan Taylor (1998), “The Great Depression as a Watershed: International Gapital Mobility over the Long Run,” in The Defining Moment: The Great Depression and the American Economy in the Twentieth Century. Bordo, Michael D., Glaudia D. Goldin, and Eugene N. White, eds. Ghicago: University of Ghicago Press, 353-402.
- Pisani-Ferry, Jean (2012), “The Euro crisis and the new impossible trinity,” Bruegel Policy Contribution, Issue 2012/01.
- Rey, Hélène (2013), “Dilemma not trilemma: the global cycle and monetary policy independence,” Proceedings – Economic Policy Symposium – Jackson Hole, Federal Reserve Bank of Kansas City, issue Aug, 1-2.
- Rodrik, Dani (2000), “How far will international economic integration go?,” Journal of Economic Perspectives 14, 177-186.
- Schoenmaker, Dirk (2011), “The financial trilemma,” Economics Letters 111(1), 57-59.
- Schoenmaker, Dirk (2013), Governance of International Banking: The Financial Trilemma. Oxford University Press.
- Villeroy de Galhau, François (2017), “The future of the euro area: from the ‘impossible trinity’ to the ‘growth triangle’,” the 6th Annual Tommaso Padoa-Schioppa Lecture by the Governor of the Banque de France, at the Brussels Economic Forum 2017 – Brussels, 1 June.
- Weidmann, Jens (2016), “An impossible trinity? The interplay of monetary, financial and fiscal stability,” Welcome remarks of the President of the Deutsche Bundesbank at the Bundesbank Spring Conference “Monetary, financial and fiscal stability,” 10 June.
Notes
[1]La trinité impossible la plus célèbre est le triangle d’impossibilité de Mundel que Obstfeld et Taylor (1998) a nommé « trilemme de l’économie ouverte ». Rodrik (2000) a formulé un trilemme modifié entre les économies nationales intégrées, la politique de masse et l’Etat-nation. Par contre, Rey (2013) considère qu’il existe seulement un dilemme au lieu de trilemme.
[2]L’article 125 du Traité sur le fonctionnement de l’UE a rendu illégal le sauvetage d’un Etat-membre par les autres depuis sa version de 2007 (appelé aussi le Traité de Lisbon).
[3]Voir parmi d’autres, Beck et Prinz (2012) qui ont discuté de manière détaillée cette trinité.
[4]Dans ce sens, la trinité impossible formulée par Obstfeld (2013) est proche de celle formulée par Weidmann (2016), à savoir qu’il est impossible d’assurer à la fois la stabilité monétaire, financière et budgétaire.
Budget
La discipline budgétaire dans la zone euro : enjeux et perspectives
Les pays membres de la zone euro sont soumis à des règles de discipline budgétaire afin de veiller à une saine gestion des finances publiques nationales pour éviter toute déstabilisation de l’union monétaire. Régulièrement critiquées, ces règles trouvent leur origine dans les critères de convergence issus du Traité de Maastricht (1992) et ont été amenées à évoluer depuis la naissance de la zone euro en 1999. Afin de comprendre les enjeux liés à la discipline budgétaire dans l’UEM, il convient de revenir sur les raisons de l’introduction de règles et sur les différentes formes de règles possibles avant d’analyser la règle budgétaire qui s’applique dans la zone euro et de comprendre les récentes évolutions suite à la crise financière de 2008 .
Les raisons à la discipline budgétaire
- dangers d’un financement de la politique budgétaire par endettement sont relevés en raison de leur effet sur les taux d’intérêt et du potentiel effet d’éviction qui peut en découler.
- Par la suite, argument de l’ « incohérence temporelle » avec notamment les travaux fondateurs de Kydland et Prescott (1977). Dès lors que les agents économiques forment des anticipations rationnelles, pour qu’une mesure de politique économique soit efficace, les décideurs publics ont intérêt à surprendre les agents, autrement dit à prendre des mesures qui ne soient plus conformes aux mesures annoncées. Dans le cas de la politique budgétaire, cela risque d’affecter la confiance des investisseurs/prêteurs envers la politique économique et par conséquent les conditions de financement de la dette publique donc la solvabilité de la dette voire, le cas échéant, la soutenabilité de la dette publique. C’est ainsi qu’apparaît le débat « règles » versus « discrétion » : faut-il laisser les décideurs publics libres de décider de leur politique ou les contraindre par des règles ? Dans ce cas, il est préférable d’introduire des « règles » pour améliorer la cohérence temporelle des politiques budgétaires en disciplinant les gouvernements et accroître la confiance des marchés financiers.
- la stabilité financière d’un pays ou d’une zone géographique comme un bien public.
- existence d’externalités budgétaires liées à la mauvaise gestion des finances publiques peut conduire à des conséquences négatives sur les pays partenaires du pays en difficultés financières, soit parce que le pays en difficultés financières devra mener une politique budgétaire procyclique pour assainir ses finances publiques, soit parce qu’il entraînera d’autres pays dans sa faillite en cas d’enlisement dans ses difficultés.
- argument de science politique : argument basé sur « le biais politique pour le déficit » fourni par la nouvelle économie politique.
Dans le cas de l’UEM, plusieurs de ces raisons peuvent être invoquées. La première repose sur la nécessité d’assoir la crédibilité de la politique monétaire unique de la BCE en s’assurant de la discipline budgétaire des Etats membres de la zone. En outre, en raison du fort degré d’interdépendance financière dans l’union monétaire, la stabilité financière peut être considérée comme un « bien public européen ». Ensuite, face au risque de biais pro-cyclique et d’impact négatif sur la croissance en cas de mauvaise gestion des finances publiques. Enfin, en raison des potentiels effets de débordement entre les différents membres de l’union monétaire, l’introduction de règles est un moyen d’internaliser ces externalités.
Les formes possibles de surveillance des finances publiques
Quel est le meilleur indicateur d’une bonne gestion des finances publiques ? Quelle composante du budget soumettre à une règle ? Et quelle composante laisser évoluer librement ?
L’objectif est ici de trouver l’agrégat le plus pertinent qui permet d’évaluer correctement l’orientation de la politique budgétaire.
De façon générale, il existe quatre catégories d’agrégats :
- le solde public
- les dépenses publiques
- les recettes publiques
- la dette publique
Parmi ces indicateurs, les trois premiers mesurent un flux, le dernier mesure un stock.
Il existe en outre différentes variantes à chacun de ces agrégats notamment au solde public, selon qu’il soit considéré dans sa totalité, ou uniquement pour la partie corrigée des fluctuations conjoncturelles ou encore déduction faite des dépenses de charge de la dette ou d’investissement public. Nous allons envisager successivement ces différentes options afin de peser leurs avantages et inconvénients à partir de l’analyse du solde public. Une analyse similaire peut être menée pour les dépenses publiques qui peuvent également être exprimées corrigée des fluctuations conjoncturelles, des dépenses de charge de la dette ou d’investissement public.
La règle peut tout d’abord porter sur le solde public total. La règle peut également porter sur le solde primaire correspondant au déficit corrigé du poids de la dette.
Avantages : L’instauration d’une telle cible de déficit primaire permet de desserrer la contrainte qui pèse sur les politiques budgétaires des pays les plus endettés, les obligeant à mener des politiques budgétaires plus restrictives que les autres. Elle présente par ailleurs l’avantage de ne pas faire peser sur le gouvernement actuel le poids des erreurs des gouvernements passés.
Inconvénients : Cette règle néglige toutefois la distinction fondamentale entre mesures budgétaires non stabilisatrices et mesures budgétaires de stabilisation (délibérées et/ou automatiques) dans la mesure où le déficit primaire comprend l’ensemble des mesures budgétaires. Les marges de manoeuvre dont il faudrait pouvoir disposer pour assurer les fonctions budgétaires sont donc encore contraintes. Une telle règle ne permet donc pas vraiment de redonner de la souplesse aux politiques budgétaires nationales. En outre, une telle règle irait à l’encontre de l’objectif ultime de réduction de la dette publique.
La règle peut plutôt porter sur le solde public corrigé des fluctuations conjoncturelles communément appelé solde structurel. Il est généralement défini comme le déficit corrigé des effets automatiques de la conjoncture. En d’autres termes, le déficit structurel est égal au déficit discrétionnaire augmenté de la charge de la dette.
Avantages : Une telle règle permet de laisser jouer pleinement les stabilisateurs budgétaires automatiques[1] puisque le déficit se dégrade mécaniquement dès que l’activité économique tombe en-dessous de son sentier de croissance potentielle, comme le montrent un certain nombre de travaux à la fois théoriques ou empiriques[2].
Inconvénients : Des limites techniques inhérentes à cette notion de déficit structurel la rendent d’une applicabilité délicate. Deux problèmes majeurs apparaissent dès lors que nous cherchons à évaluer cet indicateur budgétaire. Le premier problème vient de la difficulté à évaluer correctement la croissance potentielle et donc le déficit structurel (voir encadré). Le second problème vient de la décomposition même en déficit structurel et déficit conjoncturel, indépendamment des difficultés à définir un PIB potentiel. En effet, par définition, le déficit structurel représente le déficit corrigé du poids de la conjoncture. Néanmoins, il faut insister sur le rôle stabilisateur que peuvent avoir les politiques discrétionnaires comme le soulignent Creel et Sterdyniak (1995) notamment. Le déficit discrétionnaire peut donc lui-même présenter une composante conjoncturelle résultant de choix politiques spécifiques et temporaires (comme l’illustrent notamment les mesures de réduction de l’impôt sur le revenu ou encore, moins récemment, les primes gouvernementales successives destinées à encourager l’achat de véhicules neufs3). Pourtant, dans les faits, le déficit structurel est traité comme la différence entre le déficit total et le déficit conjoncturel automatique (c’est notamment ce qui est fait par l’OCDE, le FMI ou encore la Commission européenne) ce qui revient à inclure le déficit conjoncturel délibéré dans le déficit structurel et fausser la mesure du déficit structurel à proprement parler. Cette terminologie ne semble donc pas totalement appropriée mais c’est celle communément utilisée par les organismes européens et internationaux de statistique.
La règle peut enfin porter sur le solde hors investissement public. Dans ce cas, cette règle est communément appelée « règle d’or ». Le déficit hors investissement public est défini comme le déficit corrigé du montant de l’investissement public (généralement évalué à partir de la FBCF publique). En d’autres termes, le déficit hors investissement public est égal à la somme du déficit discrétionnaire hors investissement public, du déficit automatique et de la charge de la dette. La règle d’or pose donc la condition que l’emprunt ne soit possible que pour financer l’investissement public.
Avantages : Le principal avantage d’une telle cible est de ne pas contraindre l’ampleur d’un facteur essentiel de croissance, l’investissement public. A partir des années 90, un intérêt croissant a été porté à la contribution du capital public à la croissance. Depuis les travaux fondateurs de Aschauer (1989) ou encore Barro (1990), d’autres études, utilisant différentes approches et différentes méthodes, ont cherché à approfondir cette voie4. Le plus souvent, l’investissement semble exercer un impact positif sur le niveau d’activité. En outre, il apparaît, au regard des expériences existantes (Royaume-Uni5 ou encore certains Etatsaux Etats-Unis), que l’existence d’une « règle d’or » s’accompagne systématiquement de dépenses en capital physique plus importantes. Dans le cas de l’UEM, cette proposition semble tout à fait pertinente pour trois raisons supplémentaires. Premièrement, elle se place tout à fait dans l’esprit de la Stratégie Europe 2020 destinée à soutenir une « croissance intelligente, durable et inclusive ». Deuxièmement, l’instauration du Traité de Maastricht puis du Pacte de Stabilité et de Croissance semble effectivement avoir eu une influence négative sur l’évolution de l’investissement public des pays membres de l’UEM : un biais anti-investissements publics d’infrastructures et de recherche et développement s’est développé en Europe. Troisièmement, avec l’élargissement de l’UE à certains pays de l’Est, il paraît peu justifiable de vouloir contraindre l’effort d’investissement en capital physique public étant donné l’état actuel des disparités de niveau de développement entre ces nouveaux membres et les anciens membres. En effet, cette règle permet alors de prendre en compte une certaine forme d’hétérogénéité entre les pays membres de l’union et de favoriser ainsi le rattrapage des pays de l’Est. En d’autres termes, cette cible permet d’adapter la règle aux spécificités nationales.
Inconvénients : Toutefois, l’utilisation d’une telle cible implique de pouvoir évaluer précisément l’investissement public net c’est-à-dire corrigé de la dépréciation du capital. Le problème repose sur l’évaluation du taux de dépréciation du capital public qui ne fait pas l’objet d’un véritable consensus. C’est pourquoi, le plus souvent, c’est le concept de formation brute de capital fixe des autorités budgétaires qui est retenu comme indicateur du niveau d’investissement public. En outre, encourager l’investissement en capital public physique risque d’introduire des distorsions au détriment des autres dépenses comme les dépenses courantes (santé par exemple) ou encore les dépenses d’investissement en capital humain, pourtant tout aussi cruciales.
La règle appliquée dans l’UEM, intérêts et limites
La règle budgétaire actuellement en vigueur dans l’UEM apparaît relativement originale et ce pour au-moins 3 raisons souvent passées sous silence :
- La règle budgétaire dans la zone euro est une règle budgétaire supranationale, qui intervient ou non comme seule règle de discipline budgétaire en fonction du pays dans lequel elle s’applique, comme cela a été souligné précédemment. Un biais dans l’appropriation politique ou non de la règle budgétaire par le pays peut ainsi émerger. En d’autres termes, les pays étant déjà soumis à une règle budgétaire nationale peuvent être plus enclins à respecter la règle supranationale, que les autres.
- La règle budgétaire issue du Traité de Maastricht (1992) et reformulée dans le Pacte de Stabilité et de Croissance (1997) a déjà été trois fois réformée (2005, 2011, 2013). En conséquence, pour comprendre la règle actuelle, il est incontournable de revenir sur les précédentes versions de la règle et les raisons de chaque réforme.
- La réforme de 2005 explique en partie les difficultés financières qui ont surgi pour certains Etats membres au moment de la crise financière de 2008.
Depuis 1999, la règle de discipline budgétaire qui s’applique aux Etats membres de l’UEM ainsi que la procédure de surveillance des finances publiques nationales se sont largement complexifiés[6], rendant la compréhension par le grand public impossible et l’appropriation par les nouveaux décideurs publics très délicate. A ce stade, il est urgent de ne plus engager de nouvelles réformes à ce titre. En revanche, le renforcement de la gouvernance économique de la zone euro est pourtant encore loin d’être achevée comme le souligne le FMI (2015) et la Commission Européenne (2017d).
Références bibliographiques
BARBIER-GAUCHARD Amélie, SIDIROPOULOS Moïse, VAROUDAKIS Aristomène (2018), La gouvernance économique de la zone euro : réalités et perspectives, éditions De Boeck.
Notes
[1] La « stabilisation budgétaire automatique » correspond au mécanisme par lequel l’évolution « automatique » du budget permet d’amortir les effets des chocs conjoncturels (exemple : réduction des recettes fiscales collectées et accroissement des prestations sociales versées en cas de ralentissement économique).
[2] Voir notamment Commission Européenne (2001) ou encore Barbier-Gauchard et Villieu (2003).[3] Mises en place par E. Balladur en 1994 et A. Juppé en 1995 ou plus récemment la prime à la casse en vigueur en France à partir du 1er janvier 2018.[4] Voir Barbier-Gauchard et Montagne (2017) pour une revue de littérature récente sur le sujet.[5] Voir, à cet égard, Buiter (2001) ou encore Mathieu (2003).[6] Voir également Commission Européenne (2016).
Un budget de la zone euro à vocation conjoncturelle : entre fédéralisme en progression et mille feuilles institutionnel
C’est actuellement autour de la question de l’évolution de l’architecture de la zone euro que se crispe le débat. Mais cette question recouvre différentes dimensions comme l’illustre la figure suivante : à la dimension économique, budgétaire et financière s’ajoute la dimension politique.
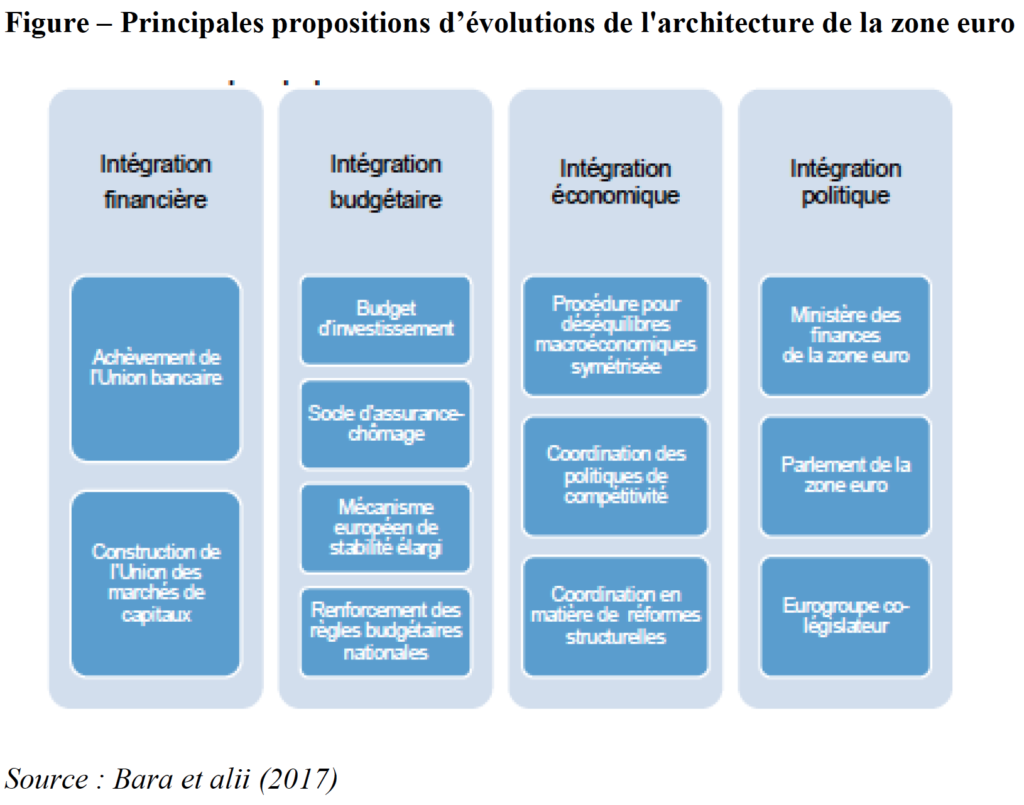
Du point de vue de l’intégration budgétaire, à l’heure où les propositions se multiplient en faveur d’un budget pour la zone euro[1], il convient au préalable de se demander : de quoi a vraiment besoin l’UEM ? En d’autres termes, que manque-t-il vraiment pour achever la gouvernance économique de la zone euro ? Plus généralement, il s’agit de se demander de quelle union budgétaire l’UE a réellement besoin ?
La réponse à cette question exige de distinguer les enjeux auxquelles l’UE dans son ensemble est confrontée, des difficultés que l’UEM doit arriver à surmonter. En effet, toute l’originalité du modèle européen repose sur la coexistence de différents stades d’intégration économique. Sur les 28 Etats membres de l’Union Européenne (qui ne seront plus que 27 à compter du 1er janvier 2020, date à laquelle le Royaume-Uni aura quitté définitivement l’UE), seuls 19 d’entre eux ont franchi l’étape de l’intégration monétaire en intégrant l’UEM (Union Economique et Monétaire) et en adoptant l’euro comme monnaie unique. Sur les 9 Etats membres de l’UE n’appartenant pas à la zone euro : 3 d’entre eux le sont par choix (c’est le cas du Danemark, de la Suède et du Royaume-Uni), les 6 autres ont vocation à intégrer, un jour, l’union monétaire.
Dans ce contexte particulièrement difficile à appréhender, les défis à relever sont de nature extrêmement différente obligeant par là même les économistes qui travaillent sur ces questions à faire appel à des outils et des méthodologies différentes et complémentaires. De façon schématique, l’UEM est confrontée à deux défis majeurs et la façon dont ces défis seront traités dessinera les contours de la future Union Budgétaire Européenne.[2]
Le premier défi à relever est celui du financement de nouveaux investissements publics dans la perspective de la stratégie européenne en faveur de la croissance et de l’emploi. Ce défi concerne l’UE et non seulement la zone euro comme certains experts le recommandent pourtant. En effet, instaurer un budget de la zone euro pour financer ce type d’investissement s’avèrerait extrêmement dangereux pour l’UE dans son ensemble, risquant de creuser encore davantage les hétérogénéités entre les pays européens et créant de facto une Europe à deux vitesses[3] (entre les pays qui appartiendraient à la zone euro et qui bénéficieraient d’instruments d’intervention supplémentaires pour soutenir la croissance et l’emploi, et les autres qui restent hors de la zone euro). Ce défi doit donc être relevé au niveau de l’UE dans son ensemble et être considéré dans les discussions portant sur le cadre financier 2021-2028 et sur ses modalités de financement.
Le second défi est celui de la stabilisation des chocs conjoncturels qui frappent les pays membres de la zone euro. Il s’agit ici d’un problème spécifique à la zone euro lié au fait que l’union monétaire créée est loin d’être une zone monétaire optimale[4] dans l’esprit des travaux initiés par Mundell (1961). La zone euro a répondu en partie à cette question puisque la BCE gère déjà de facto les chocs symétriques[5]. Mais ce sont les chocs asymétriques[6] (ou symétriques à effets asymétriques[7]) qui posent problème pour plusieurs raisons : (1) en raison de l’abandon de l’instrument monétaire dont disposaient les pays membres de l’UEM avant leur entrée dans l’union monétaire (qui ne disposent plus désormais que de l’instrument budgétaire pour stabiliser la conjoncture, dans un contexte où les finances publiques sont parfois largement contraintes par les règles de discipline budgétaire), (2) en raison de l’existence d’importantes hétérogénéités structurelles entre les pays membres de l’UEM, (3) il n’existe aucun autre mécanisme alternatif de stabilisation conjoncturelle suffisant pour amortir ce type de choc qui pourrait se substituer à une intervention budgétaire. Dans ce cas, instaurer un budget spécifique à la zone euro pour contribuer à l’amortissement de ce type de choc semble pertinent. En d’autres termes, la vocation de ce budget zone euro serait de jouer un rôle de stabilisateurs budgétaires automatiques complémentaires aux stabilisateurs budgétaires automatiques déjà à l’oeuvre au niveau national comme l’illustre la figure suivante.
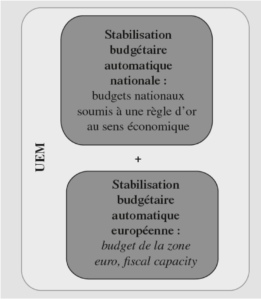
Source : Barbier-Gauchard, Sidiropoulos et Varoudakis (2018)
Enjeux et difficultés d’un budget de la zone euro à vocation conjoncturelle
Comme le mettent en avant les rapports MacDougall (1977) et Delors (1989), il est difficile d’envisager une union monétaire sur le long terme sans mécanisme d’assurance contre les chocs asymétriques. Même si l’absence de fédéralisme politique est un frein à la mise en place d’un tel système dans la zone euro, un pas vers plus de solidarité en matière budgétaire n’est pas impossible. Dans ce sens, l’idée d’un budget de la zone n’en n’est plus au stade du projet mais bel et bien d’objectif concret depuis l’été 2018 et l’accord obtenu lors du conseil franco-allemand sur la réforme de la zone euro. Cependant, de nombreuses voix s’élèvent contre (Autriche, Belgique, Finlande, Lettonie, Luxembourg et d’autres encore) notamment, en remettant en cause sa pertinence, son financement et son application prévu pour 2021.
Un budget de la zone euro à vocation conjoncturelle viserait à soutenir financièrement les pays en crise suite à un choc asymétrique. Cependant, là encore, de nombreuses interrogations apparaissent. Notamment, à partir de quand décide-t-on qu’un pays est en crise ? Un/des indicateurs devront être judicieusement définit pour rendre compte de la situation conjoncturelle des pays. Le taux de chômage est fréquemment évoqué. Le budget de la zone euro consisterait alors en une assurance chômage, en complément des systèmes nationaux, afin de les aider à stabiliser un choc. Aussi bien du point de vue économique que des finances publiques. Cependant, le taux de chômage étant également expliqué par des raisons structurelles (spécialisation productive, qualification de la main d’oeuvre, rigidité des marchés du travail etc), un indicateur unique semble être peu probable.
Ensuite, dans ce deuxième cas, un fond de stabilisation conjoncturelle risque davantage de devenir un fond finançant des transferts transnationaux que refuse l’Allemagne notamment. En effet, l’idée de transfert, traditionnellement, des pays du Nord vers les pays du Sud de la zone euro sont totalement exclus.
De plus, l’allocation d’un budget de la zone euro pourrait avoir des conséquences sur la bonne cohésion des pays à cause du caractère automatique ou discrétionnaire de l’allocation du budget. S’il s’agit d’un budget discrétionnaire, l’allocation des fonds devra faire l’objet de négociations systématiques lors desquelles, chaque pays va probablement tenter d’obtenir un maximum de fond. Comme nous l’observons déjà avec le budget de l’Union Européenne. S’il est automatique, il faudra décider d’une règle sur laquelle conditionner le versement des fonds, chose que refuse actuellement l’Allemagne.
Enfin, question également cruciale, le mode de financement et son montant. Une fourchette très large est déjà évoquée : un fond à « deux chiffres », c’est-à-dire de 10 à 99 milliards d’euros. Là encore, les critiques de la part d’autres pays pleuvent. 10 milliards, loin d’être suffisant pour assurer les objectifs mis en avant mais avec 99 milliards, se pose la question de qui paie, et comment. Plusieurs pistes de financement sont déjà évoquées. Par contribution des Etats d’une part et par un financement direct via impôt d’autre part. Allouer les recettes d’une taxe sur les transactions financières comme appliquée en France serait l’une des pistes privilégiées.
Les économistes ont peu de recul et d’analyse sur un budget, spécifiquement de la zone euro étant donné son caractère incertain d’une part et très récent d’autre part. Il n’existe aujourd’hui pas d’études testant son efficacité dans la mesure où nous ne connaissons ni le montant ni l’allocation précise des fonds. Cependant, une large littérature s’est développée sur la question des transferts transnationaux.
Les travaux des économistes sur les transferts intergouvcrnementaux
L’idée des transferts entre pays d’une même union monétaire à très tôt été avancée. L’efficacité de ce système est soulignée par de nombreuses études reconnues. Sachs et Sala-i-Martin (1991) montrent par exemple qu’un choc dans un Etat américain est compensé à 40% par des transferts du gouvernement fédéral. De la même manière, Goodhart et Smith (1993) montrent eux que 25 à 35% d’un choc sur une province canadienne est lissé par le budget fédéral. Pour un Etat unitaire comme la France, les résultats sont également probants puisque Italianer et Pisani-Ferry (1992) et Melitz et Zumer (1998) trouvent des résultats respectivement de 37 et 38%. Globalement, les résultats tournent autour d’une efficacité de 25-30% tout en sachant que les résultats restent contrastés en fonction de la structure économique de chaque pays. Les études académiques et l’expérience des autres unions monétaires montrent bien l’intérêt d’un mécanisme de transfert pour stabiliser les chocs asymétriques. Nous pouvons donc imaginer qu’un budget de la zone euro à des fins de stabilisation conjoncturelle pourrait être dans le même ordre d’efficacité.
Concernant l’activation des transferts suite à un choc. Pour mesurer les déviations de la conjoncture par rapport à la tendance, des travaux ont étudié les déviations du PIB. Cependant, le PIB est-il la variable la plus représentative d’un choc ? Pour éviter un montant de transfert trop important ou à l’inverse, trop faible par rapport à la force du choc, il faut trouver la variable qui réagit justement et rapidement au choc. Par exemple, nous savons que l’investissement a tendance à être plus volatile que le PIB, donc en ciblant cet indicateur, il risque de sur-réagir et de déclencher un surplus de transfert par rapport aux besoins réels de stabilisation. A l’inverse, nous savons que les revenus du travail, ont tendance à peu réagir aux chocs à cause de rigidité sur les salaires. L’enjeu pour le déclenchement d’un montant adéquat est d’utiliser la bonne cible comme indicateur de référence. Plusieurs économistes se sont penchés sur cette question du déclenchement des transferts en faisant le choix de cibler plusieurs indicateurs. Globalement, les études se concentrent à utiliser le PIB (les déviations par rapport à sa tendance ou par rapport au PIB de l’union), le taux de chômage ou encore le niveau de consommation comme Italianer et Pisani-Ferry (1992) (Mélitz (1994) et Hammond et Von Hagen (1995)) qui ont construit une règle de ciblage en fonction de l’écart du PIB d’un pays i par rapport au PIB moyen de l’union. Ces mêmes auteurs proposent également de cibler le chômage. Les transferts sont inexistants pour le pays i si la volatilité de son taux de chômage est inférieure à celle de son voisin et sont positifs dans le cas inverse. Mélitz (1994) s’intéresse également à la prise en compte du taux de chômage comme cible. Les transferts sont conditionnés en fonction d’un niveau de référence basé sur le passé, ici sur 4 trimestres. Evers (2012), va tester également l’efficacité des transferts, c’est à dire, leur capacité à lisser correctement la conjoncture suite à un choc en mesurant les variations de plusieurs variables : le PIB, la consommation, les revenus du travail et les déficits publics du pays concerné. Evers conditionne l’activation des transferts en fonction des déviations de ces quatre cibles par rapport à leur tendance respective. En jouant sur le poids accordé à chaque cible, il va pouvoir mesurer quelle combinaison capte le mieux la réactivité de l’économie et donc, quelle combinaison déclenche le montant de transfert adéquat.
Ainsi, comme ces études le montrent, il existe plusieurs cibles possibles permettant de déclencher les transferts d’un budget commun. La cible la plus souvent utilisée est le PIB car son évolution conjoncturelle rend relativement bien compte d’un éventuel choc.
Ensuite, se pose également la question fondamentalement du financement d’un tel budget. L’exemple de la querelle des européens sur le budget communautaire de la période 2014 – 2020 montre que chacun tente de tirer profit de la contribution des autres. Kim et Kim (2012) s’intéressent à cette question. Pour un mécanisme de transfert deux options sont possibles : des ressources propres d’une autorité centrale ou une contribution des membres de l’union ; dans ce dernier cas, les auteurs supposent que chacun va financer une partie du budget. Mais qui va bénéficier concrètement de cette manne ? L’argent doit-il être utilisé par l’Etat afin de limiter le creusement de ses déficits publics, ou bien doit-il servir aux agents privés afin de lisser leur consommation ?
Ainsi, nous le voyons, la question d’un budget commun visant à réduire les hétérogénéités et ou à stabiliser les chocs en union monétaire fait largement débat au sein de la communauté des économistes. Ces derniers relèvent une efficacité certaine mais fortement conditionnée par les montants en jeu et le mode de fonctionnement quant à l’allocation des ressources.
L’intérêt d’un mécanisme de stabilisation budgétaire automatique
Ce budget de la zone euro pourrait au contraire être envisagé sous la forme d’un mécanisme de stabilisation budgétaire automatique. Dans le cas de l’UEM, l’outil le plus fréquemment retenu pour mettre en oeuvre un mécanisme européen de stabilisation budgétaire automatique repose sur l’assurance chômage. Il s’agit ici d’envisager un mécanisme d’assurance chômage européen (European Unemployment Benefits Scheme (EUBS) ou European Unemployment Insurance (EUI) encore en anglais) visant à assurer les États membres contre les chocs asymétriques[8].
Comme le soulignent Lellouch et Sode (2014), les dépenses d’indemnisation chômage constituent en effet un stabilisateur automatique de premier ordre permettant d’atténuer l’effet des chocs conjoncturels sur l’activité économique. En maintenant un certain niveau de revenu chez les personnes touchées par le chômage, les prestations chômage soutiennent la demande agrégée et permettent aux chômeurs de disposer de temps pour trouver un emploi adapté correspondant à leurs qualifications, ou le cas échéant faciliter leur reconversion. De plus, puisque les dépenses d’assurance chômage ciblent principalement des ménages modestes qui subissent des contraintes de liquidités, leur effet multiplicateur est d’autant plus important. De part ce ciblage, elles constituent également un rempart contre la précarité et la pauvreté des individus les plus fragiles. Enfin, les indemnisations chômage sont un outil de stabilisation particulièrement efficace car elles répondent quasi instantanément à la dégradation de la conjoncture.
Envisager une assurance chômage européenne nécessite de tenir compte des systèmes déjà existants au niveau national qui différent tant en termes d’organisation institutionnelle, de financement, de règles d’éligibilité, de durée d’indemnisation ou encore de paramètres de calcul des indemnisations ou encore de degré de sévérité des contrôles et des sanctions. En effet, il existe actuellement une forte hétérogénéité dans le fonctionnement des régimes d’assurance chômage des États membres de la zone euro qui sont notamment le reflet de préférences nationales en matière sociale et de choix historiques comme le soulignent ou encore Dhont-Peltrault (2016) ou encore Ourliac (2017). Le graphique suivant illustre notamment la diversité des durées d’indemnisation dans un certain nombre de pays européens. En 2014, 4 États membres de la zone euro avaient des durées d’indemnisation maximale inférieures à 1 an (Royaume-Uni, Malte, Irlande et Autriche) alors que 6 États membres ont des durées d’indemnisation de presque 2 ans ou plus (Belgique, Pays-Bas, France, Danemark, Espagne, Norvège et Finlande).
Références
- BARBIER-GAUCHARD Amélie, SIDIROPOULOS Moïse, VAROUDAKIS Aristomène (2018), La gouvernance économique de la zone euro : réalités et perspectives, éditions De Boeck.
- EVERS M.P. (2012). « Federal fiscal transfer rules in a monetary unions ». European Economics Review, vol 56, pp 507-525
- GOODHART C. et SMITH S. (1993). S »tabilisation, in European Economy ». The Economicsof Community Public Finance. Reports and Studies, 5, pp. 417-55
- ITALIANER A. et PISANI-FERRY J. (1992). « Systèmes budgétaires et amortissement des chocs régionaux : implications pour l’Union économique et monétaire ». Economie Prospective Internationale, n°51, 3e trimestre
- KIM J. et KIM S. (2012). « How much to share : fiscal transfers in Europe » Sungkyunkwan University and Suffolk University, working paper
- HAMMOND G.W. et VON HAGEN J. (1995). « Regional insurance against asymetric shocks, an empirical study for the European community », CEPR, discussion paper 1170 10
- MELITZ J. (1994). « Faut-il une assurance communautaire contre des différences de conjoncture? » Economie et statistiques, 262, p 101-108
- MELITZ J. et ZUMER F. (1998). « Regional Redistribution and Stabilization by the Centre in Canada, France, the United Kingdom and the United States : New Estimates Based on Panel Data Econometrics ». CEPR Discussion Papers n°1829
- MENGUY S. (2010). « La régulation macroéconomique dans l’Union Economique et Monétaire ».Edition universitaires européennes
- SACHS J. et SALA-I-MARTIN X. (1991). « Fiscal Federalism and Optimum Currency Areas : Evidence for Europe from the United States ». NBER Working Paper No. 3855 National Bureau of Economic Research
Notes
[1] Voir notamment FM1 (2013), Juncker (2015), Bénassy-Quéré, Ragot et Wolff (2016), Rubio (2016), Perrut (2016) ou encore Commission Européenne (2017g et d).
[2] comme le soulignent notamment Caudal et alii (2013), Cotarelli et Guerguil (2014) ou encore Bara et alii (2017).
[3] Voir Bertoncini (2017) sur les limites d’une intégration différenciée.
[4] Une zone monétaire optimale est une zone géographique à l’intérieur de laquelle il est optimal (en termes de stabilisation conjoncturelle des chocs notamment) d’adopter la même monnaie. En d’autres termes, dans cette zone monétaire, la perte de l’usage de l’instrument monétaire par les membres de cette zone est compensée par l’existence de mécanismes alternatifs suffisants pour prendre le relai de la stabilisation conjoncturelle (mobilité du travail et du capital, flexibilité des salaires, spécialisation de la production, intégration financière, fédéralisme budgétaire …).
[5] Un choc conjoncturel symétrique est un choc qui frappe tous les pays en même temps et dans les mêmes proportions (exemple : les chocs pétroliers dans les années 70).
[6] Un choc conjoncturel asymétrique est un choc qui frappe un pays en particulier, sans affecter les autres (exemple : la chute du mur de Berlin en 1989).
[7] Un choc conjoncturel symétrique à effets asymétriques est un choc qui frappe tous les pays en même temps mais dans des proportions différentes (exemple : la crise des subprimes en 2008).
[8] Voir notamment Parlement Européen (2013b), Mayneris (2014), Claeys, Darvas et Wolff (2014), Gille (2015) ou encore Beblavy et Lenaerts (2017) ou encore Aparisi de Lannoy et Ragot (2017).
Travail
L’assurance chômage européenne : Vers une Europe plus européenne
Il semble évident que les crises économiques qu’accuse l’Europe depuis la fin des années 2000 ont considérablement altéré l’idée selon laquelle l’UEM serait une zone de croissance et de protection des individus qui la composent. Partout les tentations protectionnistes ressurgissent, et la question de la survie de la zone Euro est plus ou moins avancée. Il semble que le modèle proposé par Maastricht ne convienne plus, car ce dernier souffre de nombreuses faiblesses, notamment en accentuant les déficits et en créant un biais déflationniste (Pasimeni, 2015).
« Europe’s Economic and Monetary Union (EMU) today is like a house that was built over decades but only partially finished. When the storm hit, its walls and roof had to be stabilised quickly. It is now high time to reinforce its foundations and turn it into what EMU was meant to be: a place of prosperity based on balanced economic growth and price stability, a competitive social market economy, aiming at full employment and social progress. To achieve this, we will need to take further steps to complete EMU. »
Extract from the Five Presidents’ Report by Juncker et al. (2015), p.4
Une stabilisation macroéconomique indispensable
La première question face à la l’existence de chocs économiques touchant l’Europe est de savoir si finalement il ne suffirait pas de « laisser-faire » le marché. Ce dernier pourrait jouer le rôle de stabilisateur intertemporel, voire une stabilisation inter-régionale suite à des chocs idiosyncratiques. Néanmoins, afin que le marché remplisse cette fonction de stabilisateur, il se doit d’offrir des canaux permettant le partage du risque, et une meilleure allocation des ressources entre les régions. On peut constater avec évidence que le marché n’a pas rempli cette fonction, bien au contraire, celui-ci a eu tendance à amplifier les cycles, et réduire le partage du risque entre les Etats de la zone euro (Andor & Pasimeni, 2016).
Le marché étant écarté, on peut encore entrevoir deux autres outils européens : La politique monétaire[1] (pour une stabilisation intertemporelle) et les réformes structurelles (pour une stabilisation inter-régionale). Ceux deux moyens sont également à écarter :
- La politique monétaire, visant à éviter le risque déflationniste, a atteint sa limite (plancher du taux zéro) ;
- Les réformes structurelles conduiraient, pour leur part, à des coûts très élevés à court terme pour les Etat, accentuant encore davantage la pression déflationniste.
Il parait aujourd’hui évident que l’Europe ne dispose pas d’outils pertinents permettant une stabilisation macroéconomique intertemporelle et inter-régionale. La construction européenne actuelle en deux blocs, d’un coté une politique monétaire commune et de l’autre, des politiques budgétaires nationales, ne permet clairement pas de répondre aux chocs économiques affectant la zone euro (Dabrowski, 2015), notamment en cas de chocs asymétriques. Une même politique monétaire ne peut être appliquée à deux pays suivant des trajectoires diamétralement opposées (Grèce et Allemagne par exemple). Et l’instrument budgétaire national n’a pas permis de mieux répondre à ces chocs puisque il présente une grande rigidité (imposée par les règles européennes) alors qu’il eut été bien plus efficace d’avoir une grande flexibilité en cas de crise importante, comme celle survenue en Europe (Alcidi & Thirion, 2016).
En outre, aux cotés de ces enjeux liés aux politiques monétaires et fiscales, une importante littérature économique attribue un rôle crucial aux stabilisateurs automatiques, et donc la mise en place de tels mécanismes en Europe, pour trois principales raisons :
- Les défaillances de marchés
La mobilité en Europe est relativement faible, alors qu’en l’absence d’outils monétaires et fiscaux, le marché de travail devrait être justement le plus flexible possible (mobilité des travailleurs et des salaires). C’est ainsi qu’en cas de chocs asymétriques entre les Etats, ces derniers peuvent être absorbés via une mobilité des travailleurs et/ou une flexibilité des salaires. On reconnait ici la théorie des zones monétaires optimales initiées par Mundell (1961) et McKinnon (1963), et plus récemment par Arpaia et al. (2014).
- Le déficit des balances courantes
Lorsqu’un Etat perd son autorité monétaire, il perd simultanément la maitrise de son taux de change. Or, un tel instrument peut s’avérer utile lorsque le pays connait un déficit commercial. L’idée est de diminuer la valeur de la monnaie nationale afin de renchérir d’une part le coût des importations, et donc de freiner ces dernières, et d’autre part, de réduire le prix des exportations. En l’absence d’une possibilité de dépréciation de monnaie, la solution consiste à mener des politiques déflationnistes internes (baisser la demande interne par une baisse des salaires, réduction des dépenses publiques, hausse d’impôts…). Néanmoins, comme il a été mentionné ci-dessus, au sein de l’UEM, cela a conduit la plupart des pays à agir de la sorte et de créer un biais déflationniste (Pasimeni, 2015).
- Les effets de reports
L’argument est ici relativement simple. Lorsqu’une économie est affectée par un choc, du fait de son intégration dans une zone commerciale et monétaire, les effets négatifs vont se propager aux autres économies (Majocchi & Rey, 1993 ; Frankel & Rose, 1998 ; Kalemli-Ozcan et al., 2001 ; Allard et al., 2013). Dans ce cas, les politiques nationales ont clairement une efficacité moindre qu’une politique de stabilisation de la zone.
Toutes ces raisons mettent en exergue la nécessité de mettre en place des outils de stabilisation macro-économiques en Europe. L’allocation chômage européenne pourrait constituer un des instruments possibles.
L’assurance chômage : un stabilisateur automatique
Avant de discuter de la mise en place d’une allocation chômage européenne, il peut sembler pertinent de se demander si le versement d’une aide financière à une personne sans emploi est légitime. En dehors des considérations sociales, on peut s’interroger sur l’efficacité économique d’une telle aide.
Une première question consiste à se demander quelles seraient les effets d’une allocation chômage sur le marché de l’emploi[2]. On adopte ici une analyse en équilibre partiel, en se focalisant essentiellement sur le marché du travail. En général, deux visions s’opposent sur l’utilité des allocations. L’une est plutôt favorable à une utilisation très modérée de cet instrument. Burdett et Mortensen (1998) affirment que la dispersion des allocations chômage (c’et-à-dire des rémunérations qui sont différentes selon les travailleurs, et non un transfert forfaitaire unique quel que soit le chômeur) est source de chômage inefficient. Des chômeurs refuseraient des offres jugées trop basses en salaire. C’est notamment l’argument repris dans le Wall Street Journal par Barro (2010) qui soulignait qu’en l’absence d’allocation chômage, le taux de chômage ne dépasserait jamais les 7% aux Etats-Unis. Ljungqvist and Sargent, (1998, 2008) évoquent également la générosité du système d’indemnisation chômage comme élément explicatif du chômage européen. Cheron et Langot (2010) ont étudié le cas de la France caractérisée par une dispersion des allocations chômage (selon le salaire gagné). La dispersion des allocations chômage tend à accroitre le chômage par le rejet d’offre d’emploi, mais l’effet reste faible (environ à hauteur d’1%) et concerneraient essentiellement le travail peu qualifié. En clair, les auteurs soulignent qu’un versement forfaitaire pour les travailleurs peu qualifiés serait plus approprié.
Toutefois, l’allocation chômage peut être également perçu comment un versement permettant au chômeur d’effectuer une recherche efficace d’emploi comme l’ont notamment mis en lumière Marimon and Zilibotti (1999) ou Acemoglu et Shimer (2000). En effet, le fait de verser une subvention au chômeur lui permet de rechercher des emplois dont la productivité est plus forte, et ainsi générer également une plus forte croissance de l’activité économique et un plus grand bien-être.
Bien entendu, d’autres aspects concernant l’allocation chômage pourraient également être approchés afin de mieux cerner les effets sur l’emploi tels que la durée d’indemnisation, le montant optimal, la dégressivité ou non etc. Néanmoins, le sujet au niveau macro-économique est surtout de savoir dans quelle mesure, l’allocation chômage peut constituer un amortisseur aux chocs économiques.
La littérature économique montre que l’allocation chômage peut atténuer les fluctuations économiques via plusieurs canaux. La première idée est simplement fondée sur le fait qu’un revenu de remplacement en cas de perte d’emploi permet de soutenir la demande agrégée en réduisant les fluctuations de revenus. En clair, la demande totale qui est fonction du revenu de l’économie ne s’effondrerait pas suite à une hausse du chômage. Le fait que les chômeurs soient rémunérés permet de soutenir, certes la consommation, mais aussi l’investissement (Brown, 1955). Une second canal par lequel l’allocation chômage réduit les fluctuations économiques, et amortit ainsi la récession, est lié au fait que les personnes qui sont au chômage ont une forte propension à consommer. En d’autres termes, l’allocation chômage est essentiellement réinjectée dans le système économique et soutient ainsi l’activité. On peut notamment citer Blinder (1975), Krueger et al. (2016) et Di Maggio & Kermani (2016). Enfin, la commission européenne (2013) dans un rapport sur les stabilisateurs automatiques conclue également que l’allocation chômage est un moyen efficace pour de multiples raisons de lisser l’activité économique et notamment d’amortir les chocs en cas de crises. L’allocation chômage remplit parfaitement un rôle de stabilisateur automatique présente les caractéristiques suivantes :
- Automatique : l’assurance chômage est un mécanisme de « stabilisation automatique » puisqu’elle permet de stimuler ou ralentir l’économie selon le cycle conjoncturel et sans modification délibérée des politiques économiques ;
- Contracyclique : l’assurance chômage est de nature contracyclique, c’est-à-dire qu’elle a pour objectif d’atténuer les fluctuations conjoncturelles, en soutenant l’activité lorsque celle-ci est atone via une hausse des dépenses (plus d’allocations chômage versées), en la ralentissant lorsque celle-ci s’emballe via une baisse des dépenses (moins d’allocations chômage versées).
- Réactive aux chocs : le déclenchement de l’assurance chômage comme réponse à un choc économique présente un délai interne (temps qui sépare un choc sur l’économie et la mise en place de la politique économique pour y faire face) inexistant et un délai externe (temps qui sépare la mise en place de la politique économique et la production de ses effets) très court.
Une mise en place européenne
La mise en place d’une allocation au niveau européen soulève plusieurs questions : quelle serait l’articulation entre le niveau national et européen ? Quels serait le coût de cette mesure ?
Il peut exister différents schémas d’allocation chômage en Europe (Bénassy-Quéré et Keogh, 2015) : 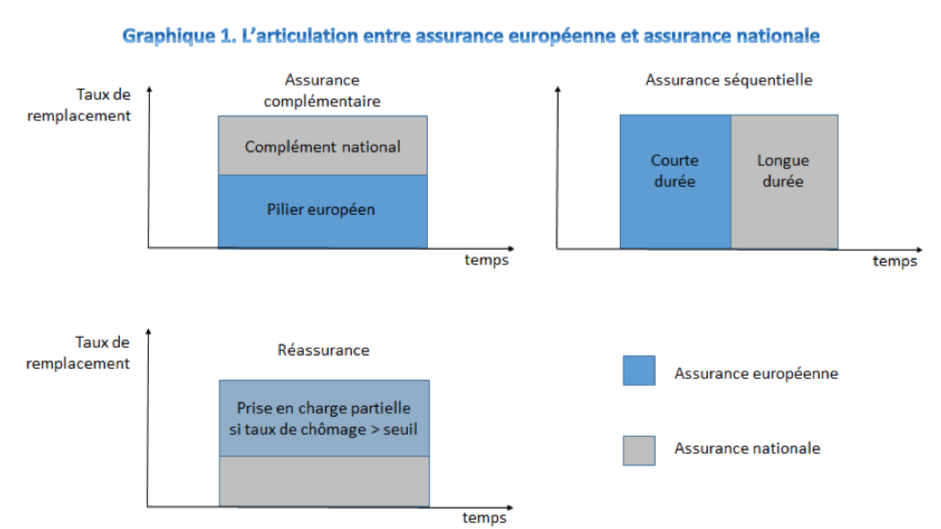
Trois architectures sont imaginées :
1.Assurance complémentaire : La partie européenne fournit un certain taux de remplacement (ex. 50%) puis la partie nationale vient compléter selon les préférences nationales. Ce serait une position de Dullien et Fichtner (2013) et Lellouch et Sode (2014), tout du moins pour la première année[3]. L’idée ici est essentiellement de faire reposer l’aide européenne sur la partie cyclique du chômage (le chômage de court terme).
2.Assurance séquentielle : La partie européenne finance les indemnités des premiers mois (ex. 6 mois) de chômage et la partie nationale la suite, la durée étant choisie au niveau national. Beblavý, Gros et Maselli (2015) propose notamment une telle approche, ou l’assurance européenne ne serait déclencher que lorsque le chômage de courte dépasse un certain seuil et pour un certain laps de temps.
3.Réassurance : La partie européenne n’entre en jeu que si un pays est soumis à une forte hausse du chômage, qui recevrait un transfert positif lui permettant de financer l’indemnisation des chômeurs supplémentaires. Claveres et Stráský (2018) ont notamment proposé un tel schéma et ont montré qu’une allocation chômage sous la forme d’une réassurance aurait été un vecteur de stabilisation macroéconomique supplémentaire lors de la crise financière de 2009-2013, au niveau de la zone euro comme au niveau des différents pays touchés par la crise. Cette réassurance aurait également éviter des transferts permanents entre les pays.
Combien couterait une telle mesure ? Sur ce sujet, les chiffres évoquent une fourchette entre 0,5% et 3%. Le financement reposerait sur les cotisations employés/employeurs sur les salaires, taxes sur les entreprises, contribution versée par l’Etat en pourcentage de son PIB ou émission de dette. Les chiffres peuvent paraitre étonnamment faibles, mais il faut rappeler que le financement ne serait pas total, que par ailleurs, si le rôle de stabilisateurs automatiques fonctionne, il tendrait à réduire le taux de chômage, et donc le coût de ce dernier.
Les deux principaux freins à l’allocation chômage européenne
Les deux limites à la mise en place d’un tel dispositif sont bien connues. Il s’agit de problème de l’aléa moral et des transferts permanents.
L’aléa moral signifie que si un individu ou une entité est protégé contre un risque, elle adopte un comportement moins vigilant face au risque. Si l’on applique cela au problème de l’allocation chômage européenne, l’aléa moral stipulerait que les Etats consacreraient moins d’efforts à la lutte contre le chômage, puisque ils bénéficieraient de fonds européens pour financer les chômeurs. Selon Bénassy-Quéré et Keogh (2015), l’aléa moral encourage donc à la mise en place d’une aide européenne de courte durée. Evidemment, le revers de cette allocation de courte durée serait sans doute une tentation forte de la part des Etats à favoriser les contrats courts et donc de la précarité. Il faudrait alors établir des seuils de déclenchement de l’allocation, par exemple 3 mois et moins de 12 mois. On peut également imaginer des conditions d’éligibilité reposant sur la nécessité d’avoir eu un emploi durant une durée minimum afin de bénéficier des allocations européennes. Néanmoins, on risquerait d’écarter du processus les jeunes qui ont souvent de contrats courts. Il est également possible qu’un Etat complète l’allocation européenne, procurant un revenu de remplacement important et désincitant le chômeur à une recherche active d’emploi.
En résumé, il conviendrait de mettre en place des règles strictes d’indemnisation du chômage en termes de durée, et de plafonds.
Le second problème est celui des transferts permanents à long terme. Il ne faudrait que ce système d’allocation chômage conduisent à des transferts de pays à faible taux de chômage vers les pays à fort taux de chômage. Ce problème doit être évoqué, même si comme le souligne Andor et Pasimeni (2016), il demeure secondaire par rapport aux gains de la communauté. Selon Beblavý et Lenaerts (2017), deux moyens peuvent éviter le problème des transferts permanents : Un bonus/Malus (Expérience rating) et la récupération des fonds (claw-back).
L’Experience Rating se concevrait comme une sorte de bonus/malus dans le sens où il correspond à un mécanisme qui associe le versement au fonds supranational en fonction de la probabilité de l’utiliser, soit en tenant compte de la fréquence d’utilisation du fonds (réassurance), soit en liant le versement au taux de chômage antérieur du pays (assurance). Ainsi, les pays ayant de faibles taux de chômage verraient leur contribution se réduire avec le temps.
La récupération constitue un deuxième mécanisme qui pourrait être utilisé pour traiter les transferts permanents. Il s’agirait d’éviter les déséquilibres à long terme vis-à-vis du fonds supranational et d’avoir in fine des contributeurs nets et bénéficiaires nets. Lellouch et Sode (2014) proposent de recalculer le taux de cotisation pour chaque pays tous les 5 ans, de sorte à ce que dernier correspond au transferts et contribution du pays en question. Beblavý, Gros et Maselli (2015) proposent une durée plus longue, et de moduler ainsi les contributions sur la base des 10 dernières années.
Les bénéfices d’une allocation chômage européenne
L’allocation chômage européenne permettrait incontestablement d’atteindre une stabilisation macroéconomique. On peut citer deux canaux offrant la possibilité aux économies de se maintenir en cas de récession via une allocation chômage européenne. Le premier canal repose sur le fait que l’allocation chômage européenne vient renforcer l’allocation nationale (que ce soit en termes de couverture ou de générosité). Cet accroissement permet ainsi de soutenir l’activité du pays. Un second canal est lié au fait que l’allocation chômage est lissée entre les pays. En d’autres termes, même s’il y un socle national, supporté par l’Etat, il y a également un socle européen permettant de partager le coût et le risque du chômage sur plusieurs Etats, ce qui facilite la stabilisation macroéconomique (Moyen et al., 2016). Enfin, on peut avancer un troisième canal lié à l’inter-dépendance des économies. Cette dernière est très souvent citée dans un contexte négatif de propagation de crise. Mais on oublie également qu’il peut également propager des effets positifs. Ainsi, si un ou plusieurs Etats arrivent à stabiliser leur économie, cela se diffusera également aux autres Etats, notamment à travers les échanges commerciaux.
Des simulations ont été réalisées afin d’évaluer l’effet d’une allocation sur la stabilisation macro-économique. Dolls et Lewney (2017) ont analysé les conséquences de l’existence virtuelle d’une allocation chômage européenne durant la période 1995-2013. Les auteurs concluent que la mise en place d’une allocation chômage européenne en 1995 aurait permis d’éviter une baisse de 4,5% du PIB en 2009, par le jeu des stabilisateurs automatiques (notamment à travers un maintien de la consommation). Moyen et al. (2016) montrent qu’une assurance chômage inter-inter-régionale se traduit par le partage du risque entre les Etats. Ceci permet une forte stabilisation à travers la consommation des ménages. Beblavý et Lenaerts (2017) estiment que la mise en place d’une allocation chômage aurait conduit à atténuer les effets de la crise, et ce, d’autant plus dans les pays très fortement toucher par cette dernière. Leurs estimations établissent que la mise ne place d’une allocation chômage en Europe dès 1995 aurait généré un PIB de la zone UE19 plus élevé de 0,2% en 2009 en moyenne. Ces simulations montrent que selon les scénarios d’allocations chômage et la nature des chocs touchant l’Europe (symétriques, asymétriques, court terme ou long terme), la présence d’une allocation chômage génèrerait une variation du PIB de -0,12% à +0,77%, en notant que le taux négatif n’intervient qu’à une seule occasion sur les 16 cas possibles. Globalement, les effets sur le PIB demeurent largement positifs.
On peut en outre ajouter que cette allocation chômage améliorerait sans doute la mobilité des travailleurs européens et d’obtenir dès lors un marché du travail plus intégré. En effet, la portabilité de cette allocation européenne offrirait de meilleures conditions de recherche d’emploi des travailleurs. Depuis 2010, il existe une portabilité des droits, mais dans un système relativement compliqué, ce qui tend fortement à limiter l’utilisation de ces droits. Par ailleurs, ces droits sont souvent très courts (de 3 à 6 mois) qui sont insuffisants lorsqu’on le recherche un emploi à l’étranger, nécessitant notamment la maitrise d’une nouvelle langue.
Pour faciliter la mobilité, certes une allocation chômage européenne versée sur une durée plus longue constituerait un atout indéniable, mais il conviendrait également de mettre en place une agence de contrôle et de coordination au niveau supranational. Cette agence serait chargée notamment du contrôle des statuts des chômeurs, mais également de coordonner les systèmes de sécurité sociale. Elle aurait pour objectif principal de vérifier qu’un travailleur se déplaçant d’un Etat à un autre, ne serait pas pénalisé en termes de droits sociaux.
Pour conclure, l’allocation chômage permet assurément de contribuer à l’Europe sociale. On peut évoquer 4 points, constituant une source d’une Europe plus sociale.
Tout d’abord, la mise en place d’une politique supranationale d’assurance chômage conduirait sans doute à harmoniser les politiques nationales d’indemnisation des chômeurs. Il est souvent difficile de modifier le système national de protection des chômeurs. Le fait qu’il y ait un système supranational offrirait la possibilité de glisser doucement vers ce système européen, et serait plus facilement compréhensible et acceptable par les citoyens. L’expérience américaine montre notamment que si les Etats ont leur propre schéma d’allocation chômage, l’existence d’une aide fédérale conduit à une convergences des systèmes de chaque Etat.
Par ailleurs, si l’Europe adoptait une allocation chômage européenne, elle aurait également entre ses mains la possibilité de faire converger les Etats vers des qualités d’allocation chômage optimales et une meilleure efficacité des politiques d’activation. Le fait de financer les chômeurs conférerait une sorte de légitimité à l’Europe qui pourrait imposer en douceur ou de manière plus contraignante des lignes directrices améliorant l’efficacité de la prise en charge des chômeurs. Cela conduirait par ailleurs à une réduction de l’aléa moral lié à l’allocation chômage européenne.
De plus, une indemnisation des chômeurs assurée au niveau européen permettrait également de favoriser la cohésion sociale européenne. En effet, c’est incontestablement un moyen efficace de lutte contre la pauvreté du fait d’une générosité plus importante et d’une couverture plus grande.
Enfin il est nécessaire de commencer à construire désormais un vrai 4ème pilier de l’Europe : l’Europe des droits sociaux. Les effets de la crise récente européenne (forts hauts taux de chômage dans certains pays, le chômage longue durée, celui des jeunes ou le développement de la précarité, au sein d’une zone des plus riche du monde) doit nous obliger à intégrer une converge sociale européenne. Faute de quoi, l’éclatement de l’Europe sera à nos portes. L’allocation chômage européenne pourrait constituer une première pierre importante de l’édifice social.
Bibliographie/webographie
- Acemoglu, D., Shimer, R., (2000), « Productivity gains from unemployment insurance. » European Economic Review 7, 1195–1224.
- Alcidi, C. and G. Thirion (2016), « Assessing the Effect of Shocks in the Euro Area’s Shock Absorption Capacity – Risk-sharing, consumption smoothing and fiscal policies », CEPS Special Report No. 146, CEPS, Brussels, March
- Allard, C., P.K. Brooks, J.C. Bluedorn, F. Bornhorst, K. Christopherson, F. Ohnsorge and T. Poghosyan (2013), “Toward a Fiscal Union for the Euro Area”, IMF Staff Discussion Note, No. 13/09, Washington, D.C.
- Andor L (2013) “Can we move beyond the Maastricht orthodoxy?”, VoxEU, 13 December.
- Andor L. & Pasimeni P. (2016) « An unemployment benefit scheme for the Eurozone », Vox, CEPR Portal Policy
- Arpaia A., B. Kiss, B. Palvolgyi and A. Turrini (2014), « Labour Mobility and Labour Market Adjustment in the EMU », European Economy Economic Papers, No. 539, DG for Economic and Financial Affairs, European Commission, Brussels
- Barro, R. , (2010), « The folly of subsidizing unemployment » Wall Street J.
- Bénassy-Quéré A. et Keogh A. (2015), « Une assurance chômage européenne ? », Conseil D’Analyse Economiques, Focus,
- Beblavý M. et Lenaerts K. (2017), « Feasibility and Added Value of an European Unemployment Benefits Scheme » CEPS Papers 12230, Centre for European Policy Studies.
- Beblavý M., D. Gros et I. Maselli (2015) : « Reinsurance of National Unemployment Benefit Schemes », CEPS Working Document, n° 401, janvier.
- Blinder, A. S. (1975), « Distribution effects and the aggregate consumption function. » The Journal of Political Economy, 447-475.
- Brown, E. C. (1955), « The static theory of automatic fiscal stabilization » The Journal of Political Economy, 427-440.
- Burdett K. and Mortensen D.T. (1998) « Wage Differentials, Employer Size, and Unemployment » International Economic Review, Vol. 39, No. 2, pp. 257-273
- Cahuc P., Carcillo S., & Zylberberg A. (2014) « Labor Economics, MIT Press, 2nd Edition
- Chéron A. et Langot F. (2010) « On-the-job search equilibrium with endogenous unemployment benefits », Labour Economics, vol. 17, 383–391
- Claveres, G., Stráský J. (2018), « Stabilising the Euro Area through unemployment benefits re-insurance scheme», OECD Economics Department Working Papers, No. 1497, OECD Publishing, Paris.
- Commission Européenne (2013), « Paper on automatic stabilisers », Bruxell, Octobre 2013
- Dabrowski, M. (2015), “Monetary Union and Fiscal and Macroeconomic Governance”, Discussion Paper 013, DG for Financial and Economic Affairs, European Commission, Brussels.
- Di Maggio M. et Kermani A. (2016), « The importance of Unemployment Insurance as an automatic stabilizer » NBER Working Paper
- Dolls M. et Lewney R. (2017), « Backward-looking analysis » European Commission,
- Dullien S. et F. Fichtner (2013) : « A Common Unemployment Insurance System for the Euro Area », DIW Economic Bulletin, n° 1.2013.
- Frankel, J. and K. Rose (1998), “The Endogeneity of Optimum Currency Area Criteria”, Economic Journal, 108(449), pp. 1009-1025.
- Kalemli-Ozcan, S., B. Sorensen, Yosha O. (2001), “Economic Integration, Industrial Specialization, and the Asymmetry of Macroeconomic Fluctuations”, Journal of International Economics, 55(1), pp. 107-137
- McKinnonn R. (1963) « Optimum Currency Areas » American Economic Review, Vol. 53, No. 4, pp. 717-725
- Junker J-C. et al. (2015), « Compléter l’Union économique et monétaire européenne », Rapport des 5 président pour la Commission Européenne
- Krueger, D., K. Mitman, et Perri F. (2016), « Macroeconomics and Heterogeneity» NBER Working Paper
- Lellouche Th. et A. Sode (2014) : « Une assurance‐chômage pour la zone euro », Trésor‐Éco, n° 132, juin.
- Ljungqvist, L. , Sargent, T.J. (1998), « The european unemployment dilemma » Journal of Political Economy, 106, 514–550
- Ljungqvist, L. , Sargent, T.J. , (2008), « Two questions about european unemployment. » Econometrica, 76, 1–29
- Majocchi, A. and M. Rey (1993), “A special financial support scheme in EMU: Need and nature”, Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 52(2), pp. 161-204.
- Marimon, R., Zilibotti, F., (1999), « Unemployment vs. mismatch of talents: reconsidering unemployment benefits. » Economic Journal, 109, (455), 266–291.
- Moyen M., Stähler N., et Winkler F., (2016), « Optimal Unemployment Insurance and International Risk Sharing » Finance and Economics Discussion Series 2016-054. Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System
- Mundell R. (1961) « A Theory of Optimum Currency Areas » American Economic Review, Vol. 51, No. 4 pp. 657-665
- Pasimeni, P (2015) « The economic rationale of an EMU fiscal capacity », Proceedings of the Oesterreichische Nationalbank Workshop “Towards a genuine economic and monetary union”, Vienna, September
- Schmieder, J.F. , von Wachter, T. , (2016), « The effects of unemployment insurance: new evidence and interpretation » Annual Review of Economics, 8, 547–581.
Notes
[1] Evidemment, on ne cite pas ici l’instrument budgétaire, puisque les politiques budgétaires sont principalement mises en place dans un cadre national, et ne visent nullement à la stabilisation européenne, tout du moins en l’état actuel de la construction européenne.
[2] Pour une analyse très complète de l’effet économique de l’allocation chômage, voir Cahuc et al. 2014) ou Schmieder et von Wachter (2016).
[3] Au delà d’un an, le chômeur serait intégralement pris en charge par l’assurance nationale (une logique plus séquentielle).
Stabiliser la zone euro : une nécessaire harmonisation des institutions des marchés du travail européens
La zone euro contient 19 pays membres, une seule monnaie, et par conséquent une politique monétaire unique. L’objectif d’une zone monétaire est de favoriser les échanges des biens, de services et de capitaux, notamment en réduisant les coûts de transactions liés aux risques de changes entre deux monnaies[1]. L’abandon de la souveraineté monétaire implique l’abandon d’un instrument de stabilisation macroéconomique[2]. Avec les seules politiques budgétaires nationales comme outils de stabilisation, une zone monétaire peut malgré tout espérer être « optimale », autrement dit être espérer une stabilisation macroéconomique rapide suite à un choc économique. Pour s’en rapprocher, une des deux conditions suivantes doit être remplie (Blanchard et al., 2013) :
- Etre soumise à des chocs symétriques (une politique monétaire commune est alors souhaitable).
- Etre soumise à des chocs asymétriques, mais être caractérisée par une forte mobilité des facteurs de production.
Les chocs ne sont malheureusement que rarement symétriques et bien que la mobilité des travailleurs existe, elle est trop lente pour compenser les chocs asymétriques (Beyer et Smets, 2015). La stabilisation macroéconomique est encore loin d’être une évidence en zone euro : les mécanismes de partage du risque actuels ne permettent que de lisser 30% des chocs, contrairement à plus de 75% aux Etats-Unis ou 80% en Allemagne (Furceri and Zdzienicka, 2015). Pour renforcer cette stabilisation, plusieurs projets sont sur la table et notamment la mise en place d’instruments budgétaires supranationaux : budget commun, assurance chômage européenne, entre autres.
Ces projets sont ambitieux et a priori efficaces (Clemens et Claveres, 2018). Cependant, leur efficacité pourrait être renforcée, ou les attentes placées en eux réduites, si les marchés du travail européens harmonisaient leurs institutions[3]. En effet, plusieurs travaux montrent que des institutions du marché du travail qui diffèrent entre pays impliquent des évolutions différentes des taux de chômage entre ces mêmes pays lorsqu’ils sont touchés par un choc macroéconomique similaire (exemple : choc pétrolier) (Blanchard et Wolfers, 2000, Bertola et al., 2007, Gnocchi et al., 2015, Murtin et Robin, 2018). Cette non-synchronisation des évolutions des taux de chômage rend la mission de stabilisation poursuivie par un éventuel instrument budgétaire supranational plus difficile à remplir. En effet, si les pays de la zone euro adoptaient des combinaisons d’institutions du marché du travail qui permettent de réduire la volatilité de leur taux de chômage, le travail de stabilisation demandé à l’assurance chômage européenne serait moindre : les mêmes objectifs seraient atteints en utilisant moins de ressources, ou autrement dit, une relance budgétaire d’initiative européenne porterait plus rapidement ses fruits.
Divergence des évolutions des taux de chômage dans la zone euro : l’hétérogénéité des institutions des marchés du travail responsable ?
Comme le montre le graphique ci-dessous, la non-synchronisation des évolutions des taux de chômage est une évidence en zone euro. 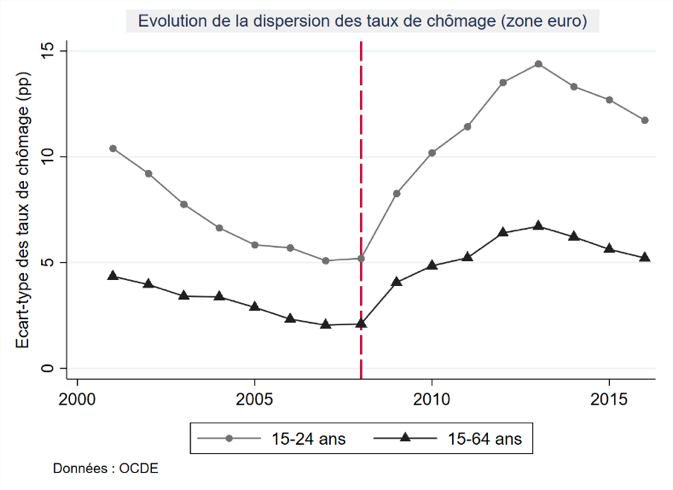
Ce graphique montre l’évolution de la dispersion des taux de chômage des pays de la zone euro en représentant l’écart-type[4] en points de pourcentages, pour le taux de chômage de l’ensemble de la population active (15-64 ans) et le taux de chômage des jeunes (population active jeune, 15-24 ans). La divergence des évolutions des taux de chômage des économies de la zone euro s’observe très nettement :
| Taux de chômage (zone euro) | 2008 | 2010 | 2013 |
| Moyenne en % (15-64 ans) | 6,8 | 10,2 | 11,9 |
| Ecart-type en % (15-64 ans) | 2,1 | 4,8 | 6,7 |
| Ecart-type en % (15-24 ans) | 5,2 | 10,2 | 14,4 |
L’ampleur de la divergence des évolutions des taux de chômage des 15-64 ans semble s’expliquer par la très forte divergence du chômage des jeunes, pour lequel l’écart-type atteint un niveau énorme de 14,4 points de pourcentages en 2013, alors qu’il ne s’élevait qu’à 5,2 au début de la crise.
Qu’est-ce qui explique cette divergence ? Boeri et Jimeno (2016) analysent l’évolution des taux de chômage des régions européennes NUTS-2[5] de l’UE-28 et montrent que les différences entre pays expliquent très majoritairement la dispersion des taux de chômage entre régions européennes : la divergence entre deux régions de pays différents est beaucoup plus forte qu’entre deux régions d’un même pays. Or, généralement, les institutions du marché du travail ne varient qu’entre pays et non entre les régions d’un même pays. Ce résultat témoigne de la vraisemblance de l’implication des institutions du marché du travail dans la divergence des taux de chômage des économies européennes. La comparaison France/Espagne en constitue une parfaite illustration. En 2007, le taux de chômage espagnol s’élevait à 8,2% et le taux français à 7,6%. En 2012, quatre ans après le début de la Grande Récession, le taux de chômage espagnol est passé à 24,8% et le taux français à 9,4%. Bentolila et al. (2012) montrent que cette divergence s’explique en grande partie par la législation très laxiste sur l’utilisation des contrats temporaires en Espagne comparativement à la France (les employeurs espagnols ont pu facilement détruire et ne pas renouveler de nombreux emplois temporaires). Les auteurs montrent que si l’Espagne avait eu une législation de protection de l’emploi similaire à celle de la France, elle aurait évité 45 % de la hausse de son chômage.
Afin d’être le plus exhaustif possible, un point est à souligner. Bien qu’elles aient leur part de responsabilité, les différences d’institutions n’expliquent pas à elles seules l’augmentation de la dispersion des taux de chômage. Boeri et Jimeno (2016), encore eux, montrent en estimant un coefficient d’Okun (variation en % du taux de chômage suite à une variation de 1% du PIB) pour l’UE-28 (+ Islande, Norvège et Etats-Unis) sur la période 2008-2013, qu’en moyenne 55 % de la dispersion est expliquée par des variations du PIB et donc par l’ampleur et la nature des chocs économiques.
Il semble donc raisonnable de conclure que les institutions du marché du travail des économies de la zone euro et leurs interactions avec la nature et l’ampleur des chocs économiques expliquent grandement les réactions différentes des marchés du travail suite à la crise financière de 2007 et la crise de la dette qui s’en est suive.
Quelles sont les institutions ou combinaisons d’institutions qui expliquent ces divergences ?
Les déterminants de la volatilité du taux de chômage commencent à être bien identifiés par la littérature économique. En effet, de nombreux travaux ont utilisé l’expérience de la Grande Récession (2008-2013) qu’a connue l’Union Européenne et les différentes réactions des marchés du travail de ses membres pour éclairer la question. La volatilité d’un taux de chômage s’explique par l’augmentation du différentiel entre les créations d’emplois et les destructions d’emplois : plus d’emplois sont détruits que d’emplois ne sont créés. Comme précisé dans la section précédente, les décisions d’un employeur de créer ou détruire des emplois face à un choc économique dépend, en partie, de l’environnement règlementaire et plus généralement institutionnel dans lequel son entreprise évolue. Face à un choc économique, l’entreprise doit, dans la plupart des cas[6], ajuster ses coûts. Elle peut le faire en ajustant le nombre d’emplois, c’est-à-dire en réduisant le nombre de ses emplois temporaires ou de ses emplois permanents. Ce mode d’ajustement correspond à de la ‘flexibilité externe’. Elle peut également le faire en ajustant le niveau des salaires ou le nombre d’heures travaillées. Ce mode d’ajustement permet de conserver les emplois en contrepartie d’un ajustement de leurs caractéristiques et correspond à de la ‘flexibilité interne’. L’ajustement ‘interne’ existe dans les pays qui permettent la négociation d’entreprise (Gnocchi et al., 2015) et qui n’étendent pas les accords collectifs aux non-signataires (Doris et al., 2015, Addison et al., 2015) et/ou qui ont mis en place la possibilité de recourir au chômage partiel (Cahuc et Carcillo, 2011, Boeri et Bruecker, 2011, Burda et Hunt, 2011, Cahuc et al. 2018). A l’inverse, l’ajustement ‘externe’ existe dans les économies sujettes à une forte rigidité des salaires nominaux liée à des négociations collectives rigides, des économies où la protection de l’emploi est très laxiste, ou encore des économies duales où la protection des emplois temporaires est très faible par rapport aux emplois permanents. Sans surprise, Boeri et Jimeno (2016), en exploitant des données d’enquêtes menées par la Banque Centrale Européenne et les banques centrales de l’eurozone[7] sur la manière dont les employeurs européens ont ajusté leurs coûts durant la période 2010-2013 (ajustements via l’emploi, les salaires, les heures travaillées, ou d’autres mécanismes), montrent que les pays avec une plus forte flexibilité interne ont eu des augmentations moins importantes du chômage que les pays avec une plus forte flexibilité externe.
Il est important de ne pas analyser chaque institution du marché du travail isolement, puisque c’est souvent leurs interactions entre elles-mêmes et avec les chocs économiques qui expliquent leur influence sur la dynamique du chômage. Comprendre la manière dont les institutions sont complémentaires permet de proposer des réformes du marché du travail pertinentes. Parlant de réformes du marché du travail qui ont permis une diminution du taux de chômage, Bassanini et Duval (2009) ont montré que le chômage est corrélé positivement avec des allocations chômage généreuses (montant et durée), des taxes élevées sur les salaires et une régulation stricte du marché des biens et services (anti-concurrentiel), et négativement corrélé avec des négociations collectives coordonnées[8]. Murtin et Robin (2018), plus récemment, ont analysé les effets des réformes du marché du travail sur la dynamique du chômage dans 9 pays de l’OCDE (Australie, France, Allemagne, Japon, Portugal, Espagne, Suède, Grande-Bretagne, USA). Ils montrent que les réformes d’institutions qui permettent les baisses les plus significatives du chômage sont celles qui améliorent les services de l’emploi (ex. Pôle-Emploi, en France) afin d’améliorer la formation des chômeurs et leur appariement avec les emplois vacants, et aussi, comme pour l’étude précédemment citée, la réduction de la générosité des allocations chômage et la dérégulation du marché des biens et services.
Comment inciter à l’harmonisation ?
L’expérience de la Grande Récession nous a permis mieux comprendre le rôle des institutions du marché du travail dans l’évolution du chômage. Nous avons une idée plus précise des combinaisons d’institutions qui permettent d’éviter une trop forte volatilité du taux de chômage lors de chocs économiques. Espérer mieux synchroniser les évolutions des taux de chômage des membres de la zone euro, tout en évitant de trop fortes hausses en cas de crise, passe nécessairement par l’adoption de ces combinaisons d’institutions.
C’est en partie ce qui a été fait en Grèce, Espagne, Italie et Grèce, sur demande de la Troïka (BCE, Commission Européenne et FMI) en échange de plans de sauvetage financiers. Ces réformes se sont principalement axées sur la modération salariale, la baisse de la rigueur de la protection de l’emploi, ou encore la hausse de l’âge de départ à la retraite. Concernant la rigueur de la protection de l’emploi, le graphique ci-dessous illustre parfaitement que les réformes ont été mises en place en période de récession : alors que la dispersion de l’indice de rigueur de la protection de l’emploi (sur les emplois permanents) entre les membres de la zone euro est stable sur la période 2001-2008, elle diminue fortement à partir de 2009-2012, preuve d’une convergence des législations nationales sur la protection de l’emploi.
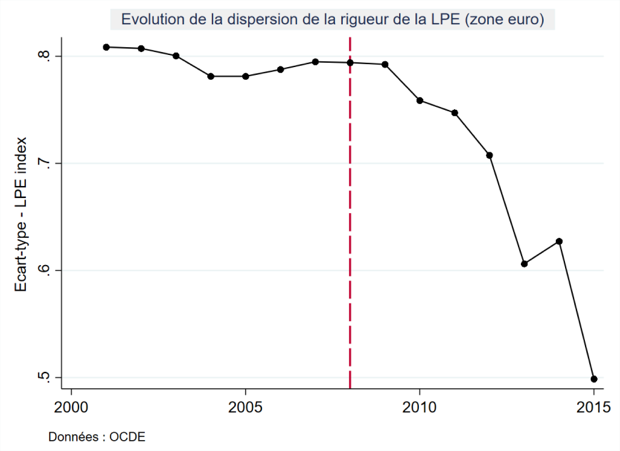
Cependant, les réformes institutionnelles menées en période de récession peuvent avoir plus d’effets négatifs que positifs. Pour exemple, reculer l’âge de départ à la retraite lorsque la dynamique des créations d’emplois est faible pénalise fortement l’emploi des jeunes. Ou encore, diminuer la protection des emplois permanents, dans ce même contexte de faiblesse de créations d’emplois, a tendance à plus augmenter les destructions d’emplois qu’à inciter à en créer. En période de crise, ce sont les réformes qui augmentent les dépenses publiques qui permettent une réduction des taux de chômage (chômage partiel, allocations chômage temporairement plus généreuses pour soutenir la consommation, etc.). C’est pourquoi les réformes institutionnelles doivent être menées hors périodes de récession, lorsque les conditions macroéconomiques sont bonnes. Pour cela, les dirigeants européens doivent inciter les membres de la zone euro à réformer leurs marchés du travail, non lors des périodes de crise jouant sur la menace de ne pas les soutenir financièrement, mais lors des périodes d’expansion via des mécanismes de conditionnalité « positive »(Boeri et Jimeno, 2016). L’idée serait d’aider au financement des institutions nationales existantes lors des périodes de récession, via des mécanismes budgétaires supranationaux (comme une assurance chômage européenne qui soutiendrait financièrement les assurances chômage nationales) si et seulement si le pays a mené, sur recommandations, des réformes institutionnelles en période d’expansion économique. Le mécanisme de soutien budgétaire supranational prenant le rôle « récompense », avec un fort effet incitatif.
L’argumentation générale de cette note prend la forme d’une boucle : une harmonisation des institutions du marché du travail des membres de la zone euro permettrait une meilleure efficacité des mécanismes budgétaires supranationaux, et l’accès à ces mécanismes budgétaires supranationaux peut être utilisé comme une incitation faite aux membres de la zone euro à harmoniser leurs institutions du marché du travail.
Références
- Addison, J. T., Portugal, P., & Vilares, H. (2015). Unions and Collective Bargaining in the Wake of the Great Recession(No. 8943). Institute for the Study of Labor (IZA).
- Bassanini, A., & Duval, R. (2009). Unemployment, institutions, and reform complementarities: re-assessing the aggregate evidence for OECD countries. Oxford Review of Economic Policy, 25(1), 40-59.
- Blanchard, O., & Johnson, D. R. (2013). Macroeconomics. Pearson.
- Blanchard, O., & Wolfers, J. (2000). The role of shocks and institutions in the rise of European unemployment: the aggregate evidence. The Economic Journal, 110(462), 1-33.
- Bentolila, S., Cahuc, P., Dolado, J. J., & Le Barbanchon, T. (2012). Two‐tier labour markets in the Great Recession: France versus Spain. The Economic Journal, 122(562), F155-F187.
- Bertola, G., Blau, F. D., & Kahn, L. M. (2007). Labor market institutions and demographic employment patterns. Journal of Population Economics, 20(4), 833-867.
- Beyer, R. C., & Smets, F. (2015). Labour market adjustments and migration in Europe and the United States: how different?. Economic policy, 30(84), 643-682.
- Boeri, T., & Bruecker, H. (2011). Short-time work benefits revisited: some lessons from the Great Recession. Economic Policy, 26(68), 697-765.
- Boeri, T., & Jimeno, J. F. (2016). Learning from the Great Divergence in unemployment in Europe during the crisis. Labour Economics, 41, 32-46.
- Burda, M. C., & Hunt, J. (2011). What explains the German labor market miracle in the Great Recession? (No. w17187). National bureau of economic research.
- Cahuc, P., & Carcillo, S. (2011). Is short-time work a good method to keep unemployment down?. Nordic Economic Policy Review, 1(1), 133-165.
- Cahuc, P., Kramarz, F., & Nevoux, S. (2018). When Short-Time Work Works (No. 11673). Institute for the Study of Labor (IZA).
- Doris, A., O’Neill, D., & Sweetman, O. (2015). Wage flexibility and the great recession: the response of the Irish labour market. IZA Journal of European Labor Studies, 4(1), 18.
- Clemens, M., & Claveres, G. (2018). Unemployment insurance union.
- Furceri, D., & Zdzienicka, A. (2015). The euro area crisis: need for a supranational fiscal risk sharing mechanism?. Open Economies Review,26(4), 683-710.
- Gnocchi, S., Lagerborg, A., & Pappa, E. (2015). Do labor market institutions matter for business cycles?. Journal of Economic Dynamics and Control, 51, 299-317.
- Murtin, F., & Robin, J. M. (2018). Labor market reforms and unemployment dynamics. Labour Economics.
- Plasman, R., & Rycx, F. (2001). Décentraliser ou coordonner les négociations salariales pour réduire le chômage. Reflets et perspectives de la vie économique, 40(1), 81-91.
Notes
[1]Exemple : avant l’adoption de l’euro, une entreprise française dont un des fournisseurs (de biens intermédiaires) était une entreprise allemande, courait le risque constant que la valeur du franc chute face au deutschemark, entrainant une hausse directe du coût des biens intermédiaires.
[2]Une politique monétaire expansionniste pouvait être mise en place pour stimuler les crédits accordés au secteur privé et ainsi stimuler l’activité économique. Inversement, une politique monétaire restrictive pouvait être mise en place afin de désinciter les banques commerciales à accorder des crédits à l’économie et ainsi modérer l’inflation et l’activité économique lorsque celles-ci croissent trop fortement et rapidement.
[3]Par institutions du marché du travail, il est entendu, entre autres, la législation sur la protection de l’emploi, l’organisation des négociations salariales, l’architecture du système d’assurance chômage, ou encore l’existence d’un salaire minimum.
[4]L’écart-type est une mesure statistique qui fait état de la dispersion de données. Plus l’écart-type d’une plage d’observations est élevé, plus les valeurs de ces observations sont dispersées. Et inversement. [5]Voir la nomenclature NUTS : https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/nuts/background [6]Lorsqu’une entreprise est largement profitable, elle peut décider de réduire ses profits pour ne pas devoir ajuster ses coûts. [7]Wage Dynamics Network (WDN) : https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-research/research-networks/html/researcher_wdn.en.html [8]Coordination des négociations collectives : « aptitude des signataires d’accords collectifs à coordonner leurs décisions horizontalement (au sein d’un même niveau de négociation) et verticalement (entre les différents niveaux de négociation). » (Plasman et Rycx, 2001)
La Migration comme une solution aux frictions du marché de travail en Europe ?
Le vieillissement de la population et la transition structurelle que connait le marché de travail, particulièrement avec l’émergence de nouveaux métiers nécessitant des nouvelles compétences exigent une profonde réflexion sur les politiques à adopter. Elles devraient inscrire l’offre du travail en parfaite adéquation avec les exigences du marché. Selon l’Organisation pour la coopération économique et de développement économiques (OCDE), entre 2013 et 2020, l’âge de la population active dans la région de l’OECD devrait croître de 2,2 %, alors qu’il connaîtra une baisse dans les mêmes proportions dans les pays de l’Union européenne. En l’absence de tout flux migratoire, cette baisse pourrait atteindre 3,5 % surtout en Allemagne, en Italie et Pologne. En dehors du problème démographique, l’Europe doit faire face aux déficits de compétences dans certains secteurs d’activité. La population active locale ne pourra en aucun cas répondre totalement aux nouvelles exigences du marché de travail. Quelle sont alors les solutions possibles pour contenir le vieillissement de la population active et le déficit de compétences ?
En dehors des solutions purement internes, la mobilité intra-européenne pourrait constituer une des solutions plausibles pour faire face à cette double friction sur le marché de travail. Cependant, ces solutions sont soumises à un ensemble de contraintes portant sur les spécificités des systèmes éducatifs et des structures du marché de chaque pays européen. A titre d’exemple, la stratégie de l’Allemagne s’articule autour de l’intra- mobilité EU en attirant des travailleurs qualifiés, tandis que l’Autriche, l’Irlande et Royaume-Uni mettent plutôt l’accent sur la formation professionnelle.
La plupart de ces pays sont touchés par ce double phénomène et il sera difficile d’établir un parfait appariement intra-européen entre l’ensemble des secteurs d’activités. La solution interne paraît plausible ; cependant, le contexte européen entaché par le vieillissement de la population et la baisse des compétences rend difficile la mise en pratique de cette orientation.
La migration pourrait jouer un rôle important pour satisfaire les besoins du marché du travail. Il est cependant important que les compétences des immigrés soit en parfaite adéquation avec les exigences du marché de travail en Europe. Ainsi, une identification sans faille des compétences exigées est nécessaire pour mieux évaluer les changements dans la composition de travailleurs qualifiés et ainsi cibler à court et à moyen terme la population immigrante. L’incompatibilité de compétence affecte plus de 40 % des entreprises de l’UE (l’enquête de compagnie européenne de 2013). En effet, selon le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP), la demande de travailleurs hautement qualifiés devrait considérablement augmenter dans l’UE 28, entre 2012 et 2025, alors que celle des travailleurs peu qualifiés connaîtra un net recul durant la même période, estimé à 24%. Toutefois, plusieurs études (Peschner et Fotakis, 2013) signalent qu’au-delà de 2030, les gains de productivité seront la seule source de croissance économique; il sera difficile de maintenir la croissance de l’emploi en Europe via un taux participation plus élevée et le taux d’emploi. Ce constat pourrait être appuyé par les informations reportées dans le tableau 1 indiquant que la baisse du nombre de travailleurs disponibles et/ou une hausse de la demande de travail constituent les principaux facteurs quantitatifs justifiant la pénurie de la main-d’oeuvre dans les pays européens.
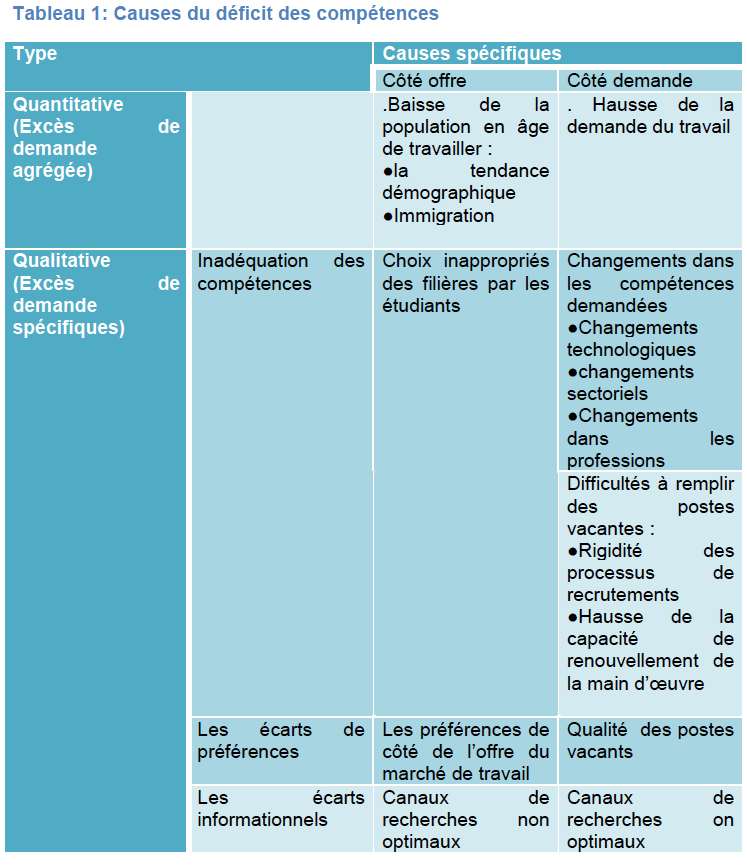
La circularité des flux migratoires par le biais des dispositions générales sur l’emploi des immigrants pourrait, à cet égard, être le meilleur modèle pour adapter l’immigration de la situation économique et les changements respectifs dans la demande, mais aussi de favoriser les liens économiques et personnels avec les pays d’origine.
