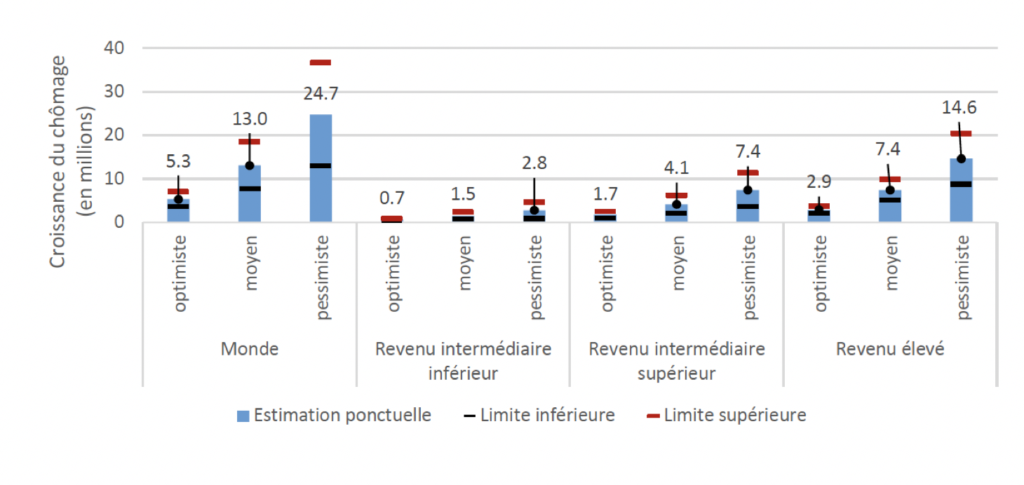Covid-19 : quelles conséquences et quelles politiques économiques ?
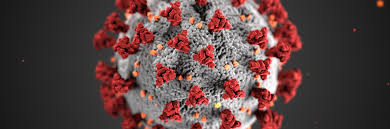
Covid-19 : Analyse des conséquences économiques
La crise sanitaire que nous traversons est sans aucun doute la plus rude depuis la seconde guerre mondiale, mettant à l’épreuve l’ensemble des économies de la planète. Il est bien entendu difficile d’analyser et d’annoncer clairement ce à quoi le monde fera face. De nombreux chercheurs sont mobilisés sur ce choc mondial et les hypothèses, prévisions ou propositions sont très nombreuses. Les économistes d’ERMEES (Equipe de Recherche en Macro-Economie Européenne de Strasbourg) proposent d’alimenter ce débat, et de vulgariser les enjeux économiques de cette crise sanitaire. La présentation de ce dossier s’articule de la manière suivante : elle débute par une analyse générale de la crise économique à très court terme (M. Sidiropoulos) ; puis ses effets sur le marché du travail et des biens et services notamment sur la consommation (T. Betti, F. De Palma, Y. Thommen) ; ces analyses mettront en évidence l’importance des politiques à mettre en oeuvre tant sur le plan monétaire que budgétaire (A. Barbier-Gauchard, M. Dai, S. Ligonniere et J. Saadaoui) ; ce dossier conclura sur les perspectives de long terme (A. Varoudakis). Bien que ce document traite et discute de questions économiques en se fondant sur une analyse pointue, un réel souci de vulgarisation a été pris en compte afin de s’adresser à un large public.
A toutes et tous, bonne lecture.
Francesco De Palma
De la pandémie du Covid-19 à une nouvelle crise économique : mécanismes de propagation et effets à court terme
La crise sanitaire que nous vivons sous le nom de pandémie du Covid-19 semble être différente de toutes celles que les générations précédentes ont pu connaître, elle est également d’une ampleur de conséquences économiques sans précédent dans l’histoire récente. La vitesse de propagation de cette pandémie, combinée à la mondialisation marquée par l’accélération de la circulation des personnes, est au cœur du processus de sa propagation et rend la crise actuelle tout à fait différente des autres.
En effet, trois mois seulement après le début de cette crise sanitaire, près de la moitié de la population de la planète est appelé au confinement. Ainsi, une très grande partie de la population mondiale étant assignée à résidence alors qu’un large éventail d’activités économiques est actuellement en suspens, la crise actuelle ne ressemble que très partiellement aux précédentes crises économiques et financières et, en particulier, celle de 2008-2009.
La crise économique actuelle trouve son origine, à la fois, dans un choc du côté de l’offre et un choc du côté de la demande de l’économie, créant ainsi les conditions d’une très grande crise économique. Dans son rapport sur les perspectives mondiales (1), le FMI parle des chocs les plus durs portés à l’économie mondiale depuis la Grande Dépression des années 30. Dans quelles conditions une telle estimation pourrait-elle se révéler exacte et que faut-il faire pour éviter un tel « scénario catastrophe » ? Mal gérée, cette crise pourrait-elle être encore plus durable et avec un coût beaucoup plus important ?
Le choc du côté de l’offre
Un arrêt soudain comme celui du confinement peut facilement déclencher une chaîne d’événements en cascade, alimentés par des décisions des acteurs économiques (ménages, entreprises, fournisseurs, banques et intermédiaires financiers…) dont les décisions s’insèrent soit du côté de l’offre, soit du côté de la demande de l’économie.
Du côté de l’offre d’abord, le choc de cette crise sanitaire entraînera une vague massive de licenciements des entreprises qui vont réduire leurs effectifs et d’autres qui vont fermer. Ces emplois-là seront perdus, sans doute pour assez longtemps, ce qui provoquera une baisse générale du revenu disponible pour les salariés comme pour les indépendants. Même si le travail à domicile est une option, l’interruption à court terme du travail est majeure, et risque d’affecter la productivité. Avec une partie de la force de travail des ménages confinée pour une durée indéfinie, il est inévitable que la production des entreprises chute. Par conséquent, du côté de l’offre de l’économie, les mesures de confinement vont réduire l’activité économique et la production.Et, comme un certain nombre d’économistes l’ont souligné, la majeure partie de cette production perdue ne reviendra pas.
Si l’on saisit ces effets sur la production par secteur d’activité (Tableau 1), on voit que tous les secteurs sont touchés, avec pour plusieurs des conséquences graves. Cette crise concerne d’abord le tourisme (presque partout), les compagnies de transport aérien, la restauration et les loisirs dans la plupart des pays développés,ainsi qu’une très grande partie de l’activité commerciale. La baisse de l’activité dans ces secteurs conduit également à la réduction des effectifs d’autres industries qui dépendent de ces activités. Le secteur de la construction sera également en déclin, car une grande partie de l’activité de construction dépend de la dynamique des secteurs du tourisme et des loisirs (2).
Tableau 1: Les secteurs les plus touchés : vues préliminaires basées sur le cas de base
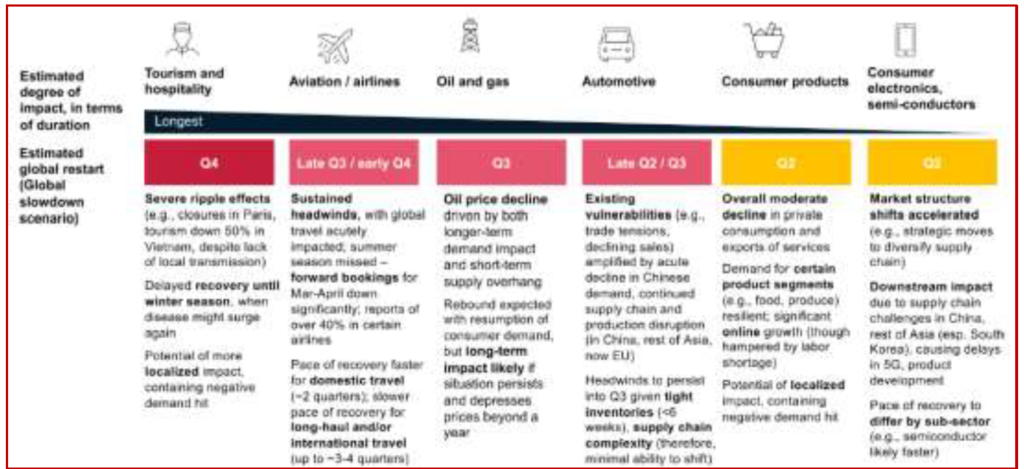
Source: IHS Market: McKinsey Global Institute Analysis: Subject matter experts: Press reports
Par ailleurs, les consommations jugées non indispensables et celles qui sont rendues impossibles par le confinement seront reportées. Ainsi, les industries produisant ces biens de consommation seront en déclin, puisque, par exemple, les consommateurs doivent continuer à dépenser pour leur nourriture, mais pas forcément pour leur habillement et leurs loisirs.
Enfin, les chaînes mondiales d’approvisionnement seront également affectées par la mise en arrêt des productions des consommations intermédiaires en créant à leur tour des difficultés de production des produits finaux. Cela redouble les chocs que reçoit la production, même lorsque certaines unités de fabrication sont exclues des interdictions.
Le choc du côté de la demande
Quant aux chocs du côté de la demande, ils ont évidemment plusieurs causes qui se cumulent. Tout d’abord, les ménages confinés ont, forcément, moins d’occasions de dépenser. De plus, face aux incertitudes sur les perspectives économiques futures, une impulsion commune pourrait être de réduire encore les dépenses. Et, comme « mes dépenses sont vos revenus », la demande faiblit encore. Ce sont alors les revenus disponibles d’une partie de la population qui disparaissent.
Les travailleurs qui perdent leur emploi à la fermeture les entreprises n’ont pas de revenus, ils ont donc une consommation plus faible et éventuellement diminuent leur demande de biens. En effet, face à la baisse de la demande pour leurs produits, les entreprises (surtout, dans certains secteurs tels que les loisirs, les voyages ou les divertissements, où la demande s’effondrera probablement presque dans son intégralité) voudront réduire leurs coûts, licencier des travailleurs pour éviter un effondrement complet, entraînant ainsi une baisse du revenu disponible et de la demande globale.
Par ailleurs, et toujours du côté de la demande de l’économie, dans un tel paysage de crise, les décisions d’investissement par les entreprises, face aux incertitudes sur les perspectives économiques futures, seront constamment reportées, jusqu’à ce que le paysage soit clarifié. Dans un tel contexte, le marché immobilier serait également durement affecté. Il s’agit bien évidemment du cycle bien connu de la récession qui se dessine.
Cependant, la pandémie du Covid-19 ne constitue pas uniquement un grand choc sur les variables économiques réelles du côté de la demande, mais c’est aussi un choc sur le fonctionnement des marchés financiers de l’économie. Ainsi, à l’analyse précédente, s’ajoute également l’influence des actifs financiers.
Figure 1. L’impact sur les marchés boursiers : forte baisse des marchés début 2020.
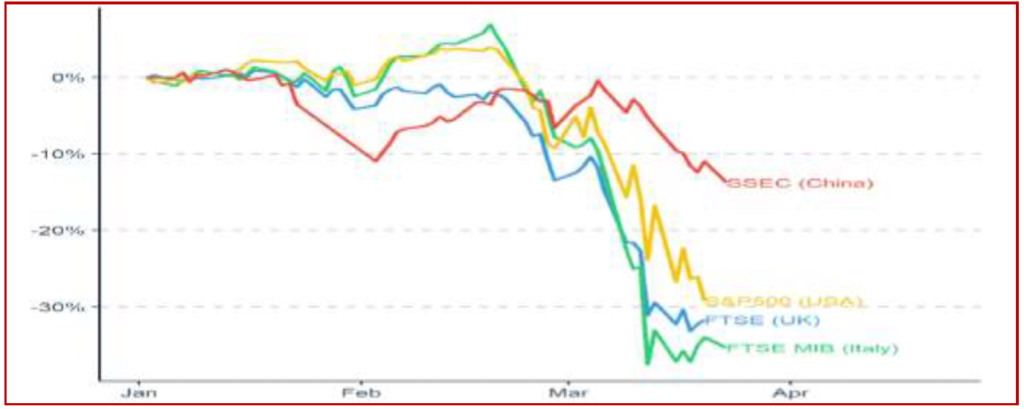
Dernière mise à jour: 2020-03-23 Source: Yahoo Finance.
Dans une récession classique, la gestion la plus sage des actifs financiers consiste à attendre le retour à la normale si, pour une raison ou pour une autre, on n’est pas obligé de vendre. Dans cette crise, le retour à la normale ne se fera pas comme avant. Les prix de certains actifs financiers vont tomber à zéro parce que les entreprises qu’ils représentent vont fermer en proportion plus grande que dans les crises antérieures. Ainsi, la gestion des actifs financiers renvoie à des comportements de précaution qui réduisent encore plus la demande globale.
Avec un portefeuille de prêts non performants qui se détériore, les banques voudront naturellement réduire leurs prêts, décourageant davantage encore les perspectives du secteur non financier. Ainsi, la perte de confiance, ou la « panique », amplifie l’effet initial. Il en résulterait des défaillances d’entreprises en cascade, avec une accumulation de fragilités financières.
Les effets de la crise à court terme
C’est la simultanéité des chocs d’offre et de demande qui rend la situation présente de la crise sanitaire si exceptionnelle et si dangereuse à court terme. De nombreux économistes suggèrent que l’impact du choc de la demande sera plus important que celui de l’offre (3). Dans un tel contexte, nous pouvons illustrer graphiquement deux scénarios possibles des courbes d’offre (AS) et de demande globale (AD) (cf. Figure 2). A partir du point 1 d’équilibre initial, un choc de demande déplace AD1 en AD2, sans doute plus largement qu’un choc d’offre, qui déplace AS1 en AS2. On voit ainsi comment il n’est pas possible d’éviter à court terme une partie des pertes de production, car l’équilibre s’établit maintenant au point 2. Par ailleurs, on voit également comment ces dommages peuvent être limités par une politique appropriée du côté de la demande, pour arriver ainsi à un nouvel équilibre qui s’établit ainsi au point 3.
En outre, le risque de ne rien faire (c’est-à-dire de ne pas appliquer une politique appropriée du côté de la demande) peut considérablement aggraver la situation. Non compensée par des mesures de soutien, la baisse de la demande va créer un deuxième choc sur l’offre (déplaçant davantage AS2 en AS3), et ainsi de suite. La spirale déflationniste est alors en marche, avec ses conséquences néfastes.
Lorsque l’équilibre s’établit au point 2, la perte de production sera alors Y1 – Y2 et la baisse de l’inflation (des prix) sera π1 – π 2. Une baisse des prix et de la production, simultanément, c’est la récession. Des mesures de soutien de la demande peuvent nous ramener, sinon sur la courbe de demande initiale (AD1), au plus proche d’elle (déplaçant AD2 en AD3). Un nouvel équilibre s’établit alors au point 3, avec une perte d’activité et d’emploi plus faible (Y1 –Y3).
Bien évidemment, les mesures de soutien de la demande ci-dessus ne joueront à plein que lorsque le confinement sera progressivement levé, permettant à la production de repartir. Mais il faut que ces mesures soient à l’œuvre tout de suite, d’une part, pour être en place le moment venu et, d’autre part, pour combattre le pessimisme des consommateurs, qui ne peut que les pousser à thésauriser, ce qui est l’inverse de ce qui est souhaitable ici. L’inflation en π 3 > π 1 traduit l’effet inflationniste de mesures de relance avec une offre peu élastique.
Figure 2 : Les effets des chocs d’offre et de la demande de la crise du Covid-19
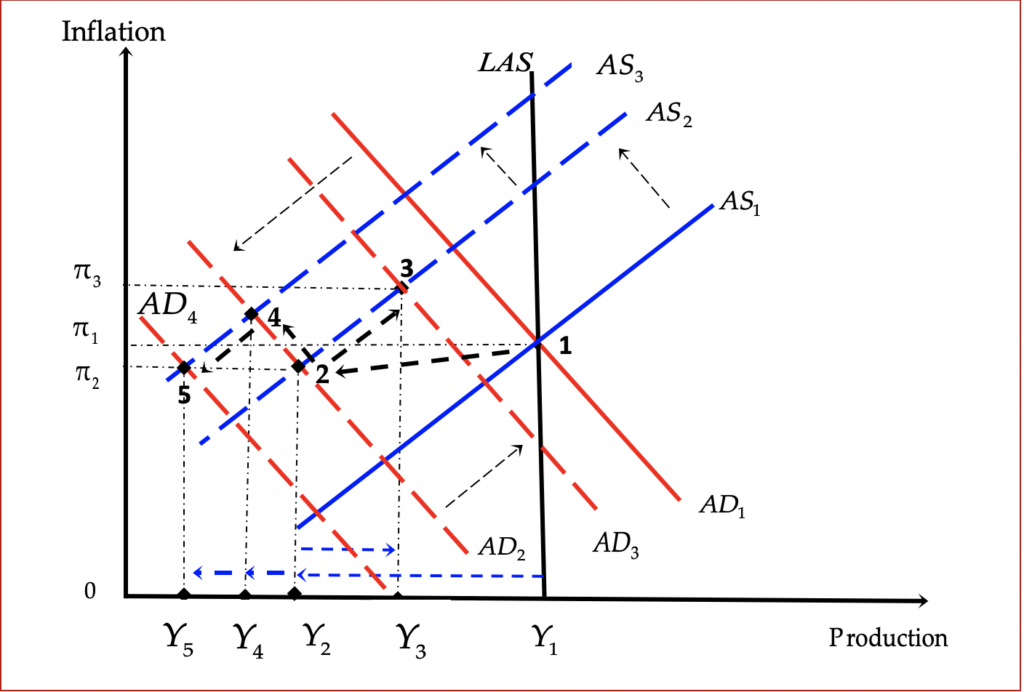
De plus, si elle n’est pas accompagnée (compensée) par des mesures de soutien du côté de la demande, la baisse initiale de la demande va créer un deuxième choc sur l’offre (déplaçant AS2 en AS3) et sur la demande (déplaçant AD2 en AD4), à travers diverses rétroactions négatives et mécanismes d’amplification de la crise, du côté de l’offre globale et du côté de la demande globale. Un nouvel équilibre s’établit alors d’abord au point 4, et ensuite au point 5, avec une perte d’activité (égale à Y1 – Y5) et une perte d’emploi beaucoup plus forte qu’avant. Par conséquent, la perte de production et d’emploi, entre Y1 et Y3 ou entre Y1 et Y5 , est inévitable à court terme (4). Elle représente la production perdue lors d’une récession forte et intense, amplifiée par les décisions économiques de millions d’agents économiques qui essaient de se protéger en réduisant leurs dépenses, la mise à l’écart d’investissements, la réduction du crédit et la réticence générale.
Enfin, la comparaison des effets de ces deux scénarios élaborés théoriquement ci-dessus correspond au «problème d’aplatissement de la courbe de récession», suggéré par l’étude de Pierre-Olivier Gourinchas (5) et illustré dans la Figure 3 :
Figure 3: L’aplatissement de la courbe de récession
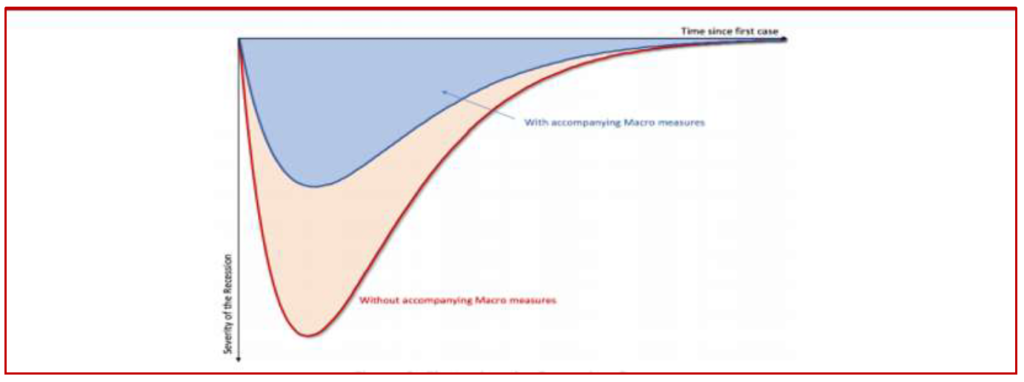
Source : Gourinchas (2020)
En effet, sans un soutien macroéconomique adéquat, l’impact récessionniste de la crise sanitaire pourrait être représenté par la courbe rouge de la Figure 2. La zone ombrée en bleu représente notre premier scénario (passage de l’économie de 1 → 2 → 3), dans lequel la perte d’activité économique est limitée à la production perdue pendant la période de confinement grâce à des mesures de soutien du côté de la demande. L’ensemble de la zone délimitée par la ligne rouge représente notre deuxième scénario (passage de 1 → 2 → 4→ 5). Dans ce scénario, la perte supplémentaire d’activité économique (ombrée en orange) se produit à cause du manque de mesures de soutien du côté de la demande, et des diverses rétroactions négatives et mécanismes d’amplification de la crise du côté de l’offre globale et du côté de la demande globale.
Les effets des deux scénarios ci-dessus seront déterminés par des paramètres tels que : la durée de la crise du Covid-19, l’ampleur des changements des habitudes de consommation des individus, et la rapidité et l’envergure des mesures de politique de soutien décidées par les gouvernements.
Les économistes de l’OCDE ont essayé d’évaluer l’ampleur de l’impact à court terme sur les pays développés (6). Les hypothèses de travail qu’ils ont adoptées conduisent à un impact négatif direct sur la production industrielle de chaque pays de 20% à 25%, et une baisse jusqu’à 30% de la consommation privée. La baisse totale du PIB devrait être estimée à environ 2% pour chaque mois où des mesures restrictives strictes sont appliquées et où aucune mesure n’est prise pour la compenser. Cela signifierait qu’un confinement de trois mois, par exemple, équivaudrait à une baisse annuelle du PIB de 5 à 6%. Et ce ne sont là que quelques-uns des effets directs, car il y a également des effets indirects qui alourdissent la récession en augmentant ce dernier chiffre.
Selon les estimations du FMI, le taux de récession de l’économie mondiale sera de – 4,2% en 2020, avant de rebondir de +4,6% en 2021, dans l’hypothèse d’une amélioration de la situation sur le front de la crise sanitaire consistant en un recul au second semestre de 2020. Dans son rapport sur les perspectives mondiales (7), le FMI parle du coup le plus dur porté à l’économie mondiale depuis la Grande Dépression des années 30, et à en croire le FMI : « Nous n’avons jamais vu l’économie mondiale s’arrêter net ». Aux États-Unis, il n’aura fallu que quinze jours pour que près de 10 millions d’Américains se retrouvent au chômage. En Europe, 900 000 Espagnols ont déjà perdu leur emploi. En France, l’INSEE estime qu’un mois de confinement devrait nous coûter 3 points de PIB.
Par ailleurs, cette évolution sera particulièrement défavorable pour les pays de la zone euro et, en particulier, les pays du Sud de l’Europe, qui ont déjà subi les effets de la crise en 2010, et dont la dette reste particulièrement élevée. Une nouvelle augmentation de leur dette remettra en question sa soutenabilité et pourrait entraîner ces pays dans une nouvelle crise de la dette.
Ainsi, pour les économies les plus fragiles de l’U.E, la pandémie s’annonce catastrophique. Pour la Grèce, le FMI voit son PIB reculer de 10% cette année et sa croissance, en 2021, serait éventuellement de 5,1%. Il est à noter que le FMI voit également un coup plus dur pour la Grèce que pour les autres économies du Sud, comme l’Espagne et l’Italie, pour lesquelles il anticipe une récession de 8% et 9% respectivement. Toutefois, il estime que leur rythme de croissance sera légèrement plus lent l’année prochaine (4,3% et 4,8% respectivement). Sur le front du chômage, il voit une augmentation de 22,3% cette année contre 17,3% en 2019, et une légère baisse, puis à 19% en 2021. Enfin pour l’Espagne, qui a le deuxième taux de chômage le plus élevé dans l’UE, il voit une augmentation de 14% à 20,8% cette année, et une baisse à 17,5% l’année prochaine.
Conclusion
Les mécanismes de court terme passés en revue dans ce chapitre impliquent qu’une récession mondiale profonde semble inévitable dans la courte période. Un coût macroéconomique majeur est associé à la stratégie de confinement pour résoudre la crise sanitaire. Le confinement, l’incertitude, et les paniques pour les ménages et les entreprises sont la clé d’une forte baisse du côté de la demande et du côté de l’offre. Le confinement et la forte baisse de la demande conduit à une augmentation de licenciements, créant une forte hausse du chômage et une nouvelle baisse de la demande de consommation et des investissements, ce qui oblige donc les entreprises à cesser leur activité. Les revenus du travail baissent de manière significative, et les prêts non performants augmentent, ce qui affaiblit la demande et accroît encore l’incertitude. Ainsi, dépenses publiques dans le secteur de la santé publique, allégements fiscaux, réductions d’impôt, exonérations fiscales, revenu universel temporaire pour les ménages, subventions aux entreprises, baisse des taux d’intérêt et programmes d’assouplissement quantitatif de façon à ce que les entreprises disposent suffisamment de liquidités et puissent éviter la faillite, sont des initiatives de politiques audacieuses pour contenir la récession imminente. Dans l’ensemble, les effets sur la demande sont probablement beaucoup plus importants que le choc initial d’offre. La bonne combinaison commence par une politique de santé publique pour limiter la « contagion humaine ». Les politiques fiscales et financières devraient alors être conçues pour accompagner le choc qui en résulte pour notre système économique et prévenir la « contagion économique », tout en soutenant le système financier pour éviter que la crise sanitaire ne devienne une crise financière.
Notes
- IMF, World Economic Outlook, April 2020, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
- Paolo Surico et Andrea Galeotti, « The economics of a pandemic: the case of Covid-19 », London School of Economics, 2020, p. 60
- Dominique Strauss-Kahn, « L’être, l’avoir et le pouvoir dans la crise », à paraitre dans la revue Politique Internationale (numéro de printemps). avril 2020.
- Paolo Surico et Andrea Galeotti, « The economics of a pandemic: the case of Covid-19 », London School of Economics, 2020, p. 70-75
- Pierre-Olivier Gourinchas PO. (2020), ‘Flattening the Pandemic and Recession Curves’ in Baldwin R. & Weder di Mauro B. (eds.), Mitigating the COVID Economic Crisis , London: CEPR Press
- Coronavirus (COVID-19) : Des actions conjointes pour gagner la guerre, OCDE, 20/03/2020
- IMF, World Economic Outlook, April 2020, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
Le marché du travail face à la crise du Covid-19
Les économistes sont en pleine réflexion pour savoir si le choc économique résultant de la pandémie du Covid-19 est un choc de demande, un choc d’offre, une combinaison des deux, ou bien simplement une disparition temporaire de l’offre et de la demande[1]. Quoiqu’il en soit, de nombreuses entreprises ne produisent plus et donc ne vendent plus de biens et services. Dans un point de conjoncture du 23 avril 2020, l’INSEE estime que l’activité économique est en baisse de 35% par rapport “à la normale”. Certaines branches d’activité connaissent une perte d’activité particulièrement marquée, comme la construction (-79%) et le transport (-63%) alors que d’autres sont quasiment à l’arrêt comme l’hébergement et la restauration (-91%). En conséquence, dans ces secteurs, la force de travail est devenue temporairement inutile et de nombreux employés ne travaillent plus. Une récente enquête de la DARES auprès des entreprises françaises (de 10 salariés ou plus) fait état, fin mars, d’un salarié sur deux exerçant dans une entreprises dont l’activité est à l’arrêt, ou du moins fortement ralentie. Ce chiffre représente la situation en France, mais il est probable que la situation soit similaire dans l’ensemble des pays ayant appliqué des mesures strictes de distanciation sociale.
Aux Etats-Unis, des estimations, pour l’instant non officielles, font écho d’un taux de chômage de 13% pour le mois d’avril 2020. En février, ce même taux de chômage avait atteint son plus bas niveau depuis la Grande Récession, soit 3,5%. La hausse est conséquente, mais ce qui est le plus impressionnant est qu’elle a eu lieu en trois semaines seulement : que ce soit à cause de la crise sanitaire ou non, ce sont plus de 26 millions d’individus qui se sont inscrits à l’assurance chômage depuis mi-mars[2], soit environ 3000% de plus par rapport aux mêmes cinq semaines l’année dernière. En France, ce sont 389 398 nouvelles inscriptions à pôle emploi entre le 15 mars et le 11 avril[3], soit 12,5% de plus par rapport aux mêmes quatre semaines l’année dernière, en 2019. La divergence des dynamiques d’inscription au chômage entre la France et les Etats-Unis est frappante. Cette note résume quelques-unes des explications possibles, en passant par la comparaison France – Etats-Unis jusqu’à élargir la discussion à d’autres pays européens et l’utilisation de l’assurance chômage comme amortisseur des chocs en général. En effet, même dans les pays où l’Etat Providence est assez peu développé, des mesures exceptionnelles ont été mises en place.
France versus Etats-Unis : le choix de l’ajustement intensif (interne) versus extensif (externe)
Commençons par éclaircir le contraste France – Etats-Unis.
Que se passe-t-il sur le marché du travail français ? Comment les entreprises ajustent-elles leur main-d’oeuvre face à cette crise ? La DARES, toujours grâce à son enquête, rapporte que seulement 11% des salariés travaillent dans une entreprise où les effectifs ont diminué. Et lorsque ces effectifs ont diminué, l’ajustement s’est très rarement réalisé par des licenciements ou des ruptures conventionnelles, qui ont été très peu utilisés (environ 6%). La très large majorité des ajustements de main-d’oeuvre sont temporaires : report des embauches ou non-renouvellement de CDD. Cela a en partie été possible grâce à l’extension du mécanisme d’activité partielle, ou plus communément appelé “chômage partiel” ou “chômage technique”.
Le 25 mars 2020, un décret[4] a été publié en France pour favoriser le recours à l’activité partielle. Le mode de calcul de l’allocation versée par l’Etat a été revu en faveur des employeurs, pour que ces derniers soient plus enclins à recourir au dispositif et ainsi limiter les destructions d’emplois. Plus précisément, l’Etat supprime tout reste à charge pour les employeurs pour les salaires inférieurs à 4,5 SMIC. En pratique, l’employeur qui fait appel à ce dispositif doit verser à son salarié un montant équivalent à 70 % de son salaire brut par heure non travaillée (chômée), soit de 84% de son salaire net horaire. Les montants avancés sont ensuite remboursés par l’Etat. Il est à noter que la France, contrairement à d’autres pays européens, a rendu les emplois précaires éligibles au système de chômage partiel, à savoir les CDD et les emplois intérimaires.
En France, environ 1 salarié sur 3 est en chômage partiel, soit un peu plus de 10 millions de personnes. Ce sont 821 000 entreprises qui sont concernées, avec une surreprésentation (environ 60%) des entreprises de moins de 50 salariés parmi celles-ci. Au total, au 21 avril 2020, ceci correspond à 4,3 milliards d’heures chômées demandées, soit 421 heures par travailleur en moyenne[5]. Ce recours massif au dispositif de chômage partiel pour sauvegarder leurs emplois a été encouragé par la large communication mise en place par le ministère du travail. Cette communication intense est bienvenue. En effet, Nevoux, S. (2019) explique que la proximité géographique a joué un rôle important dans le recours au dispositif entre 2002 et 2014 : la probabilité qu’une entreprise ait recours au dispositif était plus grande si une entreprise voisine y a eu recours, de par la diffusion de l’information localement. Il était donc nécessaire de communiquer largement pour diffuser l’information à toutes les entreprises.
Que se passe-t-il sur le marché du travail américain ? La hausse exceptionnelle des inscriptions au chômage a certainement été catalysée par les ajustements du système d’assurance chômage et de sa générosité en réponse à la crise. Aux Etats-Unis, l’assurance chômage est géré par chaque Etat, qui décide notamment des critères d’éligibilité (i.e. les conditions à remplir pour avoir le droit de bénéficier des allocations chômage). La loi fédérale a été amendée pour permettre plus de souplesse aux Etats afin d’ajuster les critères d’éligibilité en réponse à la crise sanitaire. Entre autres, deviennent éligibles à l’assurance chômage, les travailleurs dont l’employeur cesse temporairement son activité en raison de la pandémie, les travailleurs auxquels la quarantaine a été imposée, les travailleurs qui démissionnent de leur emploi à cause d’un risque d’exposition au virus trop important ou pour s’occuper d’un membre de leur famille[6]. De plus, le système a été rendu plus réactif en réduisant d’une semaine la période d’attente avant de recevoir les allocations.
Autrement dit, au contraire de la France, les Etats-Unis n’ont pas opté pour le dispositif de chômage partiel permettant de limiter le nombre de destructions d’emplois mais ont considérablement augmenté la protection des travailleurs perdant leur emploi. Ils ont privilégié l’ajustement de main d’oeuvre extensif (destructions d’emplois) à l’ajustement intensif(diminution des heures travaillées).
Le dispositif d’activité partielle pour contrer les effets néfastes de la pandémie sur le marché du travail : une bonne idée ?
Même s’il faudra attendre un peu pour évaluer rigoureusement les effets du dispositif d’activité partielle durant la crise du Covid-19, la réponse à cette question est très certainement “oui”. Cette réponse par la positive est en grande partie influencée par l’expérience passée, notamment celle liée à la Grande Récession débutée en 2008.
Du point de vue théorique, le rôle d’un système d’activité partielle est d’inciter les entreprises subissant un choc à recourir à un ajustement de main d’oeuvre “intensif” et non “extensif”, c’est-à-dire réduire les heures travaillées et payées (par l’entreprise) des salariés plutôt que de les licencier, tout en garantissant un revenu proche du salaire habituel à ces mêmes salariés. In fine, cela permet de maintenir le capital humain dans les entreprises – les entreprises peuvent conserver des travailleurs qu’elles ont formés et qui possèdent des compétences clés – et facilite une reprise rapide à la fin de la crise.
Du point de vue empirique, même si le dispositif d’activité partielle existait dans beaucoup de pays européens lorsque la Grande Récession a commencé, son utilisation n’a été massive qu’en Italie et en Allemagne, où environ 3% de la main-d’oeuvre étaient concernés. Son utilisation semble avoir eu un effet positif sur l’emploi en en limitant les pertes (Balleer et al. 2016) et notamment concernant les emplois stables de type CDI (Hijzen et Venn, 2011). Cependant, il est possible que cet effet positif se soit limité à la période de récession en retardant les licenciements, puisque Hijzen et Martin (2013)montrent que le dispositif aurait finalement eu un effet neutre.
Le dispositif d’activité partielle a fait ses preuves par le passé et semble donc être une bonne option pour sauvegarder des emplois durant une période de forte récession. Cependant, comme souvent, les systèmes présentent des effets pervers qu’il faut identifier pour être complet. Comme précisé par Cahuc (2019), le système d’activité partielle peut exclure du marché du travail les travailleurs indépendants et ceux qui recherchent un emploi à temps partiel. Cet effet ne semble pas être crucial dans la crise actuelle, puisque le nombre d’heures travaillées n’est pas réduit mais souvent égal à zéro. Un autre effet pervers est celui du ralentissement de la réallocation de main-d’oeuvre vers les secteurs de l’économie les plus productifs, où la demande de travail est relativement supérieure. Par exemple, un travailleur qui perdrait son emploi dans le secteur de l’hôtellerie pour cause de non-existence d’un dispositif de chômage partiel, pourrait trouver un emploi dans un secteur en demande de main-d’oeuvre, comme celui de l’agriculture, où il deviendrait alors productif.
Au-delà de ces effets pervers théoriques, l’expérience de la Grande Récession a permis de pointer l’existence d’inefficience dans le système d’activité partielle. C’est ce que montrent Boeri et Bruecker (2011), qui notent qu’il y a eu moins d’emplois sauvés que d’emplois concernés par l’activité partielle dans plusieurs pays. Pour aller plus loin, Cahuc et Nevoux (2017) et Cahuc et al. (2018) ont montré que le mécanisme d’activité partielle a surtout été utile aux entreprises faisant face à un choc négatif sévère et lorsque ces dernières ont un accès au crédit limité. En effet, s’il est utilisé par des entreprises qui ne subissent qu’une baisse modérée du chiffre d’affaire, ces dernières ont tendance à réduire le nombre d’heures travaillées de manière inefficace, menant à une baisse de la production agrégée de l’économie. Néanmoins, pour faire le parallèle avec le choc lié au Covid-19 et l’ampleur de la récession qui l’accompagne, nous pouvons penser que le dispositif est a priori efficace.
Enfin, et ce sera le dernier point critique souligné, il ne faudrait pas que l’utilisation large de ce dispositif, qui permet effectivement de largement limiter le nombre de destructions d’emplois, nous fasse perdre de vue que l’évolution du taux de chômage est la résultante du flux d’emplois détruits mais aussi du flux d’emplois créés. Or, comme alertent Christian Merkl et Enzo Weber dans une note[7], peu d’accent est mis pour l’instant sur le soutien aux créations d’emplois.
Et les autres pays européens ?
Qu’en-est-il des dispositifs mis en place par les pays européens ? Le tableau ci-dessous en présente un bref résumé. En plus du soutien fiscal aux entreprises via le report des charges fiscales, qui a été mis en place dans la quasi-totalité des pays, voici quelques réponses de pays européens pour soutenir les travailleurs (au 15 avril 2020) :
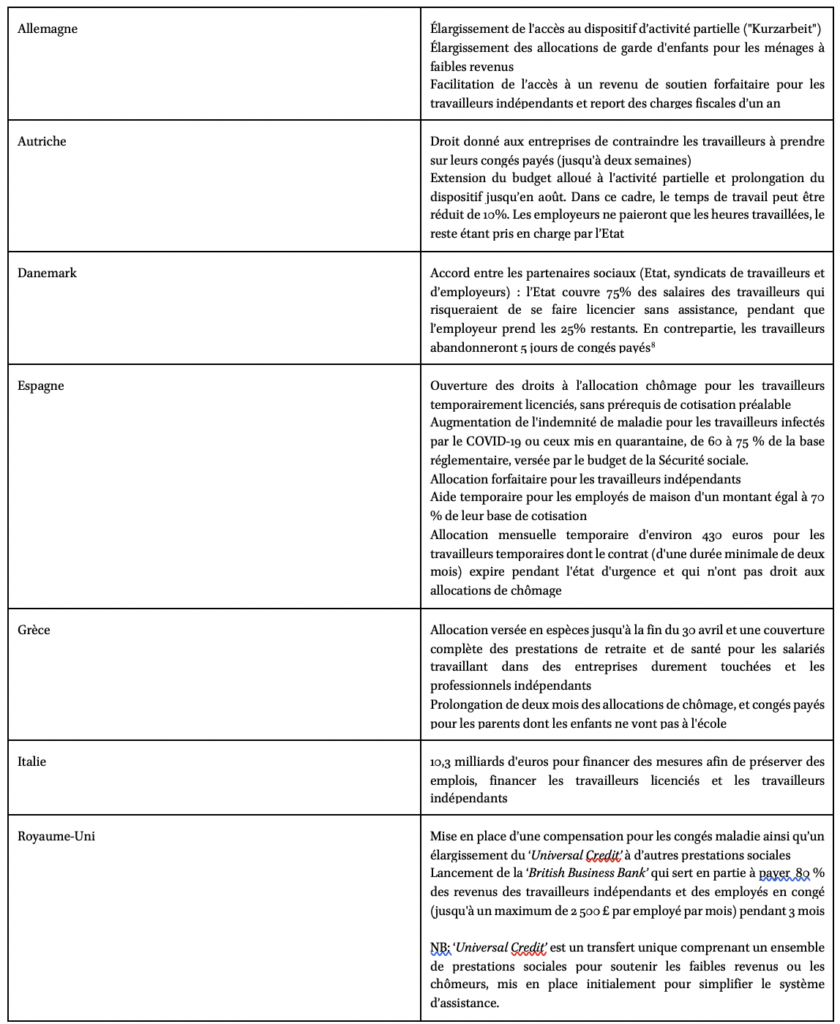
Source : les informations ont été recueillies sur le site du FMI, dans la section ‘Policy responses to Covid-19’.
En plus de faciliter la sauvegarde des emplois des travailleurs, d’autres sujets doivent être mis sur la table : soutenir financièrement les indépendants, faciliter le congé maladie, assurer un revenu aux personnes en quarantaine, entre autres. Une liste de propositions a été établie par l’OCDE[9].
Pourquoi les augmentations de la générosité des systèmes d’assurance chômage ne seront probablement que temporaires ?
L’assurance chômage est un stabilisateur macroéconomique : elle permet d’assurer le niveau de consommation des individus qui perdent leur emploi et ainsi permet de stabiliser la demande agrégée d’une économie en période de récession. C’est pour cette raison qu’en réponse à la Grande Récession, la générosité de l’assurance chômage a été augmentée dans de nombreux pays. Ce surplus de générosité s’est surtout caractérisé par un allègement des critères d’éligibilité, puisque la durée du versement des prestations a été diminuée à partir de 2010 dans de nombreux pays (Turrini, et al., 2015). Cependant, les mesures n’ont souvent été que temporaires et la générosité des différents systèmes nationaux étaient toujours hétérogène pour les pays de l’UE en 2018, comme l’illustre le schéma ci-dessous.
Répartition des systèmes de chômage de l’UE-28 selon des critères de générosité en 2018
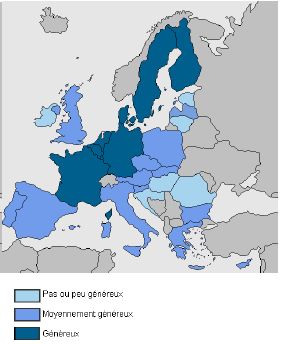
Chauveau et Kyrylesku (2019) à partir des données MISSOC et Eurofound.
Pourquoi de nombreux pays décident de ne pas conserver une assurance chômage généreuse en temps normal ? Au-delà des quelques critiques qui peuvent être adressées à l’instrument de l’activité partielle (que nous avons citées et discutées dans le section précédente), ce choix repose en partie sur le souhait d’inciter les chômeurs à chercher et accepter un emploi ainsi que sur la crainte d’une hausse du coût du travail à cause d’une hausse des salaires.
Ces craintes reposent sur un mécanisme théorique bien connu dans les modèles de marchés du travail frictionnels à la Pissarides[10]. Premièrement, une augmentation de la générosité de l’assurance chômage augmente le montant minimum de salaire à partir duquel un chômeur accepte un emploi – appelé le “salaire de réservation” – en supprimant l’urgence pour lui de trouver un emploi afin d’améliorer sa position de chômeur. Ce dernier restera plus longtemps au chômage, le temps de trouver une offre d’emploi qui améliore réellement sa situation. Deuxièmement, une assurance chômage généreuse augmente le pouvoir de négociation des travailleurs en emploi – qui ont moins à perdre s’ils tombent au chômage – menant à une hausse générale du niveau des salaires et ainsi une augmentation du coût du travail pour les entreprises, favorisant le chômage en désincitant à l’embauche de nouveaux travailleurs.
Il existerait donc un lien clair entre la générosité des allocations chômage et le niveau des salaires et ce serait un argument en faveur d’une générosité faible ou modérée. La littérature empirique ne fait pas consensus sur ce sujet. Si ce lien existe, il ne serait que très faible, comme le suggèrent, par exemple, Jäger et al. (2018). Ils montrent à l’aide de données autrichiennes que les salaires sont très peu sensibles aux variations du montant des prestations d’assurance-chômage : le salaire augmente de moins de 0,01 € lorsque l’allocation chômage augmente de 1 €, et ceci reste valable pour les travailleurs avec un faible salaire, qui sont les premiers concernés par le chômage.
Conclusion
Alors qu’en réponse à la Grande Récession, les réformes structurelles engagées par de nombreux pays européens sont allées dans le bon sens pour préparer les marchés du travail à être plus résilients face à la prochaine crise macroéconomique globale (Thommen, 2019), elles semblent (pour l’instant) désuètes pour faire face à la situation actuelle, caractérisée par un arrêt total de l’activité pour de nombreuses entreprises. La plupart des pays occidentaux l’ont compris. Ainsi, pour y faire face, et même si les stratégies ne sont pas exactement les mêmes, ils ont quasiment tous décidé d’augmenter la générosité de leur système d’assurance chômage. D’après ce que nous savons de la littérature économique existante sur le rôle de l’assurance chômage, c’était la bonne stratégie à adopter. Il sera intéressant d’observer si ces changements ne seront que temporaires ou s’ils s’inscriront durablement, dans la perspective d’une occurrence plus élevée des pandémies dans le futur.
Références
Balleer, A., Gehrke, B., Lechthaler, W., & Merkl, C. (2016). Does short-time work save jobs? A business cycle analysis. European Economic Review,84, 99-122.
Boeri, T., & Bruecker, H. (2011). Short-time work benefits revisited: some lessons from the Great Recession. Economic Policy, 26(68), 697-765.
Cahuc, P., & Nevoux, S. (2017). Inefficient Short-Time Work (No. 11010). IZA Discussion Papers.
Cahuc, P., Kramarz, F., & Nevoux, S. (2018). When Short-Time Work Works (No. 2018-07). Sciences Po Department of Economics.
Cahuc, P. (2019). Short-time work compensation schemes and employment. IZA World of Labor.
Hijzen, A., & Venn, D. (2011). The Role of Short-Time Work Schemes during the 2008-09 Recession. OECD Social, Employment, and Migration Working Papers, (115), 0_1.
Hijzen, A., & Martin, S. (2013). The role of short-time work schemes during the global financial crisis and early recovery: a cross-country analysis. IZA Journal of Labor Policy, 2(1), 5.
Jäger, S., Schoefer, B., Young, S. G., & Zweimüller, J. (2018). Wages and the Value of Nonemployment (No. w25230). National Bureau of Economic Research.
Nevoux, S. (2019). L’activité partielle constitue une politique efficace de sauvegarde de l’emploi. Bulletin de la Banque de France, (225), 1-8.
Thommen, Y. (2019). Réformes structurelles et résilience des marchés du travail en zone euro. Bulletin de l’Observatoire des politiques économiques en Europe, 41(1), 21-32.
Turrini, A., Koltay, G., Pierini, F., Goffard, C., & Kiss, A. (2015). A decade of labour market reforms in the EU: insights from the LABREF database. IZA Journal of Labor Policy, 4(1), 12.
Wasmer, E. (2011). Le prix Nobel 2010: les marchés frictionnels. Revue d’économie politique, 121(5), 637-666.
Notes
[1] A ce propos, vous pouvez consulter cet article : Likelihood of a coronavirus recession: Views of leading US and European economists (2020), écrit par Romesh Vaitilingam.
[2] Source : FRED, données sur les demandes d’inscription au chômage
[3] Source : Situation sur le marché du travail au 21 avril 2020 (DARES)
[4] Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle
[5] Source : Situation sur le marché du travail au 21 avril 2020 (DARES)
[6] Source : Announces New Guidance on Unemployment Insurance Flexibilities during COVID-19 Outbreak | US Department of Labor
[7] Rescuing the labour market in times of COVID-19: Don’t forget new hires! | VOX, CEPR Policy Portal
[8] Hjælpepakke på plads: Staten dækker stor del af fyringstruedes løn.
[9] Supporting people and companies to deal with the COVID-19 virus
[10] Voir Wasmer (2011) pour une présentation claire des principaux mécanismes de ce modèle.
Crise Sanitaire, Inégalités et Pauvreté
« Mettre les villes à l’arrêt sauvera certes [des gens] du coronavirus, mais ces mêmes personnes seront alors en proie à la famine. » Imran Khan, Premier ministre du Pakistan
Le Coronavirus a déjà tué plus de 170 000 personnes dans le monde entier en l’espace de quelques semaines. Selon Elsland & O’Hare (2020), la pandémie pourrait tuer près de 40 millions de personnes. Mais au-delà des aspects sanitaires, s’ajoutent hélas des aspects économiques. Le confinement a marqué un arrêt brutal de production dans le monde entier. Et pour couronner le tout, il semble que ceux qui vont subir de plein fouet simultanément les crises sanitaire et économique, sont les plus démunis. Ce document vise à présenter les conséquences économiques de la crise sanitaire sur les populations les plus pauvres. Le confinement touche les populations fragiles notamment par le fait qu’il affecte principalement le marché du travail, donc l’emploi et les salaires. Il convient alors de présenter au préalable l’impact de cette crise sur le marché du travail, une des principales sources d’inégalités et pauvreté.
Les chiffres annoncés sont, à ce titre, éloquents : Le chômage mondial devrait croitre de plusieurs millions ; la dégradation économique générée par la crise sanitaire pourrait se traduire par une explosion de la pauvreté, avoisinant le demi-milliard de personnes. En d’autres termes, cela correspondrait à un bond en arrière de 30 ans en termes de pauvreté. Le message est très simple : si la lutte sanitaire contre la propagation du virus ne s’accompagne pas de mesures économiques conséquentes, le coût se paiera en inégalités et pauvreté.
Chômage et Pandémie
Afin d’analyser les effets de la pandémie sur le marché du travail, on peut se laisser tenter par quelques comparaisons historiques. Si l’on regarde du côté de la Peste Noire, celle-ci s’est notamment traduite par une croissance des salaires dans le secteur agricole (Hamermesh, 2020). En effet, ayant décimé près d’un tiers de la population européenne, et surtout dans les zones urbaines, cela avait créé une forte tension sur les marchés du travail. Afin de ne pas assister à des départs massifs de travailleurs des campagnes vers les villes, les salaires agricoles ont augmenté. Emettre cette hypothèse dans le cas du Covid-19 ne semble pas raisonnable du fait que, d’une part, le taux de mortalité est nettement plus faible et d’autre part, le secteur agricole n’est plus aussi important.
Sans doute, le cas le plus proche serait d’observer les effets sur le marché du travail de la grippe espagnole de 1918 (Clay, 2020). Néanmoins, il n’est pas aisé de clairement identifier l’impact du virus sur le marché du travail, puisque en 1918, le contexte est dominé par la Première Guerre Mondiale (la phase la plus meutrière de la pandémie s’est produite entre août et octobre 1918, et l’Armistice a eu lieu en Novembre 1918). Bien entendu, la grippe, tuant près de 50 millions de personnes, soit 2% de la population mondiale a affecté le marché du travail. Toutefois rappellons que cette grippe s’est fortement propagée auprès des jeunes (20-40 ans) constituant ainsi la partie la plus importante du marché du travail, notamment à cause de la très grande précarité, obligeant à travailler faute de quoi, il n’y avait pas de revenu et donc de quoi manger. Ajoutons à cela un système de Santé quasi-inexistant. Le virus avait contribué à la baisse de la demande de travail à très court terme, mais de faible amplitude, l’économie américaine (dont les données sont les plus fiables) s’est vite remise de cette crise sanitaire. On observe une récesssion aux Etats-Unis entre de 1920 et 1921, dont le rôle imputable à la grippe espagnole demeure somme toute très discutable (la crise relevant davantage de la polique monétaire menée à ce moment-là). La pandémie de Covid-19 n’est pas réellement comparable à la crise espagnole. D’une part, selon les données actuelles, elle touche principalement les seniors, qui sont généralement en dehors du marché travail. Par ailleurs, cette pandémie ne devrait pas avoir un effet létal aussi important que la grippe espagnole. Enfin, les filets de sécurité sanitaires et financiers, même s’ils sont très hétérogènes entre les Etats, sont bien plus importants que ceux de 1918.
En réalité, les conséquences du virus sur le marché du travail ne seront pas directement liées aux désastres sanitaires (maladies, décès etc.), mais davantage via les mesures économiques qui seront prises pour éradiquer le virus (fermeture de frontières, des commerces, limitation des échanges commerciaux, limitation de la demande via le confinement, etc.). C’est sur la base de ce constat, que des estimations ont été réalisées, en particulier par l’Organisation Internationale du Travail (2020). Ces projections se fondent sur la base de trois scénarii de chute de PIB : un optimiste (-2% PIB), moyen (-4% PIB), pessimiste (-8% PIB). Les résultats apparaissent dans la figure 1 ci-dessous. En clair, dans le scénario optimiste, la crise devrait causer entre 3 et 7 millions de chômeurs supplémentaires dans le monde, et dans le pire scénario entre 13 et 36 millions de chômeurs supplémentaires. On peut noter deux choses. Tout d’abord, ces chiffres peuvent paraitre importants, mais finalement, rapportés au volume de la main d’œuvre mondiale, soit 3, 3 milliards de personne, ils demeurent relativement insignifiants en pourcentage. N’oublions tout de même pas que même si ce taux est faible, il correspond à une réalité que vivent ou vivront au quotidien des millions de personnes. Par ailleurs, on constate que ce sont les pays les plus riches qui devraient être le plus touchés par le chômage. On pourrait croire que pour une fois les pays pauvres sont épargnés. Ce n’est pas le cas. Pour ces derniers, le marché du travail officiel semble moins touché du fait de la présence d’un marché informel important, et de la possibilité pour ces travailleurs de retourner travailler en zone rurale, secteur prégnant dans les pays en développement.
Figure 1 : Impact d’une baisse de la croissance mondiale sur le chômage selon trois scénarios,
dans le monde et par groupes de revenus (en millions)
Source : International Labor Organisation (2020)
Si le Covid-19 a été une source de croissance du chômage dans les pays riches, il convient néanmoins de relativiser cette hausse. Et si certains travailleurs en avaient « profité » pour quitter le marché du travail ? Coibion, Gorodnichenko, & Weber (2020) se sont focalisés sur le marché américain, et ont réalisé une analyse bien plus fine des conséquences du COVID-19 sur l’emploi que celles réalisées par les autorités dont les études s’appuient sur le système d’allocations chômage. Depuis mars 2020, les demandes ayant explosé, ces dernières ont d’énormes difficultés à clairement identifier le nombre de demandeurs d’emplois. Par ailleurs, une importante partie des chômeurs sont inéligibles au système d’allocation chômage, et ne sont pas pris en compte. Les auteurs ont alors préféré utiliser une nouvelle enquête auprès des ménages, et mettent en exergue trois résultats importants. Tout d’abord, le déclin de l’emploi américain est quasiment sans précédent sur un si court laps de temps, et plus important que la crise de 1929. En clair, 20 millions de personnes ont perdu leur emploi. Etrangement, le chômage a certes augmenté mais non de manière proportionnelle à la perte des emplois. En fait, ces 20 millions de chômeurs en plus, qui normalement auraient du se concrétiser par une hausse de 3,5 points de chômage, n’ont conduit qu’à une hausse de 2 points de chômage. Ils en déduisent ainsi leur troisième résultat consistant à dire que le virus a suscité une importante chute du taux de participation au marché du travail. Plus précisemment, une part importante des personnes ayant perdu leur emploi en ont profité pour se mettre à la retraite plutôt qu’au chômage. A priori, il n’y a pas de raisons de penser qu’en Europe, nos séniors proches de la retraite ne vont pas se laisser tenter par un départ anticipé.
Un autre point important, devant être mis en perspective, est que s’il est vrai qu’à très court terme, le chômage ne devrait pas être fortement touché par la crise sanitaire, ce dernier sera indéniablement corrélé au scénario de reprise de l’activité économique. Le BIT admet d’ailleurs que ses estimations (25 millions de chômeurs) peuvent être largement sous-estimées si la reprise n’a pas lieu. Et si le chômage était amené à croitre, ses effets pourraient être encore plus dévastateurs et persistants sur le long terme, ce que les économistes nomment « l’hystérèse du chômage ». L’idée est simple : la crise aujourd’hui augmente temporairement le chômage. Lorsque la crise disparait, le chômage demeure élevé. L’exemple de la crise des subprimes et du chômage aux États-Unis illustrent bien les phénomènes d’hystérèse. La crise financière de 2007 ayant conduit à une hausse du chômage courant, a poursuivi ses effets en 2015. Yagan (2019) estime qu’une hausse du chômage de 10% en 2007-2009 avait encore des effets 6 ans plus tard, en causant une baisse du taux d’emploi de 3%. Aussi, il est parfaitement imaginable qu’une croissance du chômage actuelle se traduise in fine par une longue période chômage.
Les peu qualifiés, les premiers touchés par la crise
S’il est vrai que le chômage semble en définitive peu touché (tout du moins à court terme), c’est sans doute par le jeu d’un ajustement des heures travaillées. Ainsi, les estimations du Bureau International du Travail (2020), montrent que sur le second trimestre 2020, le nombre d’heures travaillées chutera de 6,7%, correspondant à l’équivalent de 230 millions d’emplois équivalent plein temps (40h par semaine). Ces baisses de travail se concrétisent clairement par des baisses de revenus, évidemment loin d’être homogènes selon divers critères. Il existe différents moyens d’appréhender les inégalités, en termes d’emplois ou de revenus, générées par cette crise sanitaire et les mesures prises afin d’éviter la propagation du virus. Mais en définitive, quelle que soit la porte d’entrée des inégalités, ce sont inévitablement, en bout de chaine, les travailleurs les moins qualifiés qui subiront les conséquences de cette crise, dans la plupart des pays. Le niveau de richesse du pays permettra simplement d’atténuer l’effet « néfaste » de la crise sur les moins qualifiés, créant là encore d’autres inégalités entre les moins qualifiés eux-mêmes selon le pays de résidence. Plusieurs arguments mettent en lumière le fait que les travailleurs pauvres seront davantage touchés par la crise.
Prenons les secteurs d’activités. Nous savons d’ores et déjà que les travailleurs seront plus ou moins affectés par la crise selon les branches économiques. Dans certains secteurs, la production s’est littéralement effondrée. On retrouve ici la restauration, l’hôtellerie, l’industrie manufacturière ou le commerce (voir tableau 1). Dans ces secteurs, les travailleurs subiront de plein fouet les conséquences du confinement. Or, ces activités, pesant près de 38% de l’emploi mondial, soit 1,25 milliard de travailleurs, produisent des biens et services à l’aide d’une importante main d’œuvre peu qualifiée.
Tableau 1 : Travailleurs en Danger ; Perspectives par secteur
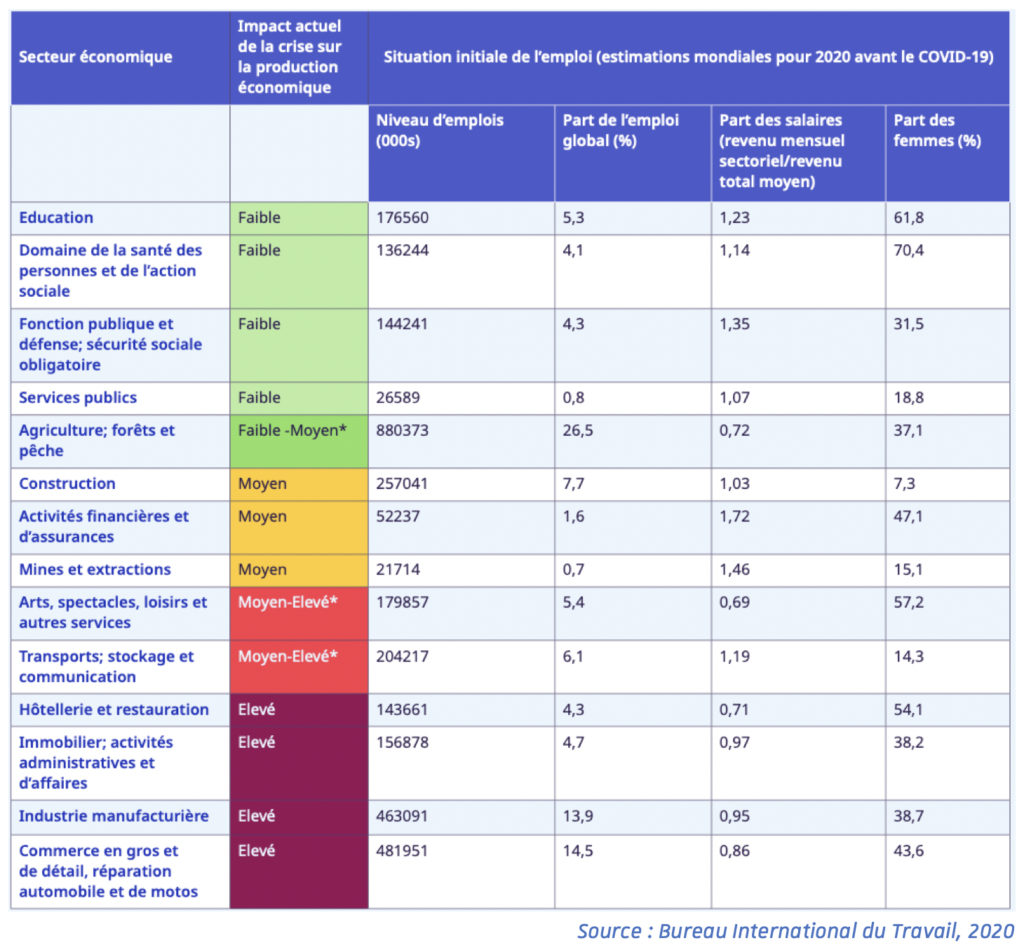
Nous savons également qu’en période de crise, les ajustements de main d’œuvre nécessaires s’effectuent en premier lieu sur les contrats précaires, l’utilisation de ces derniers reposant justement sur les facilités d’ajustement de conditions de travail (horaires, salaires, voire licenciement) en cas de nécessité. Or dans les secteurs très exposés, et notamment dans la restauration, l’hôtellerie, ou le commerce, le recours aux emplois précaires est très important. Ce sont souvent des emplois à temps partiels, très flexibles en matière d’horaires et de contrats, et concernent en grande majorité des emplois peu qualifiés.
La crise affecte les travailleurs peu qualifiés via un autre canal du marché du travail, celui du secteur informel. Ce dernier regroupe les emplois qui, légalement, illégalement ou dans la pratique, ne sont pas (ou très peu) couverts par des dispositions formelles, telles que par exemple une protection sociale. On pense notamment aux travailleurs indépendants, les travailleurs domestiques, les vendeurs ambulants etc. Bien entendu, là encore, ces emplois nécessitent pour l’immense majorité peu de qualification. L’économie informelle regroupe près de 2 milliards de travailleurs, non couverts par la protection sociale, et situe principalement, mais non exclusivement, dans les pays pauvres (Indonésie, Inde, Nigéria pour les plus importants, dépassant 80% de leur emploi total). Ces populations n’ayant pas accès aux soins sont plus exposées aux risques du virus, contraintes de travailler faute de quoi leurs revenus s’évaporent. A l’instar de la Peste Noire au 14ème siècle, ayant tué essentiellement les populations les plus pauvres (Duncan & Scott, 2005), il semble bel et bien que les pandémies affectent non seulement les personnes vulnérables sur le plan médical, mais également les plus fragiles sur le plan économique. (Lee & Cho, 2016). Si l’on imagine assez aisément que dans les pays pauvres les crises sanitaires affectent les plus démunis, le constat s’applique également aux pays riches, qui pourtant offrent un système de protection sociale plus développé. L’explication repose notamment sur le fait que très souvent les systèmes de protection sont complexes à appréhender, et ceci est d’autant plus vrai pourles travailleurs peu qualifiés ne maitrisant les rouages administratifs. Ce constat s’est observé aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, où des études ont montré que les travailleurs à faibles revenus se méfient des annonces de protection sociale faites par les autorités. En effet, ces travailleurs éprouvent de grandes difficultés à comprendre le système d’aide, et n’en bénéficient donc pas (Ahmed, Ahmed, Pissarides, & Stiglitz, 2020). Plus généralement, les Etats-Unis se caractérisent par de grandes disparités en matière d’accès à la santé. Des travaux de la Fed (2020) sur les conditions de vie des Américains identifient de nombreuses inégalités entre les individus. Celles concernant les inégalités de revenus sont déjà bien connues. Si 70% des travailleurs à temps plein bénéficent d’une couverture en cas de maladie, ils ne représentent que 27% parmi les travailleurs à temps partiel, et 8% parmi les contrats très précaires. Un quart déclare avoir renoncé à un ou plusieurs types de soins de santé au cours de l’année précédente pour des raisons d’accessibilité financière. En France, malgré une protection sociale très développée, les travailleurs à faibles revenus sont aussi plus touchés par les risques sanitaires. Une étude menée par Stabile, Apouey, & Solal (2020) montre notamment dans le secteur de la « Gig Economie », faisant référence aux petits boulots de livreurs de nourriture (Uber Eats, Deliveroo…) ou conducteurs (Kapten, Le Cab…), une part non négligeable de ces travailleurs a continué à travailler après le confinement afin de ne pas subir de pertes de salaires (n’ayant pas droit à des indéminités de chômage).
Le risque d’explosion de la pauvreté
La conséquence la plus alarmante de cette crise sanitaire demeure l’explosion de la pauvreté du fait de la crise économique. Même si les chiffres demeurent très incertains puisqu’il est encore très difficile d’évaluer clairement les conséquences en matière de croissance de la crise, il est certain que la pauvreté augmentera de manière drastique, si aucune politique n’est mise en œuvre. Plusieurs facteurs sont à la source de cette explosion.
Tout d’abord, l’impact sur le marché du travail et les baisses de revenus sont évidemment une première source de pauvreté. L’OIT estime que la baisse du revenu du travail serait comprise entre 860 et 3440 milliards de dollars, générant entre 8,8 millions et 35 millions de pauvres supplémentaires[1] du fait du Covid-19. Une analyse plus fine des mécanismes de transmission nécessite de prendre en compte, certes l’impact sur la productivité de travail, mais également sur la productivité globale des facteurs (il n’y pas que le travail qui est affecté, mais tout le système de production), ainsi que le choc commercial affectant les échanges et donc la production mondiale. Une analyse de l’IFPRI met en avant que l’élasticité de l’extrême pauvreté est comprise entre -3 et -1,6. En d’autres termes, pour une croissance réduite de 1%, la pauvreté s’accroit de 1,6 à 3%, soit de 14 à 22 millions de pauvres supplémentaires[2]. La pauvreté augmenterait fortement suite au ralentissement des échanges mondiaux, notamment dans les pays d’Afrique, et dans les zones rurales. Ce résulat ne semble pas surprenant, dans la mesure où les pays africains sont dépendants de leurs exportations, en particulier dans le secteur agricole et certaines matières premières. On peut d’ailleurs encore approfondir l’étude en analysant bien entendu les chutes de revenus monétaires, mais également les chocs de consommation, certains pays fournissant des données sur les consommations et non les revenus. Sumner, Hoy, & Ortiz-Juarez, (2020) se distinguent doublement par rapport aux deux analyses précédentes. Ils estiment l’impact sur la pauvreté, en intégrant ces données de consommation en plus des données sur le revenu (tel l’OIT ou IFPRI). Par ailleurs, ils généralisent le concept de pauvreté en retenant trois critères de pauvreté absolue : un panier/revenu où un valeur monétaire serait inférieure à 1,90$/jour (IFPRI), 3,20$ (OIT), et 5,50$/jour. Leurs conclusions sont sans appel : le nombre de pauvres pourrait s’accroitre de 85 à 135 millions (contraction du revenu/tête de -5%), 180 à 280 millions de plus (contraction du revenu/tête de -10%), voire 420 à 580 (contraction du revenu/tête de -20%). Là encore, les pays les plus touchés se situeraient sur les continents asiatique et africain.
Tableau 2 : Effet du Covid-19 sur la Pauvreté
selon Différentes Études
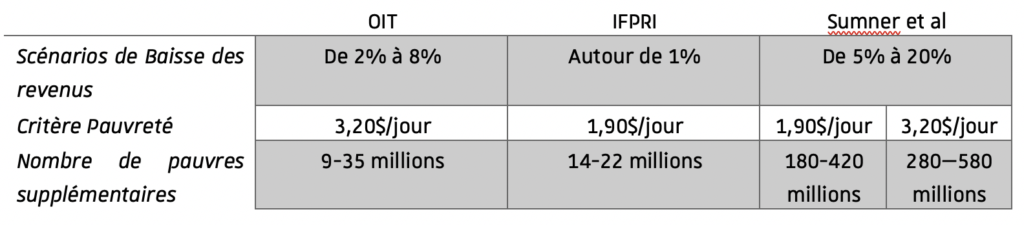
Bien entendu, on comprend aisément que la pauvreté touchera principalement les pays les moins avancés. Néanmoins, les pays riches ne seront pas épargnés. Si l’on se concentre sur les États-Unis, le risque de pauvreté pour une part importante de la population est grand. Les conditions de vie, déjà avant la crise du Covid-19, demeurent très difficiles pour de nombreux Américains. Plus d’un quart des ménages déclarent que leurs revenus doivent être complétés par des activités informelles. Pour près de la moitié des Américains, les dépenses annuelles ont été supérieures aux revenus qu’ils ont gagnés. 44% des adultes déclarent qu’ils ne pourraient pas faire face à une dépense d’urgence de 400$ (ou alors ils seraient contraints d’emprunter ou de vendre quelque chose). Les États-Unis ont la culture de l’endettement. Et cette dette demeure très inquiétante. Avant la crise du Covid, un grand nombre d’Américains connaissent des difficultés à rembourser leurs dettes. Près de 9 millions d’étudiants ayant contracté des prêts sont dans l’incapacité de rembourser leur crédit, 7 millions de personnes ont du retard sur le crédit automobile, près de 12% des crédits à la consommation sont « douteux », signifiant que, soit la mensualité n’a pas été payée, soit reconduite. En d’autres termes, cette crise sanitaire conduisant à une crise de l’économie réelle, pourrait très bien se finir par une crise financière. La causalité serait donc ici renversée par rapport à la crise de 2007, où le point le point de départ est la crise financière se diffusant ensuite au secteur réel. On pourrait d’ailleurs parfaitement imaginer que les crises dans chaque secteur (réel et financier) s’entretiennent l’une l’autre et entrer dans une longue récession. Comme pour la crise des subprimes, les Américains les plus démunis seraient les plus touchés par cette crise économique et financière.
L’Europe ne serait pas épargnée de manières directe et indirecte. D’une part, les enseignements de la crise de 2007 ont montré l’importance et la vitesse de propagation de crises entre les continents, notamment à travers le marché financier. Si les Etats-Unis accusaient une crise financière, irrémédiablement et très rapidement, le marché financier européen subirait indirectement des dégâts financiers importants lui aussi. Plus directement, les ménages européens font également face à des risques de pauvreté élevés, même si ces derniers sont très hétérogènes entre les pays. On appréhende la pauvreté en Europe de manière relative : on considère qu’un individu est pauvre lorsqu’il gagne moins de 60% du revenu médian. Dès lors, on observe aisément le taux de pauvreté. Néanmoins, une démarche originale consiste également à se demander comment les Ménages affronteraient cette période de confinement, et seraient capable de faire face à d’éventuelles baisses de revenus durant la crise. Nous savons que l’on peut puiser dans notre épargne afin de compenser la perte de revenu, lorsque cela est possible. Or, de nombreux ménages ne possèdent pas suffisamment de richesse pour supporter seuls ces baisses de revenus. En d’autres termes, on appréhende ici le « risque de pauvreté ». Cela correspond au fait qu’un ménage ne dispose pas d’une richesse suffisante pour maintenir son niveau de vie au-dessus du seuil de pauvreté durant une période de crise (ici 3 mois par exemple), s’il ne devait compter que sur lui-même, sans aucune autre aide de l’Etat. Gambacorta, Rosolia, & Zanichelli (2020) ont réalisé une étude sur les pays européens. La Figure 2 ci-dessous décrit les populations sous le seuil de pauvreté (en abscisse, part de la population gagnant moins de 60% du revenu médian) et la population risquant de passer sous le seuil de pauvrété (en ordonnée, part de la population n’ayant pas suffisament de richesse pour rester au dessus du seuil de pauvreté durant 3 mois).
Figure 2 : Taux de pauvreté et Risque de Pauvreté
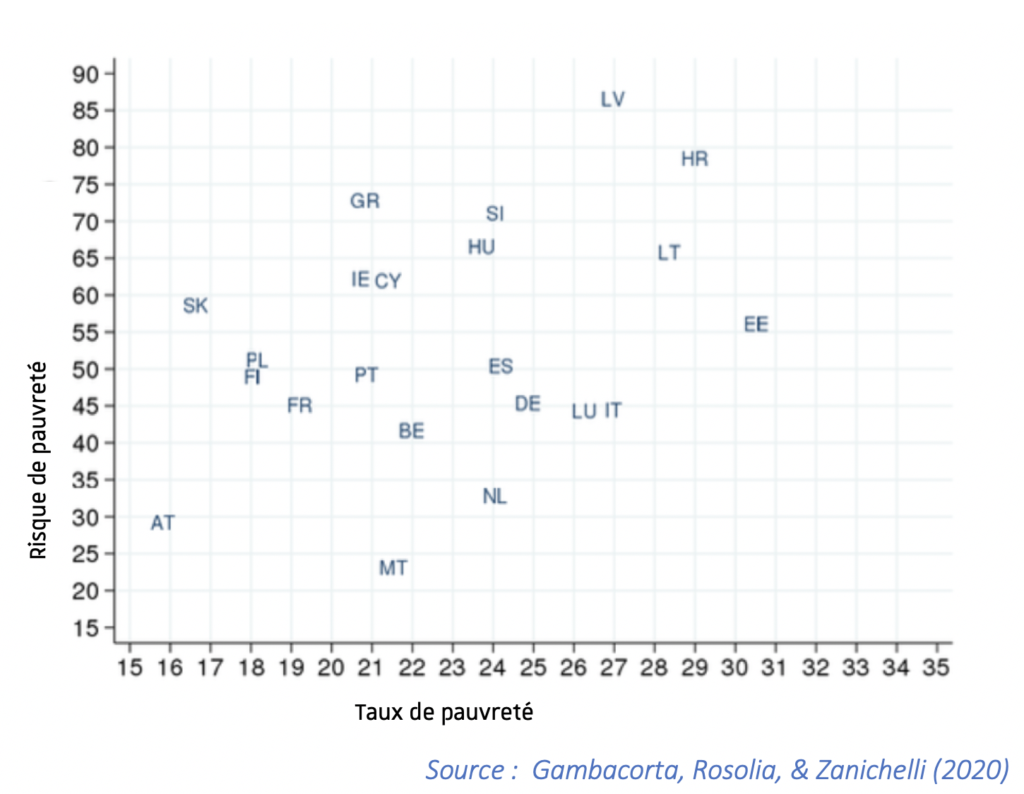
Ce graphique met en évidence deux points importants. Le premier résultat est que la population pauvre et celle risquant de devenir pauvre ne se recouvrent pas. En d’autres termes, le taux de pauvreté en Europe varie entre 16% et 31%. La population risquant la pauvreté est plus importante et varie entre 25% et 90%. Le deuxième résultat est que les pays européens présentent des risques de pauvreté très différents. Ainsi en Autriche, Pays-Bas ou Malte, le risque de pauvreté est relativement faible (entre 25% et 35%). En Italie, Belgique, ou en France, des pays très touchés par le virus, le risque de pauvreté touche près de la moitié de la population. Pour les pays de l’Est, notamment la Croatie, la Lettonie, plus de 80% de la population passerait sous le seuil de pauvreté si elle ne devait compter que sur elle-même.
Le Covid-19 est la plus grande crise que nous ayons connue depuis de la seconde guerre mondiale. Il pleut actuellement des milliards sur les économies. Cela peut paraître effarant, affolant, mais les gouvernements ont-ils vraiment un autre choix que la mise en place de politiques de soutien à l’offre et à la demande ? Le coût n’est-il pas démesuré ? On pourrait alors se pencher, comme le font certains économistes, sur le prix d’une vie, et effectuer des calculs d’arbitrage. Le problème est que ces calculs n’intègrent pas les mouvements collectifs et conséquences sociétales qui peuvent être dévastatrices, et pour le coup, très couteuses économiquement. Inégalités, pauvreté et pandémie génèrent les « morts du désespoir » comme le rappelle Baldwin (2020), et sont indubitablement les ingrédients de base d’un cocktail Molotov social. Quel serait le prix de l’explosion d’un Etat ?
[1] L’OIT retient le critère de pauvreté absolue : un travailleur pauvre correspond au fait que le revenu du travail est inférieur à 3,20$/jour.
[2] IFPRI définit un pauvre comme une personne gagnant moins de 1,90$/jour.
Bibliographie
Ahmed, F., Ahmed, N., Pissarides, C., & Stiglitz, J. (2020, April). Why inequality could spread COVID-19. Récupéré sur The Lancet Public Health: https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30085-2/fulltext
Baldwin, R. (2020, March). The COVID-19 upheaval scenario: Inequality and pandemic make an explosive mix. Récupéré sur Vox: https://voxeu.org/article/inequality-and-pandemic-make-explosive-mix
Clay, K. (2020, Mars). Pandemics and the labor market—Then and now. Récupéré sur IZA Institute Of Labor Economics: https://wol.iza.org/opinions/pandemics-and-the-labor-market-then-and-now
Coibion, O., Gorodnichenko, Y., & Weber, M. (2020, April). Labor Markets During The Covid-19 Crisis : A Preliminary View. NBER WORKING PAPER SERIES.
Duncan, C. J., & Scott, S. (2005). What caused the Black Death? Postgrad Med J.
Elsland, S. L., & O’Hare, R. (2020). Coronavirus pandemic could have caused 40 million deaths if left unchecked. London: Imperial College London .
Federal Reserve. (2017, May). Report on the Economic Well-Being of U.S. Households in 2016. Federal Reserve. Récupéré sur Federal Reserve: https://www.federalreserve.gov/publications/files/2016-report-economic-well-being-us-households-201705.pdf
Gambacorta, R., Rosolia, A., & Zanichelli, F. (2020, April). All in it together, but with differences: The finances of European households through the pandemic. Récupéré sur Vox.Org: https://voxeu.org/article/finances-european-households-through-pandemic
Hamermesh, D. S. (2020, Mars). Coronavirus and the labor market. Récupéré sur IZA Institute Of Labor Economics: https://wol.iza.org/opinions/coronavirus-and-the-labor-market
Lee, A., & Cho, J. (2016). The impact of epidemics on labor market: identifying victims of the Middle East Respiratory Syndrome in the Korean labor market. International Journal for Equity in Health, 15.
Organisation Internationale du Travail. (2020, Mars). Le COVID-19 et le monde du travail: Répercussions et réponses. 1ère Edition. Récupéré sur International Labor Organisation: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/documents/briefingnote/wcms_739156.pdf
Organisation Internationale du Travail. (2020, Avril). Observatoire de l’OIT: le COVID-19 et le monde du travail. Deuxième édition. Récupéré sur International Labor Organisation: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_740982.pdf
Stabile, M., Apouey, B., & Solal, I. (2020, April). COVID-19, inequality, and gig economy workers. Récupéré sur Vox.Org: https://voxeu.org/article/covid-19-inequality-and-gig-economy-workers#
Sumner, A., Hoy, C., & Ortiz-Juarez, E. (2020, April). Estimates of the impact of COVID-19 on global poverty. WIDER Working Paper.
Vos, R., Martin, W., & Laborde, D. (2020, April). Dans quelle mesure la pauvreté mondiale augmenterat- elle en raison de COVID-19?Récupéré sur IFPRI: https://www.ifpri.org/node/23015
Yagan, D. (2019, October). Employment Hysteresis from the Great Recession. Journal of Political Economy, 127.
Consommation des ménages et relance de l’activité économique post-confinement : le rôle central de la confiance des agents économiques
Dans sa note de conjoncture du 23 avril 2020, l’INSEE nous indique que, dans la période de confinement actuelle, la consommation des ménages français serait en deçà de 33% par rapport à son niveau habituel. Cette chute sans précédent de la consommation des ménages est le résultat logique d’un épisode sanitaire et désormais économique inédit, caractérisé par une incapacité de l’offre et de la demande de se rencontrer sur le « marché » à la suite du confinement et à la fermeture d’une majorité des commerces. Il n’est pas question, comme pour la crise de 2008, d’une demande déprimée par un « credit crunch » et par un climat conjoncturel mauvais, mais plutôt d’une incapacité de la demande à pouvoir réaliser ses dépenses, que ce soit la consommation des ménages ou l’investissement des entreprises. Ainsi, de nombreux économistes ne pensent pas que la grille de lecture « choc de demande ou choc d’offre ? » soit la bonne dans la mesure où c’est, dans de nombreux secteurs d’activité, l’offre et la demande qui se retrouvent au même moment touchées par la fermeture pure et simple du marché sur lequel elles sont censées se rencontrer[1]. Malgré l’essor du commerce en ligne, ce dernier n’est qu’un palliatif partiel, ce dernier ne pouvant être utilisé que pour une partie seulement des biens et services et les entreprises de livraison ne pouvant elles-mêmes fonctionner à plein régime. Ainsi, il semble erroné de vouloir analyser les évènements économiques actuels comme un choc d’offre ou de demande, mais de considérer qu’à la fois des mécanismes d’offre et de demande sont en jeu, et qu’il s’agit de documenter à la fois la réponse des entreprises à cette fermeture obligatoire et non-anticipée de leur activité, et de l’évolution à court terme de la demande dans cette environnement caractérisé par une incertitude grandissante.
Beaucoup d’économistes et de citoyens se questionnent actuellement sur la gravité économique de l’épisode actuel : allons-nous vivre une crise économique semblable, notamment dans sa durée, à la crise de 2008 ? Ou alors, après un trimestre catastrophique, les « choses » vont se remettre d’elles-mêmes rapidement en marche une fois le déconfinement opéré dans l’ensemble des économies ? Nous négligerons dans cette partie les aspects liés au côté offre de l’économie pour nous concentrer sur les éléments de réflexion que nous pouvons avoir pour le moment quant à l’évolution à court (et moyen) terme de la consommation des ménages. Certaines dépenses n’ayant pas pu être réalisées pendant cette période de confinement, l’enjeu est de savoir si, une fois revenu en « temps normal », les ménages vont rattraper cette non-consommation dans les mois qui suivront le déconfinement. Dans cette partie, nous allons discuter des éléments qui vont influencer l’évolution de la consommation des ménages dans les mois à venir, en mettant en exergue le rôle clef que va jouer la confiance des ménages en cette période d’incertitude grandissante. Également, nous formulerons une recommandation de politique économique en argumentant en faveur d’une politique budgétaire adéquate afin de soutenir l’économie.
Une consommation des ménages relativement peu volatile le long du cycle économique
Une des caractéristiques de la consommation des ménages est sa relative faible volatilité le long du cycle économique. Comme le montre le graphique 1, la consommation des ménages en France a été moins volatile sur la période 2008/2013 (couvrant les deux périodes de récession de l’activité économique française) que les fluctuations du PIB et surtout de l’investissement, ce dernier étant au contraire caractérisé par une très forte volatilité le long du cycle économique. Ce relatif maintien de la consommation des ménages en France a été un élément clef expliquant des épisodes de récession moins sévères que chez d’autre voisins européens et notamment en Allemagne. Il reste néanmoins que la consommation des ménages a marqué le pas à la suite de la crise économique, revenant à des taux de croissance du niveau de ceux d’avant crise qu’en 2016. La consommation des ménages n’a pas surréagi au début de la crise économique mais s’est installée dans une longue période de morosité.
Que pouvons-nous anticiper quant à l’évolution de la consommation des ménages dans les mois et trimestres à venir ? Nous allons ici aborder différents déterminants de la consommation des ménages afin d’apporter des éléments de réflexion à cette question.
Graphique 1 : Taux de croissance par rapport au trimestre de l’année précédente pour la France, données trimestrielles corrigées des effets saisonniers (Source : Eurostat).
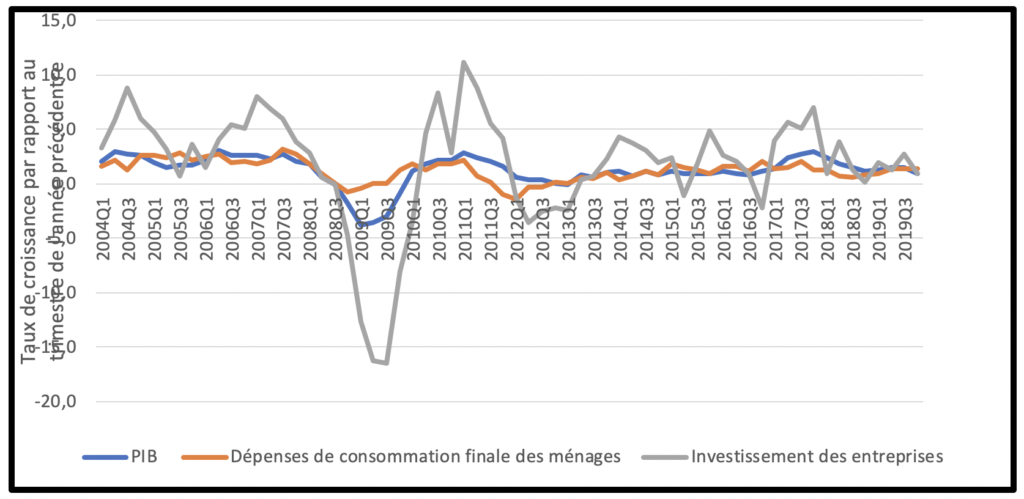
Evolution du pouvoir d’achat des ménages : activité économique et inflation
Un premier élément clef qui impactera l’évolution future de la consommation des ménages est assez logiquement l’évolution de leur pouvoir d’achat. Si l’économie rentre durablement dans une période de ralentissement de l’activité économique, le pouvoir d’achat risque de diminuer par une hausse durable du chômage et des tensions à la baisse sur les salaires. Nous verrons en fin de cette partie que nous recommandons ici aux gouvernements de soutenir la consommation des ménages par des dispositifs fiscaux et budgétaires adaptés. L’ampleur de cette baisse de pouvoir d’achat liée à l’activité économique dépendra de l’ampleur du ralentissement de cette dernière. Il apparaît complexe pour le moment de mesurer avec précision l’évolution conjoncturelle de ces prochains mois.
Un autre élément important pouvant impacter la consommation des ménages est l’inflation. Avec le confinement et la crainte d’une pénurie, nous pourrions, avec raison, craindre une envolée de certains prix, notamment des produits alimentaires. Il n’en est pour l’instant rien. L’INSEE évalue pour le mois de mars 2020 une inflation de l’indice des prix à la consommation de 0,6% sur un an, contre 1.6% sur un an en février. Corrigée des effets saisonniers, l’inflation serait même négative avec -0,1% pour mars 2020. Si l’on considère uniquement l’évolution des prix de l’alimentation, même constat : les produits alimentaires enregistrent une variation mensuelle de -0,1% pour le mois de mars 2020. Néanmoins, certains acteurs du secteur agroalimentaire craignent dans les mois à venir une augmentation significative de certains produits, due, côté entreprises, à un renchérissement des matières premières, et à une hausse des coûts de production, de stockage et de livraison en hausse.
La question cruciale de la confiance des ménages
Nous pensons qu’un des éléments essentiels pour expliquer l’évolution future de la consommation des ménages va être le maintien ou non de la confiance des ménages. L’analyse de la crise de 2008 nous indique que, à la suite de l’effondrement de l’investissement des entreprises, la consommation des ménages a également participé à maintenir un environnement de demande déprimée, un niveau de consommation affaibli par un pessimisme des ménages quant à l’évolution à court terme de la conjoncture économique. Crainte de perdre son emploi, tensions à la baisse des salaires, peur d’un nouvel épisode de crise économique, ce pessimisme a amené les ménages à épargner davantage. La pandémie et la période de confinement aurait particulièrement assombri les perspectives d’évolution des ménages, comme le montre le Graphique 2, se basant sur l’enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages de l’INSEE.
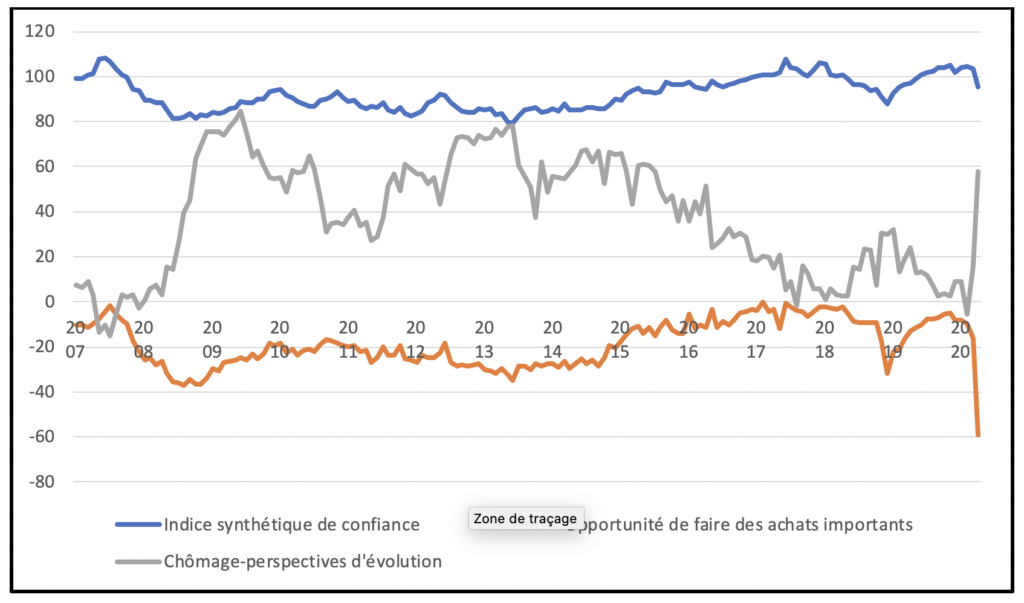
Graphique 2 : Evolution de la confiance des ménages (Source : INSEE, Enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages).
Ce graphique présente tout d’abord l’évolution depuis 2007 de l’indice synthétique de la confiance des ménages. Cet indice global enregistre une baisse de 8 points pour le mois d’avril 2020 par rapport au mois précédent, la plus forte baisse en un mois depuis la création de l’indice en 1972. Cet indice est alors de 95 points pour le mois d’avril, en dessous de sa moyenne de longue période de 100 (la majorité des points sur le graphique se trouvent en dessous de cette moyenne de 100, ce qui s’explique par l’échantillon temporel retenu ici, incorporant la crise économique récente). Plus inquiétant encore, l’enquête révèle une chute historique de l’« opportunité de faire des achats importants », laissant entrevoir une forte baisse de l’investissement des ménages dans les mois et trimestres à venir. De plus, les ménages questionnés quant à leur crainte de perdre leur emploi font preuve également d’un pessimisme grandissant, avec une augmentation marquée de cet indice au mois d’avril, l’amenant à un niveau observé lors de la crise de 2008.
Il est difficile d’anticiper comment va évoluer la confiance des ménages dans les mois à venir. Un certain nombre de facteurs influençant le moral des ménages étant encore incertains : potentielle « deuxième vague » épidémique, évolution de la conjoncture incertaine. Dans l’éventualité où la confiance des ménages reste à un niveau faible dans les mois à venir, la consommation et donc la demande risque d’être affaiblie de manière prolongée. Cette chute brutale mais temporaire de l’activité économique avec le confinement risquerait alors d’aboutir à une longue période de ralentissement économique provoqué notamment par une insuffisance de la demande. En effet, si nous nous concentrons ici sur la consommation des ménages, le moral des entreprises montre des signes de morosité dans certains secteurs, ce qui peut nous laisser anticiper une diminution également de l’investissement des entreprises. C’est ici un phénomène « auto-réalisateur » qu’il faut craindre. Au-delà de l’impact économique direct, notamment sur le côté offre de l’économie, de la pandémie et du confinement mondial, c’est une perte de confiance et le pessimisme des agents économiques qui risquent d’installer durablement la conjoncture économique dans une période de faible croissance.
Un rôle important pour les gouvernements et les politiques budgétaires et fiscales
Afin d’éviter cela, les gouvernements ont un rôle crucial à jouer. Face à ce spectre d’une demande moribonde dans les trimestres à venir, le macroéconomiste avisé pourrait appeler à la mise en place de politiques de soutien à la demande, mais également de soutien aux entreprises, surtout dans les secteurs d’activité les plus touchés par le confinement. Que cette politique soit plus orientée vers l’offre ou la demande, dans tous les cas elle va nécessiter un creusement des déficits publics.
Par le jeu des stabilisateurs automatiques et des mesures de soutien d’ores et déjà prises par les gouvernements européens, les finances publiques des états membres sont déjà très fortement dégradées. Pour la France, les prévisions du gouvernement français tablent sur un déficit de 9% et une dette publique qui atteindrait 115% du PIB en 2020. L’Italie devrait elle être encore plus durement touchée, avec une prévision de déficit à 10,4% et une dette publique passant de 134.8% en 2019 à 155.7% en 2020, amenant l’agence de notation Fitch à dégrader la note des bons du trésor italiens, de « BBB » à « BBB-» . Il va être intéressant d’observer quelle orientation de politique économique va être fixée au niveau Européen, s’il y en a une. La Commission Européenne ne devrait pas à priori sanctionner les états membres pour les déficits et dettes publiques excessifs actuels, déficits liés en grande partie aux stabilisateurs automatiques dans des circonstances exceptionnelles. Néanmoins, nous pouvons nous questionner sur les recommandations qui seront faîtes aux états membres dans le cadre du prochain semestre Européen, recommandations qui dépendront évidemment de l’évolution de la conjoncture économique ces prochains mois. Si la soutenabilité des finances publiques européennes est importante, il ne faudra pas non plus faire la même erreur que lors de la crise de 2008. En effet, les grandes institutions internationales, FMI en tête, pensaient fin 2009 que la récession était finie, « conseillant » aux états de mettre en place des plans de consolidation dès 2010. Ces prévisions d’une sortie de crise ce sont révélées erronées, notamment en sous-estimant l’impact des plans d’austérité sur l’activité économique. Blanchard et Leigh (2013) estiment justement que les erreurs de prévision commises sont en partie expliquées par une sous-estimation des dégâts des plans de consolidation sur l’activité économique.
Si économistes et décideurs publics jugent nécessaire de soutenir à la fois les entreprises et les ménages en mettant en place un plan de relance, il sera nécessaire de rassurer les agents économiques en communiquant la politique économique mise en place de la manière la plus transparente et cohérente possible. En effet, la réaction de la demande à un potentiel plan de relance de l’économie va être cruciale pour générer des effets significatifs et positifs sur l’activité économique. L’efficacité des plans de relance mis en place en 2008/2009 en Europe ne fait pas consensus chez les économistes. Un argument en faveur de l’efficacité de ces relances budgétaires est que le multiplicateur budgétaire est d’autant plus grand que l’activité économique est dégradée. Une littérature empirique sur l’évolution du multiplicateur le long du cycle économique s’est en effet développée ces dernière années avec un résultat qui semble faire consensus : le multiplicateur budgétaire est plus grand en période de ralentissement économique qu’en période d’expansion. Auerbach et Gorodnichenko (2012) concluent pour un multiplicateur fort keynésien de 2.5 en période de ralentissement et un multiplicateur proche de 0 en expansion.[2] Néanmoins, les estimations de la Commission Européenne et de la Banque Centrale ne vont pas dans le même sens. Pour le plan de relance Européen, la Commission avait estimé en 2009 un multiplicateur de 0.6 et la BCE un multiplicateur de 0.7 dans son bulletin mensuel de juillet 2010, des multiplicateurs donc faibles. La principale raison évoquée est en lien avec notre propos antérieur quant à la confiance des ménages. En effet, les plans de relance menés en Europe se sont basés à la fois sur des hausses de dépenses publiques et des baisses d’impôt[3]. Les ménages, en cette période de crise, auraient eu une propension marginale à consommer très faible, et auraient ainsi utilisés le revenu supplémentaire généré par les baisses d’impôts et l’augmentation de certaines prestations sociales pour se constituer une épargne de précaution, et non pas consommer. C’est le principal mécanisme identifié par les économistes et institutions concluant en faveur d’une efficacité limitée des plans de relance de 2008/2009.
Ainsi, nous pensons que les gouvernements vont avoir un rôle clef dans les mois à venir. Dans le cas français, le Président Macron et le gouvernement devront, dans un contexte social dégradé et sous tension, soigner leur communication politique générale et tout spécialement la communication relative à la politique économique qui suivra le confinement. Il s’agira premièrement de rassurer les agents économiques afin que des esprits animaux mal lunés ne viennent pas mettre en péril le redémarrage de l’activité économique. Deuxièmement, une présentation cohérente et crédible de la future politique économique sera l’élément clef de la réussite de cette dernière. Les prestations sociales et les dispositifs fiscaux mis en place ne permettront de soutenir la demande qu’à condition que les ménages et les entreprises formulent des anticipations relativement optimistes par rapport à l’évolution de la conjoncture économique.
BIBLIOGRAPHIE :
-Auerbach A. J. et Gorodnichenko Y., 2012, « Measuring the Output Responses to Fiscal Policy », American Economic Journal: Economic Policy, 4 (2): 1-27.
-Baldwin R., Weder di Mauro B, 2020, “Mitigating the Covid Economic Crisis: Act Fast And Do Whatever It Takes”, CEPR press.
-Blanchard O. et Leigh D., 2013, “Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers”, International Monetary Fund Working Paper Series.
-Creel J, Heyer E. et Plane M., 2011, « Petit Précis de Politique Budgétaire Par Tous les Temps », Revue de l’OFCE, Janvier 2011.
[1] Voir notamment Baldwin et Weder di Mauro (2020) pour l’impact économique du COVID-19, qui reprend une analyse similaire quant à la nature du choc frappant actuellement l’économie.
[2] Voir également Creel, Heyer et Plane (2011) pour l’économie française.
[3] Les plans de relance des différents Etats-membres sont cependant hétérogènes dans leur composition, en ne se basant pas notamment sur les mêmes leviers fiscaux. Voir le document de travail du Centre d’Analyse Stratégique de 2012 intitulé « Une comparaison des stratégies de consolidation budgétaire en Europe ».
Quel rôle doit jouer l’Union Européenne dans la gestion de la crise du COVID-19 ? Faisons preuve de réalisme !
Les chantiers sont multiples …
La crise sanitaire que traversent les pays du monde entier est une crise sans précédent qui appelle une intervention publique multi-formes aussi bien au niveau sanitaire, économique, et social. Certaines mesures doivent être prises dans l’urgence et le temps joue en la défaveur des décideurs publics qui sont face à des décisions à prendre à des horizons temporels différents sans être capables de prévoir ce qu’une décision prise dans l’immédiat pourra avoir comme impact à court et moyen terme. Certaines décisions sont attendues immédiatement (décision de confinement, déconfinement, généralisation des tests, …), d’autres à très court terme (soutien au tissu économique …) et d’autres à moyen-long terme (lancement d’un grand programme de relance de l’économie …)
… l’incertitude la plus totale ….
Le bilan économique pourra être désastreux comme le soulignent le FMI (2020), qui a publié des prévisions économiques alarmantes notamment pour la zone euro dont le PIB chuterait de 7,4 % ou encore le cabinet de conseil Mc Kinsey (2020) qui a annoncé que le taux de chômage allait doubler dans l’UE suite à la crise. Pour la France, l’OFCE (2020) chiffre pour le moment les conséquences du confinement à près de 3 points de PIB.
La réalité est que nul n’est capable de réellement prévoir l’ampleur des dommages que causera cette crise d’une nature nouvelle. Comme le souligne avec humilité l’OFCE (2020) : « Cette évaluation ne constitue qu’une première étape dans le chiffrage d’un choc économique et social inédit. Notre évaluation sera révisée régulièrement en intégrant des effets non pris en compte à ce stade mais aussi sur la base de nouvelles données disponibles au fur et à mesure, permettant ainsi de mieux calibrer les chocs pris en compte. ». Stock (2020) insiste également sur le manque cruel de données pour fournir une réponse politique à la crise du COVID. Jorda et Taylor (2020), Eichenbaum et alii (2020) ou encore Barro et alii (2020) reviennent quant à eux sur les spécificités des pandémies et leurs conséquences potentielles sur l’économie.
Il faut donc avancer en environnement totalement incertain et avoir à l’esprit ce que cela implique sur la prise de décision politique. Que peuvent faire les politiques économiques dans ce contexte ? Quelles sont les marges de manœuvre ? Comment articuler le policy mix dans cet environnement si incertain ? Blot et alii (2019), Benassy et alii (2020), Fuest et Lohse (2020) ou encore Baldwin et Weder di Mauro (2020) envisagent différentes options en tenant compte des marges de manœuvre disponibles.
…. et les décideurs publics nombreux à pouvoir intervenir
Mais de quels « décideurs publics » est-il question exactement ? N’oublions pas que les décideurs publics, ce sont à la fois les Etats, la BCE, l’Union Européenne, la zone euro mais aussi les collectivités locales. Malheureusement, la plupart des experts qui s’expriment sur le sujet et les médias passent sous silence cette réalité, conduisant à des recommandations erronées ou incompatibles avec la réalité.
Les Etats membres sont sur le front, en première ligne, à la une des médias, dans le viseur des citoyens. L’urgence du moment est d’organiser le déconfinement et la reprise de l’activité économique. Les choix nationaux en la matière sont aussi divers que variés[1].
Les collectivités locales agissent quant à elles dans l’ombre et en ordre dispersé alors même qu’elles représentent l’acteur principal de la dynamique territoriale (mise en œuvre du déconfinement dans un contexte de virus encore très présent, organisation de la remise en route du système éducatif, préparation de la reprise de l’activité économique sur le territoire …). L’exemple de la Région Grand Est qui a lancé, le 15 avril 2020, un partenariat inédit entre collectivités publiques et privées en associant la Banque des Territoires et le Crédit Mutuel pour faire naître une Société d’Economie Mixte Locale (SEML) nommée « Dynamise », est tout à fait illustratif de ces dynamiques qui voient le jour sur les territoires. « Dynamise » a pour objectif d’« anticiper et créer les meilleurs conditions pour faire du Grand Est la terre de la reprise économique et du lien social ». Abondée à hauteur de 15 millions d’euros amenés à parts égales par ses trois actionnaires, Dynamise (détenue à 51 % par la Région, 25 % par la Banque des Territoires et 24 % par le Crédit Mutuel) a vu le jour pour pouvoir fournir aux acteurs économiques territoriaux des kits sérologiques leur permettant de reprendre au plus vite leur activité économique tout en garantissant la protection des employés.
L’Union Européenne a par ailleurs très tôt suscité beaucoup d’espoirs mais commence déjà à décevoir. Les récents sondages révèlent que les citoyens ne croient pas/plus en l’Europe. Les tentatives de la Commission Européenne de coordination de la gestion de la crise sont un échec, et l’issue du conseil européen du 23 avril 2020 destiné à dresser les contours d’un plan de relance européen ne laisse augurer que de peu d’avancées rapides et conséquentes pour les 27 Etats membres de l’UE.
Ne reproduisons pas les erreurs du passé !
A nouveau, dans la gestion de cette crise, la répartition des rôles n’est pas claire. Chaque niveau de décision publique doit avoir une mission bien précise, que les autres niveaux lui ont confiée comme le soulignent également Guttenberg et Hemker (2020), qui prônent « Une division du travail claire entre l’Europe et ses États membres ». L’objectif est évident : éviter les doublons, le gaspillage d’argent public, l’inefficacité …
N’obligeons pas l’Union Européenne à assurer un rôle qu’elle n’est pas capable d’assumer !
Faisons preuve de réalisme !
L’Union Européenne est incapable de coordonner dans l’urgence 27 États membres. La raison en est simple : le coût de coordination, principalement en termes de temps et d’itérations successives pour parvenir à un consensus est incompatible avec le besoin de réaction rapide auquel les pays font face. Plusieurs exemples récents ne font que confirmer cela. Bien que la Commission Européenne (2020) ait présenté le 15 avril 2020 une feuille de route européenne pour la levée des mesures de confinement liées à la pandémie de coronavirus, les États membres s’organisent en ordre dispersé. De la même façon, les 27 États membres avancent chacun de leur côté pour le lancement de campagnes massives de tests alors que de nombreux problèmes pourraient être résolus ensemble (tests défectueux, fiabilité des tests …).
L’Union Européenne est incapable de créer rapidement des instruments d’intervention nouveaux. La raison en est simple également : le processus institutionnel de décision au niveau européen est long et complexe, puisqu’il faut arriver à un consensus entre les 27 Etats membres de l’Union Européenne et le Parlement Européen. La figure ci-dessous parle d’elle-même. Ce processus de décision a été voulu par les Etats membres eux-mêmes alors ne rendons pas l’Union Européenne responsable de cela.
Ensuite n’oublions pas de distinguer l’Union Européenne de la zone Euro. Certains experts peu rigoureux ou commentateurs peu aguerris de la chose européenne ont tendance à évoquer indifféremment l’un ou l’autre de façon peu scrupuleuse alors que ces deux ensembles bien distincts sont confrontés à des difficultés bien spécifiques et soumis à des contraintes différentes. En effet, toute l’originalité du modèle européen repose sur la coexistence de différents stades d’intégration économique. Sur les 27 Etats membres de l’UE[2], 19 d’entre eux ont franchi l’étape de l’intégration monétaire en intégrant l’UEM (Union Economique et Monétaire) et en adoptant l’euro comme monnaie unique.
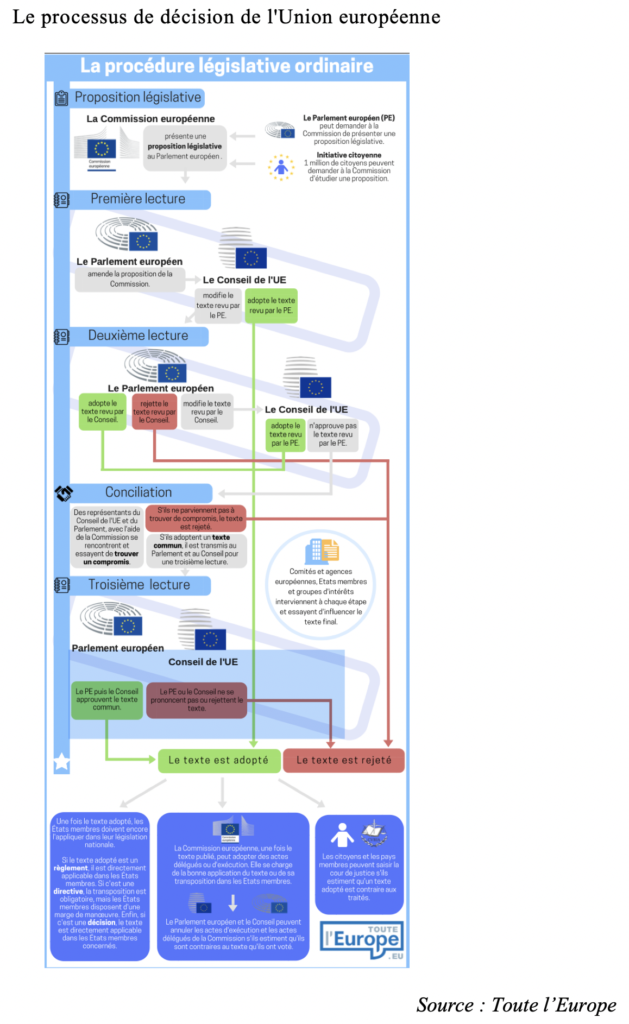
Dans ces conditions, il est illusoire d’espérer que des projets ambitieux mais non consensuels comme les Corona Bonds (voir notamment Avbelj, Matej et al. (2020)) ou encore l’impôt européen progressif sur la fortune (voir notamment Landais, Saez et Zucman (2020)) ne voient le jour prochainement.
Mais que peut faire l’Union Européenne alors ?
Tirons les enseignements de la théorie du fédéralisme budgétaire et de l’expérience passée
La question posée est la suivante : quel niveau de décision publique doit assumer quel rôle ? Quelle action publique doit être menée au niveau de l’Etat ? des collectivités locales (communes, régions, ..) ? de l’Union Européenne ? de la zone Euro ? de la BCE ?
La théorie du fédéralisme budgétaire apporte les éléments d’analyse indispensables pour répondre à cette question[3]. Cette théorie cherche à déterminer la répartition optimale des missions de politique publique entre les différents niveaux de pouvoir. Pour répondre à cette interrogation, différents éléments sont à prendre en compte et notamment : l’existence d’externalités causées par des politiques publiques locales ou nationales, d’économies d’échelle liées à la mutualisation de certaines dépenses publiques, la mobilité des agents économiques, la connaissance du territoire, la connaissance des préférences des citoyens.
A la lumière de cette grille d’analyse, plusieurs enseignements peuvent être tirés de l’expérience européenne :
- L’action publique de soutien et de remise en route de la dynamique territoriale doit se faire au niveau le plus proche des entreprises et des citoyens, à savoir le niveau local.
- En revanche, dès que des économies d’échelle et/ou des gains à la mutualisation sont possibles, l’Union Européenne a un rôle majeur à jouer. Tel est notamment le cas lorsqu’il s’agit de lever des financements ou des dépenses publiques pour lesquelles les économies d’échelle par une mutualisation des dépenses publiques sont potentiellement considérables (dépenses de R&D, innovation, transport, énergie, communication, …)..
C’est d’ailleurs déjà le cas pour la politique européenne de cohésion régionale financée et attribuée au niveau européen mais dont la gestion financière est confiée aux régions européennes. Il en va de même pour les programmes ambitieux d’investissements publics ou de soutien aux investissements qui permettent de soutenir l’activité économique au niveau de l’UE dans son ensemble.
Il s’agit ici d’être en mesure d’apprécier la « valeur ajoutée européenne »[4]. Les premières références à la « valeur ajoutée européenne » datent des débats relatifs au budget de l’UE au début des années 1990 et sont très clairement liées à l’entrée en vigueur du principe de subsidiarité. Bien qu’il existe différentes interprétations de ce concept, la « valeur ajoutée des dépenses européennes » peut se constater dès lors que des bénéfices supplémentaires qu’apporte une intervention à l’échelon européen l’emportent par rapport à l’échelle nationale.
L’intervention de l’Union Européenne et de la zone Euro autour de trois priorités
Etant donné tous ces éléments (enseignements de la théorie du fédéralisme budgétaire, incapacités structurelles de l’Union Européenne à agir dans certaines circonstances, fruits de l’expérience passée), il est possible de définir clairement le rôle de l’Union Européenne et de de la zone Euro dans la gestion de cette crise. Dans ce contexte, trois priorités, qui constituent trois défis majeurs à relever, peuvent être identifiées :
Priorité 1 : A court terme, activer le Mécanisme Européen de Stabilité pour réamorcer la machine économique
Le premier défi à relever est de permettre aux États membres d’avoir les moyens financiers à la hauteur de leurs objectifs de réamorçage de la machine économique. L’objectif prioritaire dans l’immédiat est de soutenir les plans de relance nationaux en permettant aux Etats membres de l’UE de se financer rapidement grâce au Mécanisme Européen de Stabilité (MES) et laisser aux Etats et aux Régions la mise en œuvre de ces plans de relance au niveau local.
Le MES[5] est entré en vigueur en 2012 suite à la crise financière de 2008 afin de permettre aux Etats en difficultés financières d’avoir accès à un financement sans devoir contracter individuellement auprès des marchés financiers de nouveaux emprunts et risquer de devoir faire face à des taux d’intérêts élevés en raison de leur forte exposition au risque de défaut. En d’autres termes, le MES a été crée pour enrayer toute spirale négative qui pourrait conduire un pays à ne plus être en capacité de rembourser ses emprunts et à rassurer les marchés.
Le MES est une institution financière intergouvernementale ayant son siège à Luxembourg. Il est régi par le droit international public. Il est souvent comparé à une sorte de « FMI européen ». Le MES a la capacité de lever des fonds sur les marchés financiers pour les Etats membres, bénéficiant de la garantie de son capital.
Le MES dispose d’une capacité financière de 700 milliards d’euros. Ce fonds est alimenté par les Etats membres en fonction de leur richesse : l’Allemagne y contribue par exemple à 27 %, la France à 20,5 %. Une telle base en capital constitue un levier, grâce auquel le MES peut mobiliser des ressources sur les marchés financiers et émettre de la dette trois à quatre fois supérieure à celle du pays bénéficiaire, avec un taux d’intérêt plus avantageux du fait de sa solidité financière.
Principales limites :
- Le MES ne concerne que les pays de la zone euro.
- Le MES subordonne son aide à une stricte conditionnalité. Celle-ci « peut prendre la forme, notamment, d’un programme d’ajustement macroéconomique ou de l’obligation de continuer à respecter des conditions d’éligibilité préétablies »
Principal avantage :
- L’intervention du MES est uniquement décidée par les ministres des Finances de la zone euro, le Parlement européen n’a aucun droit de regard, seuls les parlements nationaux peuvent donner leur avis.
Priorité 2 : A moyen terme, pour un New Deal européen ambitieux
Le deuxième défi à relever est celui du financement de nouveaux investissements publics et privés pour relancer activement et durablement l’économie européenne. A la lumière des prévisions alarmantes des experts sur l’impact socio-économique de cette crise, même si elles restent à considérer avec d’ultimes précautions, les pays européens ne pourront faire l’impasse sur cette impérieuse nécessité d’une initiative forte et sans précédent pour stimuler la machine économique européenne.
Profitons de cette crise sans précédent pour enfin doter l’UE de puissants outils pour un New Deal européen (le New Green Deal européen existe déjà !) !
Tous les ingrédients sont réunis pour y parvenir, la période est particulièrement propice à ça :
- Le cadre financier pluriannuel 2021-2027, qui fixe le budget de l’UE pour une période de 7 ans (sans marge de manœuvre en cas de crise particulière durant ces 7 ans) et qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2021, est encore en discussion et manque cruellement d’ambition, faute de volonté politique, de projet fédérateur et surtout de ressources financières à la hauteur de ces ambitions ;
- Depuis 20 ans maintenant, l’UE se dote de stratégies pour soutenir la croissance et l’emploi (méconnues de tous !) qui se soldent systématiquement par un échec faute d’instruments financiers [6]: la Stratégie Europe 2030 est actuellement en gestation ;
- Les plans Juncker successifs lancés après la crise financière de 2008 et leur bras armé financier entre les mains de la BEI ont fait leurs preuves pour convaincre qu’il était possible de lever des financements conséquents auprès d’investisseurs privés pour financer des investissements privés mais aussi publics. Mis en œuvre depuis 2015 et prolongé jusqu’en 2020, le plan d’investissement pour l’Europe, dit « plan Juncker », vise à financer deux grands types de projets :
- Des grands projets portant sur un secteur d’avenir : infrastructures (transport, haut débit, énergie, numérique…) mais aussi utilisation plus efficace des ressources et énergies renouvelables, fonds d’investissement de long terme, recherche et innovation, éducation, stages ;
- Des projets innovants portés par des petites et moyennes entreprises(PME : capital, micro crédits) ou des entreprises de taille intermédiaire (ETI : crédits pour les projets de recherche et développement, capital risque pour des prototypes).
Le plan Juncker pour les entreprises fonctionne un peu comme le MES pour les Etats membres : la BEI, dotée d’un capital conséquent abondé notamment par le budget de l’UE, apporte sa garantie financière aux banques nationales qui souhaitent prêter à ces entreprises.
En résumé, l’UE dispose déjà :
- Du cadre budgétaire 2021-2027 qui peut intégrer ce New Deal Européen
- De la stratégie pour soutenir la croissance d’ici à 2030 : la Stratégie Europe 2030
- D’instruments efficaces pour mettre cela en œuvre : Plan à la Juncker et appui de la BEI
Priorité 3 : Pour la zone Euro, stabilisateurs budgétaires automatiques européens et règle budgétaire intelligente
Le cas de la zone Euro mérite enfin d’être abordé spécifiquement. Le troisième défi à relever est en effet celui de la stabilisation des chocs conjoncturels qui frappent les pays membres de la zone euro et la surveillance des finances publiques. Ce sont deux préoccupations majeures restées pour l’instant sans réponse pour l’un, ou une réponse insatisfaisante pour l’autre.
Quel mécanisme de stabilisation des chocs conjoncturels dans l’UEM ?
Il s’agit ici d’un problème spécifique à la zone Euro lié au fait que l’union monétaire créée est loin d’être une zone monétaire optimale[7] dans l’esprit des travaux initiés par Mundell (1961). A nouveau la question posée est celle du partage des tâches : quel niveau de décision publique doit assurer la stabilisation conjoncturelle ? La zone Euro a répondu en partie à cette question puisque la BCE gère déjà de facto les chocs symétriques[8]. Mais ce sont les chocs asymétriques[9] (ou symétriques à effets asymétriques[10]) qui posent problème. Dans ce cas, instaurer un budget spécifique à la zone Euro pour contribuer à l’amortissement de ce type de choc semble pertinent. La crise du covid 19 entre dans ces chocs symétriques à effets asymétriques, et pose à nouveau la question. En d’autres termes, la vocation de ce budget zone Euro serait de jouer un rôle de stabilisateurs budgétaires automatiques complémentaires aux stabilisateurs budgétaires automatiques déjà à l’œuvre au niveau national.
Comment assurer la surveillance des finances publiques dans la zone Euro ?
Cette nouvelle crise que traversent les pays membres de la zone Euro signe définitivement l’acte de mort de l’actuelle règle de discipline budgétaire en vigueur. Cette règle déjà à bout de souffle, devenue inapplicable et incompréhensible suite aux réformes successives (2005, 2011, 2013) apparait incompatible avec la réalité économique, notamment parce qu’elle n’a pas été respectée par de nombreux pays.
La règle initiale du Pacte de Stabilité et de Croissance (1996) était pourtant simple, claire et aurait dû être efficace. Son objectif était double et tout à fait adapté au cadre très particulier de l’union monétaire européenne :
- assurer la « discipline » budgétaire en veillant et surveillant la saine gestion des finances publiques des membres de la zone Euro pour éviter tout risque pour la stabilité financière de l’union monétaire (Pacte « de Stabilité »),
- la flexibilité ( …et « de Croissance ») pour permettre aux États membres de continuer à assurer leurs missions budgétaires et notamment à laisser jouer librement leurs stabilisateurs budgétaires automatiques en cas de choc conjoncturel.
Cette règle avait toutefois deux handicaps majeurs :
- Les cibles de 3 % pour le déficit public et de 60 % pour la dette publique ne correspondent pas à la réalité économique de tous les pays et ont conduit à des coupes budgétaires dramatiques dans certains cas (l’état des hôpitaux dans certains pays européens confrontés à la crise sanitaire actuelle en est une illustration)
- Son manque de crédibilité : la sanction n’a jamais été appliquée, une sanction qu’aucun État membre ne craint vraiment
Plutôt que de s’attaquer à ces faiblesses, les technocrates européens et les États membres ont préféré multiplier les réformes, empiler les couches, ajouter les indicateurs à surveiller. L’actuelle règle est devenue une usine à gaz, un labyrinthe dans lequel même les experts les plus aguerris se perdent.
Profitons de cette période où la règle devra être suspendue par la force des choses étant donné la situation économique européenne.
Il est temps désormais de revenir à l’essence même de la règle et repartir de ces faiblesses pour construire une règle budgétaire intelligente capable de surveiller vraiment la saine gestion des finances publiques qui tienne compte des spécificités structurelles de chaque pays membre mais aussi de l’état de ses services publics fondamentaux pour le bien-être de ses citoyens (santé, éducation, sécurité).
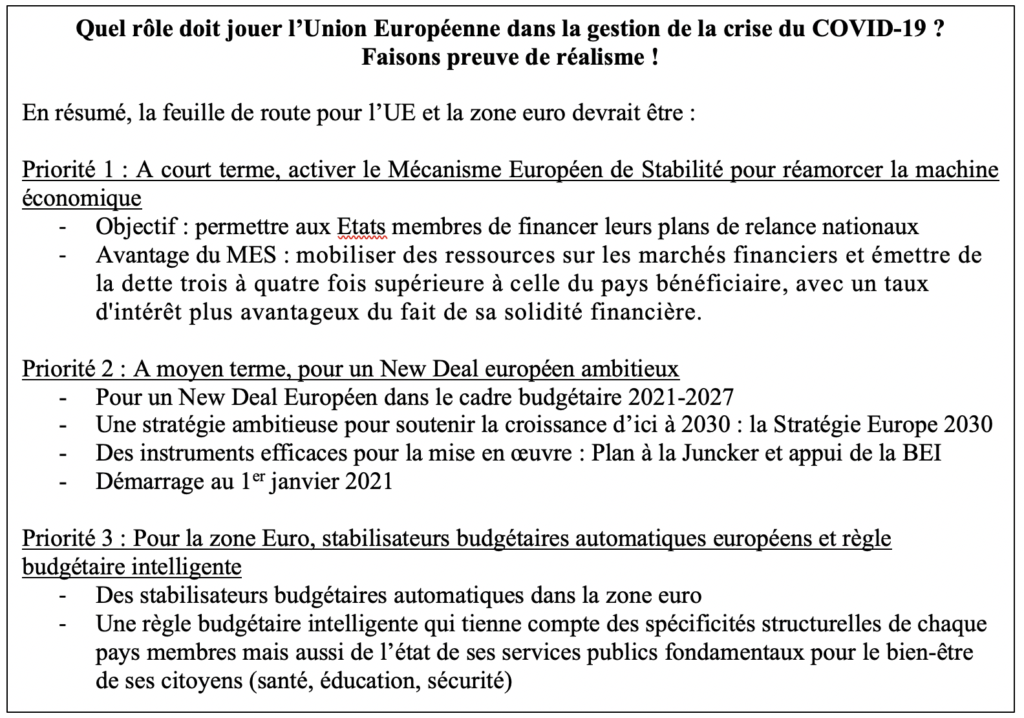
Références bibliographiques
- Avbelj, Matej et al. (2020), “The case for Corona bonds”, SAFE Policy Letter, No. 82, Leibniz Institute for Financial Research.
- Barbier-Gauchard, Sidiropoulos et Vadoudakis (2018), La gouvernance économique de la zone euro : réalités et perspectives, éditions De Boeck.
- Baldwin et Weder di Mauro (Ed) (2020), Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes, CEPR Press, A CEPR Press VoxEU.org eBook
- Barro et alii (2020), “The Coronavirus and the Great Influenza Epidemic Lessons from the “Spanish Flu” for the Coronavirus’s Potential Effects on Mortality and Economic Activity », cesifo working papers, No. 8166, March 2020.
- Benassy et alii (2020), “COVID-19 economic crisis: Europe needs more than one instrument”, VOX, CEPR Policy Portal, avril 2020.
- Blot et alii (2019), “The euro area at the edge of the downturn: Is there any room for manoeuvre?”, Policy Brief, n°60, 12 décembre 2019.
- Eichenbaum et alii (2020), “The Macroeconomics of Epidemics”, NBER Working Paper Series, Working Paper n°26882, April 2020.
- European Commission (2020), Une feuille de route européenne pour la levée des mesures de confinement liées à la pandémie de coronavirus, 15 avril 2020
- Faria-e-Castro (2020), “Fiscal Policy during a Pandemic”, Federal Reserve Bank of Saint Louis, Research Division, Research Papers, Working Paper 2020-006D.
- Fuest et Lohse (2020), « Making the Fight against the Coronavirus Pandemic Sustainable », ifo institute Policy Report, April 2020
- Guttenberg et Hemker (2020), « Coronavirus – Un filet de sécurité européen pour accompagner la réponse budgétaire »,Décryptage, Notre Europe-Institut Jacques Delors, mars 2020.
- IMF (2020), World Economic Outlook, April 2020.
- Jorda et Taylor (2020), « Longer-run Economic Consequences of Pandemics”, NBER Working Paper Series, Working Paper n°26934, April 2020.
- Landais, Saez et Zucman (2020), “A progressive European wealth tax to fund the European COVID response” VOX, CEPR Policy Portal, avril 2020.
- Mc Kinsey (2020), Quarter of Europe’s jobs at risk from coronavirus crisis: report https://www.politico.eu/article/quarter-of-europes-jobs-at-risk-from-coronavirus-crisis-report/
- OFCE (2020), « Évaluation au 30 mars 2020 de l’impact économique de la pandémie de COVID 19 et des mesures de confinement en France », Policy Brief, n°65, 30 mars 2020.
- Stock (2020), “Data Gaps and the Policy Response to the Novel Coronavirus”, NBER Working Paper Series, Working Paper n°26902, March 2020.
[1] Pour un aperçu des mesures prises par chaque pays : https://www.touteleurope.eu/actualite/coronavirus-ce-que-les-etats-membres-ont-mis-en-place.html Pour un aperçu des politiques mises en œuvre par pays : https://www.bruegel.org/publications/datasets/covid-national-dataset/
[2] Le cas du Royaume-Uni reste problématique. Même si le Royaume-Uni a quitté officiellement l’UE depuis le 31 janvier 2020, il reste dans une phase transitoire dont la durée reste encore indéfinie tant les négociations post-brexit entre Boris Jonhson et Michel Barnier sont au point mort. Le Royaume-Uni n’est donc pas totalement hors de l’UE mais pas vraiment en dedans non plus.
[3] Voir Barbier-Gauchard, Sidiropoulos et Vadoudakis (2018), partie 2, chapitre 4 : « Quelle union budgétaire pour l’UE et l’UEM ? » pour un aperçu du concept de fédéralisme budgétaire en théorie et en pratique.
[4] Voir Barbier-Gauchard, Sidiropoulos et Vadoudakis (2018), partie 2, chapitre 4 : « Quelle union budgétaire pour l’UE et l’UEM ? » pour un état des lieux de cette littérature sur la « valeur ajoutée des dépenses européennes ».
[5] Le MES remplace le Fonds européen de stabilité financière (FESF) ainsi que le Mécanisme européen de stabilité financière (MESF), créés dans l’urgence en 2010 pour affronter dans les meilleurs délais la gravité de la crise économique au sein de l’UE. Ces deux mécanismes étaient des instruments ponctuels, instaurés temporairement. N’ayant aucune légitimité juridique, ils ont été fusionnés et consacrés sur forme de traité pour donner naissance au MES qui reprend leurs fonctions.
[6] A la Stratégie de Lisbonne (2000-2010) qui voulait faire de l’UE, « l’économie de la connaissance la plus compétitive au monde » a succédé la Stratégie Europe 2020 (2010-2020) destinée à soutenir une « croissance intelligente, durable et inclusive » dans l’UE.
[7] Une zone monétaire optimale est une zone géographique à l’intérieur de laquelle il est optimal (en termes de stabilisation conjoncturelle des chocs notamment) d’adopter la même monnaie. En d’autres termes, dans cette zone monétaire, le perte de l’usage de l’instrument monétaire par les membres de cette zone est compensée par l’existence de mécanismes alternatifs suffisants pour prendre le relai de la stabilisation conjoncturelle (mobilité du travail et du capital, flexibilité des salaires, spécialisation de la production, intégration financière, fédéralisme budgétaire …).
[8] Un choc conjoncturel symétrique est un choc qui frappe tous les pays en même temps et dans les mêmes proportions (exemple : les chocs pétroliers dans les années 70).
[9] Un choc conjoncturel asymétrique est un choc qui frappe un pays en particulier, sans affecter les autres (exemple : la chute du mur de Berlin en 1989).
[10] Un choc conjoncturel symétrique à effets asymétriques est un choc qui frappe tous les pays en même temps mais dans des proportions différentes (exemple : la crise des subprimes en 2008, la crise du COVID 19 peut également être considéré comme tel).
Une analyse sur le fil du rasoir : que faire pour la dette publique ?
La gestion de cette crise du Covid-19 va laisser des traces : la dette publique française est censée atteindre 115% du PIB d’ici la fin de l’année, avec un déficit public à plus de 9% du PIB. Les journaux affûtent déjà leurs titres sur cette «montagne de dettes », comme si l’Etat français devait rembourser immédiatement toute la dette française. Les déclarations et tribunes contradictoires s’enchaînent, renforçant l’incertitude et le caractère anxiogène du moment présent.
N’en déplaisent aux idéologues de tout poil, trois enseignements semblent émerger :
- Les économistes doivent rester humbles sur leur capacité à fournir des préconisations de politique économique, mais ne doivent pas pour autant laisser la parole aux diseurs de bonne aventure et autres pseudo-savants, où le verbe est si haut et la réflexion si basse.
- En l’absence de nouvelles circonstances extrêmes, la soutenabilité de la dette publique française devrait être préservée, grâce aux potentialités de reprise économique et à l’intervention de la Banque Centrale Européenne.
- Cela ne signifie pas pour autant que le contrôle de la dette publique n’est pas un enjeu : certaines mesures de politique économique doivent être prises, mais cela ne signifie pas forcément une politique de rigueur ou une annulation de dette.
Les chiffres peuvent laisser pantois, le déficit public de cette année signifie que plus de 210 milliards de dépenses supplémentaires vont creuser notre dette publique (ou notre tombe selon certains journaux). Cela semble indiquer que chaque français va devoir rembourser 3200 € d’argent public, rien que du fait de cette crise. Et qu’étant donné notre « gravissime » dette publique, chaque français doit au final payer près de 42 000€ de dette publique. Mais cette vision est tronquée. Sans chercher à être exhaustif, voici un rappel d’éléments connus des économistes :
- La dette publique se rembourse dans le temps, à l’instar d’une dette immobilière pour un ménage. Le lissage temporel de l’endettement est une vertu. Le nier reviendrait à dire qu’un crédit immobilier pour un ménage est toujours une mauvaise affaire…
- La dette publique n’a pas vocation à être égale à zéro. Même l’Allemagne, le meilleur élève en termes d’ équilibre budgétaire, n’a pas un tel objectif. Le frein constitutionnel allemand, en place depuis 2009, cherche bien à fortement limiter les déficits mais la dette publique allemande converge vers 60% et non zéro.
- La dynamique de la dette publique dépend aussi de la charge à payer, et notamment du taux d’intérêt. Pour la dette publique française, il s’agit du taux des OAT à 10 ans. Derrière ce nom barbare se cache le taux des obligations assimilables du Trésor français sur une maturité de 10 ans. Il oscille entre 0% et 1% depuis 2015 : les investisseurs prêtent donc facilement de l’argent à l’Etat français, pensant actuellement que la situation de la dette publique est soutenable. Cela ne signifie certes pas que les investisseurs signent un chèque en blanc à l’Etat français et les taux sont susceptibles de remonter, mais cela ne semble pas le cas actuellement. Il semble plus logique de faire confiance à l’avis d’un investisseur qui cherche à être rentable qu’à l’avis d’éditorialistes avides de sensations fortes.
- Le déficit per se n’est pas une bonne ou une mauvaise chose. Tout dépend ainsi de l’utilisation de l’argent public : une distinction usuelle entre déficit conjoncturel et déficit structurel peut être mobilisée. Le premier est celui existant dans les périodes de ralentissement, voire de récession : les recettes fiscales baissent du fait de la moindre activité et l’Etat dépense davantage, notamment du fait des allocations chômage et des plans de relance. Le déficit structurel correspond au déficit public existant hors de ces aspects conjoncturels. Ainsi, le déficit conjoncturel paraît moins dangereux que le déficit structurel et la crise du Covid-19 est a priori conjoncturelle.
Il faut néanmoins ne pas s’arrêter à cette vision. Certes, le catastrophisme annoncé est trompeur, mais il ne faut pas pour autant nier les risques associés. Ne pas maîtriser la dette, c’est s’exposer à deux enjeux :
- La dette publique française pourrait être tellement importante que l’Etat pourrait être tenté d’annuler une partie de cette dernière. Or, cela n’est pas à priori la meilleure solution, rien qu’au vu des précautions de langage : on parle généralement de restructuration de dette et non pas d’annulation de dettes. Cela n’est certes pas exactement la même chose, mais la précaution reste de mise. D’ailleurs, le dernier processus de restructuration concernait la dette grecque et il a fallu d’intenses négociations entre pays européens pour arriver à un tel résultat. De même, le taux des OAT à 10 ans est faible actuellement, parce que les investisseurs anticipent un faible risque de défaut. Mais ce taux était plus élevé pendant la période de la crise des dettes souveraines et on peut légitimement penser qu’il serait encore plus élevé si une partie de la dette française venait à être restructurée.
- La dette publique française pourrait être rachetée par la Banque Centrale Européenne à un rythme encore plus élevé que depuis le programme d’achats d’obligations souveraines lancé en 2015. La banque centrale pourrait aussi intervenir massivement pour calmer toute éventuelle attaque spéculative, mais il ne faut pas oublier que le bilan de la BCE a été multiplié par 4 depuis 2007. En d’autres termes, la BCE a accepté d’acheter une quantité massive d’obligations souveraines et privées pour soutenir l’économie européenne, mais s’expose à des risques de défaut. Si une entreprise fait défaut ou qu’un Etat cherche à restructurer sa dette publique, c’est bien la BCE qui se retrouve in fine avec ce défaut dans ses comptes. Or la forte hausse du bilan de principales banques centrales (FED, BCE, Bank of Japan, Bank of England) est du jamais été vu dans l’histoire des banques centrales. Le consensus sur ces dernières années était d’ailleurs la lente réduction de la taille de ces actifs, et non pas une ré-augmentation. Quel seuil dans la taille du bilan une banque centrale ne doit pas franchir ? Nous n’avons pas encore les réponses…
La maîtrise de la dette doit donc occuper nos esprits, sans être l’alpha et l’oméga de la politique économique. Dans ce jeu d’équilibriste, tout besoin de politique de relance ou de rigueur doit être pesé. Le Ministre de l’Economie a d’ailleurs cherché à rassurer sur l’absence de future hausse d’impôts ou de future politique de rigueur, mais ces annonces seront d’autant plus convaincantes que deux autres politiques seront considérées :
- Le caractère soutenable de la dette publique réside surtout dans l’identité des créditeurs. Cela pourrait inspirer une politique française de l’épargne, afin de l’orienter vers certains secteurs d’activités et/ou la dette publique française. Deux exemples peuvent éclairer ce point, à savoir l’Argentine et le Japon. La dette publique argentine au début des années 2000 était essentiellement possédée par des fonds spéculatifs. C’était clairement le moment où les craintes de restructuration de dettes étaient importantes : difficile de dissocier la cause de la conséquence, mais cela doit être médité. A l’inverse, la dette publique japonaise est détenue à 95% par des résidents nippons, notamment à travers les livrets d’épargne proposés par la poste et les banques nippones. Cette dette publique nippone est stable, alors même qu’elle dépasse plus de 250% du PIB ! Dès lors, pourquoi ne pas considérer une nouvelle politique de l’épargne à la française ? Le rendement de cette dette publique est certes faible, mais il pourrait être utilisé dans un portefeuille plus large de titres de dettes.
- Deux principes sont centraux dans la politique fiscale : avoir l’assiette fiscale la plus large possible et proposer le taux d’imposition le plus faible possible. En contraste, quels sont les débats les plus connus, à l’heure actuelle ? La taxation des ménages les plus riches, la modification ou non de l’impôt de solidarité sur la fortune, le choix du taux de la plus haute tranche marginale… Mais ces débats sont difficiles à trancher et à faire accepter. Pourquoi ne pas se recentrer sur la taxe sur les transactions financières ? Cette taxe existe en France depuis 2012 et a connu une augmentation en 2017, mais elle reste dans un cas bien français, donc facilite les évitements par les acteurs boursiers. Pourquoi donc ne pas relancer cette proposition, à la fois sur la hausse de la valeur de cette taxe et sur l’échelle européenne ? Cette proposition est a priori efficace en termes de rentrées fiscales et serait politiquement accepté. Le mécanisme juridique associée à une telle taxe et à une telle flexibilité est la « coopération renforcée », il s’agit d’une coopération volontaire de certains pays de l’UE seulement, permettant d’éviter l’adoption à l’unanimité par le Conseil Européen.
Un moment Hamiltonien pour l’Europe… Une histoire sans fin ?
Dans ces temps troublés pour l’économie mondiale plongée dans un coma artificiel, l’union monétaire européenne est sur la brèche. Les pays qui s’opposent à toute forme de mutualisation ordonnée de la dette empêchent de facto la survenance d’un moment Hamiltonien pour l’Europe. Sans ce saut fédéral, il existe de réels risques d’implosion de la zone euro et, même, de l’Union Européenne dans son ensemble. Cette courte note tente d’expliquer en quoi l’expérience des États-Unis pourrait être source d’inspiration pour les Européens dans une période où le concept d’incertitude radicale est particulièrement pertinent.
Cygnes noirs et cygnes blancs
Comme le souligne le philosophe Edgar Morin, nous vivons une période pleine d’incertitudes. Nous n’avons pas assez de connaissances sur les origines du virus, ses mutations potentielles, les populations les plus susceptibles d’être infectées, sa dangerosité globale… Nous n’en savons tout simplement pas assez. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent en temps normal, la vie elle-même est pleine d’incertitudes. Le principal message d’Edgar Morin est que nous devons attendre l’inattendu. Ce simple et puissant message philosophique a des implications gigantesques sur la manière dont nous construisons nos modèles théoriques et empiriques pour prévoir les évolutions économiques et financières.
Pour complètement saisir les implications de la vision d’Edgar Morin, nous devons clarifier la manière dont nous définissons le concept d’incertitude. Pour y parvenir, nous pouvons commencer par la définition donnée par Nassim Taleb au fameux « Cygne Noir » (Times, 2020). Un Cygne Noir est « un événement inattendu d’ampleur et de conséquence considérables qui aurait pu être anticipé ». Dans cette perspective, un Cygne Blanc est « un événement attendu d’ampleur et de conséquence considérables (par conséquent, il a été anticipé) ». Plusieurs observateurs, dont Roubini (2020), pensent que la pandémie actuelle est un Cygne Blanc, non pas un Cygne Noir, en raison des nombreux avertissements lancés par les épidémiologistes sur la possibilité d’épisodes pandémiques extrêmes suite aux épisodes épidémiques du SRAS en 2002-2003 et de la crise du MERS au Moyen-Orient à partir de 2012.
Néanmoins, il existe un troisième type d’incertitude qui fait référence au concept d’Incertitude Radicale introduite par Frank Knight et défendue par John Maynard Keynes. Ce concept est proche de l’« Incertitude Espace État » introduite par Bradley et Drechsler (2014). Ce type d’incertitude peut être défini de la manière suivante « l’Incertitude Espace État surgit lorsqu’un agent est conscient de la possibilité qu’elle a complétement oublié un état du monde de l’espace état ». Dans ce cas, l’ajout d’un état du monde supplémentaire regroupant tous les autres états du monde possible ne réduit pas l’incertitude puisque les agents ne savent pas quels sont les événements qui sont inclus dans cet ultime état du monde et, ainsi, ils ne pourront pas attribuer de probabilités à ces différents événements. Nous ne savons tout simplement pas, comme le note Keynes. Un événement caractérisé par l’Incertitude Radicale est un événement inattendu d’ampleur et de conséquence considérables qui n’aurait pas pu être anticipé.
Quelques leçons de l’Histoire
Comme nous l’avons vu dans la section précédente, la période actuelle est caractérisée par de nombreuses sources d’incertitude. Même s’il est difficile de déterminer quel concept décrivant l’incertitude est le plus pertinent pour analyser le futur proche. Il est assez clair que les prévisions économiques et financières sont profondément affectées par ces incertitudes. En effet, la plupart des prévisions économiques et financières faites au début de cette année, sur la croissance mondiale par exemple, sont obsolètes et non-pertinentes à présent. D’un point de vue conceptuel, il est loin d’être impossible que les prévisions actuelles connaissent le même destin. Par conséquent, il peut être utile de nous tourner vers l’Histoire.
Ryan et Loughlin (2018) analysent les expériences historiques de trois unions monétaires à savoir l’Union Monétaire Latine, l’Union Monétaire Scandinave et l’Union Monétaire Austro-Hongroise. Dans une tentative visant à glaner quelques leçons pour l’Union Monétaire Européenne, ils concluent que ces unions monétaires n’ont pas survécu à la Première Guerre Mondiale pour deux raisons principales, d’une part, les rivalités nationales, et d’autre part, la non-existence d’institutions robustes telle qu’une banque centrale commune et politique budgétaire unifiée. De plus, pour compléter les deux conclusions précédemment citées, ils soulignent trois autres points dans leur comparaison avec l’Union Monétaire Européenne, à savoir la fragilité des unions monétaires dans l’histoire, l’importance de la convergence économique pour ancrer les arrangements institutionnels dans la réalité économique et financière, et l’importance des institutions pour endiguer l’aléa moral.
Lorsque la crise de l’euro se termina fin 2012, quelques observateurs ont essayé de mettre en perspective l’expérience européenne en la comparant avec l’histoire monétaire américaine. Par exemple, Gaspar (2015) propose d’explorer les débuts de l’expérience historique des États-Unis pour essayer de récolter quelques enseignements pour les Européens. Il étudie le rôle décisif d’Alexander Hamilton, le premier secrétaire au Trésor. Lors de son arrivée en 1789, le gouvernement fédéral était en situation de défaut. Après son départ en 1795, les bons du Trésor américains sont devenus les actifs financiers les plus sûrs. Par ailleurs, il souligne que ce moment Hamiltonien illustre parfaitement la conjonction de trois domaines enchevêtrés : la politique, la politique budgétaire et les activités financières.
De surcroît, il essaye de tirer des leçons de ce moment Hamiltonien et souligne que ces trois domaines précédemment cités (c.-à-d. la politique, la politique budgétaire et les activités financières) sont enchevêtrés de manière complexe et qu’ils constituent une myriade de problèmes systémiques qui nécessite des solutions systémiques.
Assurément, la politique est très importante. Dans ce domaine, Gaspar souligne trois points fondamentaux. Le premier point fondamental concerne des problèmes de redistribution entre États Membres (des actifs nationaux restants après la mutualisation) et à l’intérieur même des États Membres (entre générations). Ensuite, le second point fondamental concerne les finances publiques. En Europe, elles ont une place particulière car elles sont au cœur du contrat social. L’État-Providence semble bien loin de la conception minimaliste d’Hamilton. Au dix-huitième siècle, la majorité de la dette américaine a été accumulée pour financer la Guerre d’Indépendance, donc pour des « raisons fédérales ». Ce n’est pas le cas pour les Européens du vingtième et vingt-et-unième siècles où la majeure partie de la dette a été accumulée pour des « raisons nationales », pour financer l’État-Providence après les crises énergétiques des années 1970. Pour finir, le troisième point fondamental sur le plan politique concerne la nature du système politique lui-même. En effet, l’Union Européenne est basée sur un système politique inter-étatique (inter-national). Cette construction institutionnelle originale trouve son origine dans la tragédie de la Seconde Guerre Mondiale.
De plus, la soutenabilité des finances publiques est essentielle. En effet, nous pouvons considérer au même titre que Gaspar que les membres d’une fédération à part entière doivent adopter des règles pour éviter la banqueroute (ce fut le cas pour plus de la moitié des État américains après une série de faillites entre 1841 et 1842). Dans le même temps, un membre d’une fédération ne peut pas émettre sa propre dette au nom de la fédération. Ainsi, l’importance d’une clause de non-renflouement est essentielle pour assurer la viabilité de la fédération. Aux États-Unis, comme le note Gaspar, il a fallu que la Constitution remplace les Articles de la Confédération, ce qui n’est pas un petit changement.
En outre, une union politique et économique doit disposer des moyens de financement de ses dépenses publiques. Plus simplement, si l’endettement public et, par conséquent, les dépenses publiques sont regroupées au niveau fédéral, alors la fédération doit disposer d’un pouvoir de taxation. Autrement, la soutenabilité des dépenses publiques reposera sur les épaules des États Membres (comme dans l’Union Monétaire Européenne) et sera sujette à des rivalités nationales qui pourront compromettre sa stabilité financière.
Ces deux derniers points, (i) la politique et (ii) la soutenabilité des dépenses publiques suffisent à souligner les grandes différences entre la crise actuelle et l’époque d’Alexander Hamilton. Même si le Président de la République, Emmanuel Macron a déclaré que « Nous sommes en guerre » (Le Monde, 2020), on peut se demander si la crise causée par la pandémie actuelle mènera vers un bien commun supérieur comme la Guerre d’Indépendance l’a fait pour les Treize Colonies. Pour finir, on peut citer le bon mot du regretté Paul Volcker en 2012 après la crise de la zone euro : « comme je le vois, l’Europe est à un moment Hamiltonien, mais il n’y a pas d’Alexander Hamilton à l’horizon ».
Eurobonds contre bons Hamiltoniens
Lorsque la crise de l’euro se termina fin 2012, l’opposition à toute forme de mutualisation de la dette était assez répandue parmi les politiciens et au sein des cercles économiques. Quelques voix ont soutenu que l’Union Monétaire Européenne ne pourrait pas survivre sans un saut fédéral en matière d’intégration économique et politique. Quelques pays étaient opposés à toute forme de mutualisation de la dette principalement en raison d’une logique basée sur le concept d’aléa moral. En effet, en l’absence d’une intégration politique complète, plusieurs observateurs croyaient fermement que les pays non-vertueux pourraient être tentés de mener des politiques budgétaires insoutenables. Ce qui, par conséquent, mettrait en danger la santé financière de l’Union Européenne dans son ensemble. Cette logique a un fond de vérité, mais elle passe à côté d’éléments essentiels puisque nous pouvons considérer que les pays périphériques du Sud de l’Europe ont joué le rôle de consommateur en dernier ressort (Geerolf and Grjebine, 2020). En effet, ces deux logiques à savoir la première, des pays périphériques non-vertueux au Sud de l’Europe et donc non-préparés pour faire face aux crises, et la seconde, des pays périphériques au Sud de l’Europe vus comme des consommateurs en dernier ressort sont clairement incompatibles comme en témoignent les tensions entre Wopke Hoestra, le ministre des finances des Pays-Bas, et António Costa, le premier ministre du Portugal à la fin du mois de mars.
Lors de cette crise si particulière, l’opposition à toute forme de mutualisation de la dette semble être de plus en plus faible. Plusieurs observateurs comme Darvas (2020) soulignent que les mesures récentes prises par la gouvernance européenne pourraient ne pas suffire pour éviter les pressions des marchés financiers dans un avenir proche et qu’une mutualisation partielle de la dette sera nécessaire. Reichlin (2020) va plus loin en soutenant que cette crise pourrait être une opportunité pour améliorer la coordination budgétaire en cas d’événements catastrophiques. Ces changements dans le consensus économique et dans la sphère politique sont bienvenus, mais, comme bien souvent, le diable est dans les détails (Tanzi, 2020).
Alors qu’il est clair que les pays qui s’opposent à toute forme de mutualisation de la dette empêchent de facto la survenance d’un saut fédéral qui est désespérément nécessaire pour compléter l’union monétaire, il est moins clair que toutes les formes de mutualisation de la dette vont nécessairement entraîner une plus grande résilience de l’union monétaire à des chocs exogènes violents. En effet, deux conditions semblent nécessaires (mais probablement non-suffisantes) pour réaliser une mutualisation ordonnée de la dette. Premièrement, une partie des pouvoirs de taxation devront être transférés au niveau de l’union monétaire. Deuxièmement, des mécanismes qui empêchent la conduite de politiques budgétaires insoutenables (c.-à-d. une clause de non-renflouement) devront être créés. Sans ces deux conditions qui doivent être décidées par les institutions démocratiques nationales, une mutualisation désordonnée de la dette aura les mêmes effets que pas de mutualisation du tout (c.-à-d. des risques de désintégration économique et politique pour l’union).
Sans les conditions précédemment citées, les propositions visant à mutualiser tout ou partie de la dette restent dans la même logique, pas celle d’Hamilton. En effet, la dette sera émise par chaque État Membre mais sera garantie par tous les pays de la zone euro. Kluth (2020) fait une analogie intéressante. Les propositions d’Eurobonds sont équivalentes à une situation où la Californie émet sa dette et que tous les autres États américains la garantissent. Il est aisé de comprendre pourquoi le Texas, par exemple, n’aurait aucun intérêt à participer à un tel schéma institutionnel. De plus, la réaction des Californiens pourrait être très amère si les Texans débarquaient à Sacramento pour professer des coupes budgétaires. Wolff (2020) fait la même analogie pour le cas de la République fédérale d’Allemagne. Remplacer le Texas par l’Allemagne et la Californie par l’Italie et vous verrez pourquoi nous avons besoin de bons Hamiltoniens et pas d’Eurobonds.
Notes/Références
(*)L’auteur remercie Katharina Priedl pour une relecture attentive.
- Richard Bradley, Mareile Drechsler. Types of Uncertainty. Erkenntnis 79, 1225- 1248 (2014). Consulté sur URL.
- Zsolt Davras. The fiscal consequences of the pandemic. Bruegel. Consulté le 22 avril 2020. Consulté sur URL.
- Vitor Gaspar. The Making of a Continental Financial System: Lessons for Europe from Early American History, Journal of European Integration, 37:7, 847-859 (2015). Consulté sur URL.
- François Geerolf, Thomas Grjebine. Coronavirus : « L’Europe doit cesser son jeu de dupes ». CEPII le Blog. Consulté le 22 avril 2020 sur URL.
- Andreas Kluth. Corona Bonds Could Save the Euro or Sink It. Bloomberg. Consulté le 21 avril 2020 sur URL.
- Paul Krugman. Notes on the Coronacoma (Wonkish). The New York Times. Consulté le 13 avril 2020 sur URL.
- Le Monde. ‘Nous sommes en guerre’ : le verbatim du discours d’Emmanuel Macron. Consulté le 21 avril 2020. Consulté sur URL.
- Edgar Morin. Nous devons vivre avec l’incertitude. CNRS Le journal. Consulté le 6 avril 2020 sur URL.
- Lucrezia Reichlin. COVID-19 Is an Opportunity for Europe. Project Syndicate. Consulté le 22 avril 2020 sur URL.
- Nouriel Roubini. The White Swans of 2020. Project Syndicate. Consulté le 18 avril 2020 sur URL.
- John Ryan, John Loughlin. Lessons from historical monetary unions – is the European monetary union making the same mistakes? International Economics and Economic Policy 15, 709–725 (2018). Consulté sur URL.
Les limites de la politique monétaire face à la pandémie de Covid-19
La pandémie de Covid-19, du fait de la forte capacité de contagion du nouveau coronavirus, de la difficulté à le détecter, d’un taux élevé de mortalité chez les personnes âgées contaminées, de l’absence d’un traitement efficace et peu coûteux, et de l’indisponibilité dans l’immédiat des vaccins, a obligé de nombreux pays à adopter des mesures de confinement sans précédent pour limiter la contagion et l’effondrement des systèmes de santé afin de sauver des vies humaines. Cela a induit des conséquences économiques graves. Ce blog analyse brièvement ces conséquences et l’utilité de la politique monétaire face à une telle situation.
Les effets économiques de la pandémie
En réponse à la Covid-19, deux options opposées se présentent. La première consiste à laisser développer la pandémie et donc l’immunité collective. Cette option a été initialement envisagée par le gouvernement britannique mais finalement abandonnée suite aux critiques virulentes. Si cette méthode avait été adoptée, beaucoup de personnes pouvant être sauvées ne pourraient pas l’être à cause de la surcharge du système de santé. Aucun dirigeant politique ne peut porter la responsabilité d’adopter une telle option qui débouche sur des conséquences catastrophiques en termes de vies humaines simplement pour préserver quelques points de pourcentage du PIB. De plus, il est incertain que l’absence de confinement officiel empêche les effets négatifs importants de la pandémie sur l’économie. Beaucoup de personnes auraient tendance à pratiquer l’auto-confinement en s’interdisant d’aller dans des lieux à forte fréquentation. En l’absence de mesures de contrôle vigoureuses, le nombre de malades atteints du coronavirus pourrait augmenter de façon exponentielle, ce qui obligerait quand même beaucoup de secteurs à réduire fortement leurs activités par manque de personnels et en raison d’une baisse de la demande pour les biens et services.
La deuxième option, celle du confinement, pratiquée plus ou moins strictement dans beaucoup de pays, vise à réduire le nombre de personnes atteintes de la Covid-19 à un niveau inférieur à celui que les systèmes de sante peuvent gérer sans grande difficultés. Un confinement très strict et respecté par tous les citoyens permet d’éliminer la pandémie en moins de deux mois. Plus tôt les mesures sont adoptées, plus elles seront efficaces. A part les secteurs liés à la santé et aux besoins essentiels, dont certains sont même favorisés par la pandémie, le confinement affecte très négativement des pans entiers de l’économie avec certains secteurs quasiment à l’arrêt. Les entreprises et les salariés de ces secteurs subissent des pertes de revenus très importantes, que les aides publiques et les allocations diverses ne compensent que partiellement. Des entreprises financièrement vulnérables peuvent faire faillite et d’autres vont voir leurs résultats et leurs bilans se dégrader fortement. La baisse de la demande aurait des conséquences dramatiques pour les secteurs fournissant des produits et services non essentiels à la vie quotidienne même quand les entreprises dans ces secteurs peuvent produire et vendre. Ce problème pourrait persister lors de la phase de déconfinement si le coronavirus continue à circuler dans la population.
A la mi-avril 2020, la France a révisé la croissance de 2020 à –8 % et un déficit budgétaire à 9 % du PIB, contre un taux de croissance de +1,1 % et un déficit budgétaire de 2,2 % prévus fin 2019. Ces prévisions donnent une première idée de l’importance des effets macro-économiques de ce choc sanitaire. La baisse du PIB cache une distribution très inégale des pertes de revenus entre les différents acteurs économiques. Les mesures compensatoires pour limiter les impacts économiques de la Covid-19, à savoir apporter des aides financières pour maintenir les entreprises en vie et accorder des aides aux ménages en difficulté, vont se traduire par un accroissement important et durable de la dette publique. Les effets de ce choc pourraient durer longtemps après la crise du coronavirus. Ils deviendraient persistants via une forte dégradation des bilans des entreprises et des banques et une hausse spectaculaire des déficits budgétaires et des dettes publiques des gouvernements nationaux.
Les facteurs susceptibles d’aggraver les risques macroéconomiques
La réduction drastique des activités économiques dans de nombreux secteurs peut entraîner une hausse de défaillances des entreprises et un accroissement du nombre de ménages ne pouvant pas rembourser leurs crédits, causant ainsi des pertes importantes aux banques. Il est donc plus probable que certaines banques connaissent de grandes difficultés dans les prochains mois. Etant donné l’importance du secteur bancaire dans l’économie, une transmission des effets économiques de la pandémie de Covid-19 vers le secteur bancaire pourrait induire l’instabilité financière et rendre la récession économique en cours plus sévère.
Ce risque est d’autant plus important que le cycle d’expansion montrait déjà des signes de faiblesse avant la pandémie. La pandémie apparaît dans un contexte où la croissance est soutenue par des politiques monétaire et budgétaire extrêmement accommandantes, qui ont porté la croissance du PIB au-dessus du potentiel à long terme dans un certain nombre de pays industrialisés. En fait, les mesures d’assouplissements quantitatifs mises en place après la grande crise financière de 2008 ne sont à peine levées. Les taux d’intérêt directeurs est au plus bas dans la zone euro. Ils ne sont que faiblement et prudemment relevés aux Etats-Unis. La marge de manœuvre de la politique monétaire n’est pas reconstituée par des hausses significatives des taux d’intérêt comme dans les cycles précédents. La politique budgétaire très accommandante a induit des déficits budgétaires élevés et des dettes publiques croissantes dans beaucoup de pays industrialisés au cours des dix dernières années. Beaucoup de gouvernements renoncent à créer un espace budgétaire en vue d’une politique de relance ou de soutien à l’économie en cas de crise économique et financière majeure.
La croissance après la grande crise financière de 2008 dépend aussi excessivement de l’effet de richesse et de bilan : la hausse exceptionnelle des cours boursiers depuis mars 2009 portée par des politiques monétaire et budgétaire extrêmement accommodantes pousse les ménages à dépenser plus. Le retour de la balançoire peut apporter de très mauvaises surprises aux économies qui manquent de moteurs de croissance. Le récent krach boursier suite à l’aggravation de la situation sanitaire au niveau mondial est susceptible de réduire significativement la demande des ménages pour les biens et services et donc la croissance. La baisse des prix des actifs peut aussi impacter négativement des entreprises et des banques qui possèdent un montant important d’actifs financiers dans leurs bilans, serrant ainsi les contraintes de financement de ces entités.
En partant du somment d’un cycle d’expansion basée excessivement sur l’endettement public et privé, il est fort probable de voir certains emprunteurs publics et privés d’importance systémique rencontrer des difficultés majeures suite à la récession économique importante en cours. Une crise financière pourrait se déclencher suite à la récession économique et viendrait à son tour aggraver la récession en cours. Par exemple, la chute vertigineuse du prix de pétrole jusqu’à un niveau négatif pour certains contrats à terme[1] suite à la forte baisse de sa demande, sans nier les effets favorables pour les utilisateurs des produits pétroliers, causerait de graves difficultés budgétaires pour les pays exportateurs du pétrole. Cette baisse du prix du pétrole pourrait aussi mettre à genoux des entreprises qui extraient du pétrole à coûts élevés, notamment le secteur du pétrole de schiste aux Etats-Unis, et donc des institutions financières qui les financent. La récente évolution du prix du pétrole à elle seule constitue un important facteur pouvant déclencher une crise financière internationale.
La forte interdépendance des productions entre les différents pays constitue aussi un facteur majeur aggravant les risques macroéconomiques dans les pays largement ouverts aux échanges extérieurs. Ce risque est amplifié du fait que la Covid-19 entraîne plus facilement des ruptures importantes dans les chaînes de production et d’approvisionnement qui relient les entreprises réparties à travers le monde. Les obstacles mis en place pour réduire l’inter-connectivité des économies empêchent le bon fonctionnement de l’économie mondiale et aggravent la récession. Tant qu’on n’a pas trouvé de traitements et vaccins efficaces, la lutte contre le nouveau coronavirus ne s’arrêtera pas. Des mesures de confinement même allégées seront toujours nécessaires s’il y a des pays ou des régions où la pandémie persiste. Les mesures de restriction du transport des marchandises et de la mobilité des personnes peuvent affecter durablement l’économie mondiale, et plus particulièrement certains secteurs susceptibles d’être le vecteur de diffusion du coronavirus.
Par ailleurs, la crise sanitaire actuelle aggrave les difficultés budgétaires d’un certain nombre d’Etats et pourrait causer la défaillance de certains parmi eux. Ces défaillances affecteront les secteurs financier et non-financier du pays concerné, et éventuellement les marchés financiers internationaux s’il y a une forte participation étrangère au financement de l’Etat défaillant et du secteur financier national en crise. De telles crises, par effet de contagion, peuvent rendre l’ambiance sur les marchés financiers internationaux délétère, provoquer une fuite des investisseurs vers les actifs de qualité et détériorer gravement la situation financière d’autres Etats dont le niveau d’endettement est déjà élevé suite aux déficits budgétaires massifs entraînés par la pandémie de Covid-19, créant ainsi des risques de crises de dette souveraine et même des crises bancaires auto-réalisatrices.
L’efficacité de la politique monétaire
Les banques centrales visent principalement à stabiliser l’inflation et la production. Depuis la grande crise financière de 2008, certaines banques centrales s’octroient implicitement ou explicitement une responsabilité en matière de stabilité financière, ce qui se traduit pour elles par un rôle significatif dans la surveillance macro-prudentielle, une communication active avec les opérateurs des marchés financiers, et même la mise en œuvre des mesures de soutien en cas de forte baisse des prix des actifs.
Avant l’actuelle crise sanitaire, les taux d’intérêts fixés par les banques centrales dans les pays développés sont proches des niveaux historiquement bas. Une telle politique du taux d’intérêt est un soutien important pour les prix d’actifs financiers et réels, faisant reposer une part significative de la croissance sur les effets de richesse et de bilan positifs. Le fait que les banques centrales n’ont pas constitué des marges de manœuvre suffisantes signifie qu’elles ne peuvent pas apporter un soutien massif dans une crise majeure où les effets de la pandémie de Covid-19 viennent s’ajouter à un risque accru de récession cyclique après plus de 10 ans d’expansion économique. Les quelques petites baisses des taux d’intérêt par les banques centrales depuis la crise sanitaire feront peu d’impacts sur l’économie. Dans certains pays, les banques souffrent même des taux négatifs appliqués sur les réserves excédentaires depuis un certain temps.
Les taux d’intérêt bas ont montré leur limite en tant que stimulus de la croissance. Ce type de politique opère une redistribution de richesse entre les emprunteurs et les épargnants. L’efficacité de la politique repose sur une dépense accrue des emprunteurs et peut se réduire suite à un changement de comportement chez les épargnants. Ces derniers, au lieu de baisser leur épargne face à la baisse des taux, pourraient augmenter leur effort d’épargne pour atteindre un objectif d’épargne fixé initialement, annulant ainsi en partie l’effet stimulant de la politique du taux d’intérêt bas. De plus, la pandémie de Covid-19 pourrait inciter les ménages à épargner davantage et les entreprises à réduire leur endettement dans le futur. Il s’agit notamment de ceux qui ont durement éprouvé des difficultés financières durant cette période de crise.
Malgré la marge de manœuvre faible au niveau de la politique des taux, les banques centrales peuvent toujours jouer un rôle important en mettant en place des mesures de politique monétaire non-conventionnelles, notamment l’achat massif d’emprunts publics et privés à des maturités différentes et à des degrés de risques variés. Dans un contexte où des déficits budgétaires massifs doivent trouver des sources de financement, ces mesures non-conventionnelles permettent notamment de réduire les tensions sur les marchés des dettes publiques et privées. Cela évite une forte hausse généralisée des taux d’intérêt et rend plus aisé le financement des Etats et des entreprises privées, réduisant ainsi le risque de crises bancaire et de dette souveraine. Ce type de risque est particulièrement élevé dans la zone euro au vu de ses contraintes institutionnelles.
La politique monétaire ne pourrait pas être considérée comme la mesure miraculeuse pour effacer les impacts économiques négatifs graves de cette crise sanitaire malgré qu’elle ait une certaine efficacité pour atténuer les effets négatifs de la pandémie sur l’économie et pour assurer la stabilité financière en empêchant notamment l’apparition des cercles vicieux des crises économique et financière. En particulier, la politique monétaire ne pourrait pas compenser la baisse du revenu qui est bien réel et important. Une hausse de la quantité de monnaie via des crédits bancaires ne produit pas de richesse que dans certaines situations : celles qui sont caractérisées par les contraintes de financement et de liquidités importantes qui empêchent le compromis intertemporel optimal entre les consommations présente et future des ménages, et limitent la production et l’investissement des entreprises ; ou encore celles, plutôt rares, où les mauvaises anticipations ont conduit l’économie vers un mauvais équilibre avec des activités économiques anormalement basses. Dans ces situations, une hausse de crédit à l’économie peut générer une croissance supplémentaire sans inflation.
Face aux difficultés financières actuelles des entreprises, injecter simplement des liquidités dans le système financier ne suffit ni pour endiguer la baisse des prix d’actifs ni pour effacer les effets de la crise sanitaire sur les activités économiques. Des mesures de politique monétaire peuvent être prises pour minimiser le risque que ce choc sanitaire temporaire ait des effets négatifs durables et importants sur l’économie à moyen terme en causant des défaillances massives des entreprises. Il est impératif de prendre des mesures spécifiques destinées aux entreprises qui étaient en bonne santé financière avant la crise sanitaire pour préserver les chaînes de production et de distribution des biens et services de sorte que ces entreprises puissent reprendre normalement leurs activités une fois le déconfinement est en marche. Ce faisant, on pourrait ainsi espérer une bonne reprise du marché du travail et une préservation des pouvoirs d’achat des salariés dans l’après-crise sanitaire. Plus précisément, les banques centrales devraient prendre des mesures pour inciter les banques à accorder des prêts supplémentaires aux entreprises qui en ont besoin et/ou reporter le remboursement des prêts existants. Bien que de telles mesures soient efficaces, elles ne peuvent pas effacer complètement les effets de la pandémie de Covid-19 sur les défaillances d’entreprises. En effet, cette pandémie, par ses effets importants et complexes sur l’économie, accroît les asymétries d’information entre les banques et les emprunteurs, ce qui incite les banques à devenir plus prudentes dans leurs activités de crédit. En effet, compte tenu des contraintes réglementaires et des principes de gestion de risques, les banques ne peuvent pas prendre le risque d’accorder des crédits à des entreprises qui ont une probabilité élevée de faire faillite dans les mois à venir.
Face à l’urgence de la situation économique, il est tentant pour des responsables politiques de pousser les banques centrales à « lâcher de la monnaie par hélicoptère », ou de façon équivalente, à distribuer un montant monétaire à chaque ménage, ou/et à financer les dépenses publiques supplémentaires via la création monétaire. Ces mesures de politique sont envisageables dans une certaine mesure mais si elles deviennent effectives, il y a un grand risque qu’elles soient utilisées de façon abusive pour des raisons politiques. Les économistes s’accordent sur le fait qu’une banque centrale crédible a un certain pouvoir de créer le revenu de seigneuriage sans faire déraper l’inflation. Il est peu différent dans la crise actuelle que ce revenu de seigneuriage soit donné aux ménages ou utilisé pour financer les déficits budgétaires. Il faut toutefois être conscient que le revenu de seigneuriage pouvant être levé n’est pas si élevé dans beaucoup de pays et qu’un recours excessif à la création monétaire au-delà de la limite supérieure de ce pouvoir est source d’inflation élevée et difficilement contrôlable dans le futur. De plus, la banque centrale peut perdre ce pouvoir si elle l’abuse répétitivement car les agents économiques peuvent abandonner la monnaie nationale au profit des monnaies étrangères et d’autres actifs.
[1] L’expiration au mardi 21 avril du contrat pour livraison en mai sur le marché à terme de New York s’est soldé par une chute du baril de pétrole de WTI (West Texas Intermediate) à –37,63 dollars. Les acheteurs du pétrole à terme ne peuvent pas prendre la livraison du fait de la saturation des capacités de stockage et de l’effondrement de la demande des produits pétroliers, et doivent baisser le prix pour débarrasser leur pétrole acheté à terme.
La pandémie peut-elle ralentir durablement la croissance ?
La pandémie Covid-19 a des effets économiques dévastateurs au niveau mondial. Le FMI estime que l’économie mondiale se contractera de 3% en 2020, avant de rebondir de 5,8% en 2021, dans l’hypothèse d’une évolution bénigne de la pandémie où elle reculerait au second semestre de 2020.[i] On peut envisager trois scénarios pour le lendemain de la crise (graphique) :
- Un scénario de reprise en forme de V, où le PIB rebondit fortement et l’économie retrouve, à la fois le niveau de PIB d’avant la crise et son taux de croissance antérieur. Il s’agit du scénario privilégié à l’heure actuelle par le FMI.
- Un scénario de reprise graduelle en forme de U, où la récession se prolonge, avec des pertes de PIB permanentes, mais la croissance revient à terme vers son rythme antérieur. Ce scénario serait probable si des crises financières (crises bancaires et/ou crises de la dette souveraine) étaient déclenchées par la récession.
- Un scénario de redémarrage en forme de L, caractérisé par un recul permanent du taux de croissance.
Comment cerner les effets de la pandémie sur la croissance à long terme ? La visibilité à présent extrêmement limitée sur la maitrise de la pandémie rend difficile de privilégier un scénario. L’analyse comptable des sources de la croissance (« growth accounting ») constitue, toutefois, un point de départ utile pour cerner l’impact de la pandémie sur la croissance du PIB potentiel.[ii] Elle met l’accent sur trois principaux mécanismes qui pourraient affecter la croissance potentielle :
- La croissance de la « productivité totale des facteurs », entendue comme le degré d’efficacité dans l’utilisation du capital et du travail dans la production ;
- La formation de capital, déterminée par le taux d’investissement de l’économie ;
- La croissance tendancielle de l’emploi et de la formation de capital humain qui, en partie, détermine la productivité du travail.
On envisage, à tour de rôle, des mécanismes à travers lesquels ces sources de croissance potentielle peuvent être affaiblies, laissant ainsi des marques plus profondes au lendemain de la pandémie.
- Ralentissement durable des gains de productivité.
Les progrès dans les transports, l’information et les communications, ainsi que la réduction des obstacles au commerce, ont incité les entreprises à fragmenter leur production au-delà des frontières nationales, favorisant ainsi l’expansion des chaines de valeur mondiales (CVM). Cela leur a permis d’améliorer leur efficacité et de minimiser les coûts. Ainsi, la part des CVM dans les échanges commerciaux mondiaux est-elle passée de 40% en 1990 à presque 55% en 2007.[iii]
La pandémie a provoqué la dislocation des CVM, tout en révélant leurs limites. Les CVM ont introduit des vulnérabilités imprévisibles: lorsqu’un maillon de la chaîne se brise, comme en Chine depuis le début de la pandémie, les fournisseurs et les consommateurs en amont et en aval sont touchés et la chaine de production se brise. Les conséquences peuvent être particulièrement sévères pour la santé publique parce que des nombreuses sociétés pharmaceutiques dépendent fortement d’ingrédients actifs produits en Chine ou dans d’autres pays.[iv] Les CVM sont parfois si opaques, même dans les secteurs régulés comme l’industrie pharmaceutique, qu’il est difficile d’anticiper où des pénuries critiques pourraient émerger.
La crise entrainera une réévaluation de l’insertion stratégique des entreprises dans les CVM. Il en résultera probablement un retour partiel de la production dans les frontières nationales et un recul des CVM, qui était déjà visible depuis la crise financière mondiale.[v] Des règlementations sont également susceptibles de contenir la fragmentation internationale de la production dans les industries-clés pour la santé publique et la sécurité alimentaire.
Les CVM ont pu promouvoir l’efficacité en exploitant les avantages comparatifs des pays non seulement dans différents secteurs, mais aussi à différents stades de production dans les secteurs. Un recul des CVM atténuera ces gains d’efficacité, entrainant un ralentissement de la croissance potentielle.
- Ralentissement durable de la formation de capital.
Les crises profondes entrainent souvent des réductions durables de l’investissement, comme on a pu le constater lors de la crise financière mondiale. Dans les économies avancées, le ratio d’investissement était de 23,3% du PIB en 1990-2007, mais il a reculé à 21,5% en 2008-18, sans rattraper son niveau antérieur. Deux facteurs sont susceptibles de comprimer l’investissement des entreprises après la pandémie.
En premier lieu, les entreprises non financières sont surendettées, ayant profité des faibles taux d’intérêt après la crise financière mondiale. Rien que la dette obligataire des sociétés non financières a atteint 15,6% du PIB mondial en 2019 contre 10,2% en 2008.[vi] De surcroit, le tiers de cette dette a une durée résiduelle de moins de trois ans. La suspension de l’activité économique face à la pandémie accentue le risque d’une crise de solvabilité, ou de liquidité, des entreprises surendettées. Une baisse durable de l’investissement pourrait s’avérer nécessaire comme stratégie de désendettement, surtout dans un contexte d’incertitude quant à l’évolution de la demande.
En second lieu, la crise sanitaire pourrait entrainer une augmentation de l’épargne des ménages et, par conséquent, un affaiblissement de la demande à plus long terme. Cela peut refléter l’incertitude créée par la pandémie, si les ménages réalisent que leur épargne n’est pas suffisante pour confronter des situations d’urgence de ce type. Une augmentation de l’épargne de précaution peut également refléter l’inquiétude face à la destruction massive d’emplois pendant la récession (voir ci-dessous).
La récession causée par la pandémie implique également une augmentation marquée des déficits budgétaires et donc de la dette publique. Une récession de 10% en 2020 amènerait la dette publique à 145% du PIB aux Etats-Unis et 108% dans la zone Euro — alors que la dette atteindrait 163% du PIB en Italie et 125% en France.[vii] Assurer la soutenabilité de la dette implique des mesures d’austérité budgétaire à long terme. La consommation des ménages subira le revers de la baisse durable du revenu disponible en raison de la hausse prévisible de la fiscalité.
Le recul de la consommation, en raison d’une épargne de précaution et de la contraction du revenu disponible, est susceptible d’ entrainer une baisse de l’investissement productif. La formation de capital risquerait donc de s’en trouver durablement ralentie à long terme, contribuant aussi à une réduction de la croissance potentielle.
- Ralentissement durable de l’emploi et de la formation de capital humain.
La récession entrainera une hausse du chômage qui sera d’autant plus forte que la crise sanitaire durera. Le FMI prévoit que le chômage en 2020 atteindra 10,4% dans la zone Euro et les Etats-Unis, contre 7,6% et 3.7% respectivement en 2019.[viii] Les études empiriques démontrent que les hausses du chômage, même si elles sont de nature temporaire, risquent d’entrainer des augmentations du « taux de chômage naturel » à travers des effets d’hystérésis. L’aptitude progressivement réduite d’insertion des chômeurs de longue durée sur le marché du travail en est la cause la plus commune.[ix]
Une augmentation du taux de chômage naturel n’implique pas nécessairement un ralentissement durable de la croissance de l’emploi, qui affecterait directement la croissance du PIB potentiel. Le chômage accru pourrait, toutefois, comprimer davantage la consommation, et donc l’investissement, réduisant ainsi indirectement la croissance potentielle à travers les canaux discutés avant.
L’augmentation du chômage, si elle persiste, peut aussi affecter la croissance potentielle par le biais de la formation de capital humain et de la productivité, notamment des nouveaux entrants au marché du travail. Des travaux empiriques montrent qu’au lendemain de fortes récessions, comme celle de 2008-09, les nouveaux entrants restent au chômage plus longtemps et sont rémunérés moins bien que ce qu’il aurait été attendu en fonction de l’expérience et de l’âge.[x] Des rémunérations plus faibles traduisent une productivité moins élevée, probablement à cause de lacunes d’expérience infligées par des longues périodes de chômage.
- Conclusion
Les mécanismes passés en revue impliquent qu’un « scénario en forme de L » de la sortie de la crise ne saurait pas être écarté. La croissance affaiblie, dans plusieurs pays, suite à la crise financière mondiale de 2008-09, corrobore cette éventualité. Il sera donc nécessaire de gérer judicieusement le soutient à l’activité pendant la crise. Les politiques mises en place devraient améliorer la résilience financière des entreprises ; étaler les relances budgétaires dans le temps, tout en évitant des resserrements précoces comme en 2010-11 ; utiliser des instruments de financement novateurs, comme par exemple la dette conjointe dans la zone euro ; et éviter autant que possible les séparations durables des travailleurs de leurs emplois.
Notes
[i] IMF, World Economic Outlook, April 2020, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
[ii] Pour cette approche voir M. Sidiropoulos et A. Varoudakis, “Macroéconomie en pratique”, Dunod, Paris, 2019, chapitre 5.
[iii] Voir World Bank, “Trading for Development in the Age of Global Value Chains”, 2020, https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2020
[iv] C’est le cas en particulier de l’industrie pharmaceutique aux Etats-Unis : https://www.washingtonpost.com/health/2020/02/26/coronavirus-raises-fears-us-drug-supply-disruptions/
[v] Voir OECD, Trade in Value-Added Indicators, 2018 update, https://www.oecd.org/industry/ind/tiva-2018-flyer.pdf
[vi] OECD, “Corporate Bond Market Trends, Emerging Risks, and Monetary Policy”, 2020, http://www.oecd.org/corporate/ca/Corporate-Bond-Market-Trends-Emerging-Risks-Monetary-Policy.pdf
[vii] Z. Darvas, “The Fiscal Consequences of the Pandemic”, Bruegel, March 30, 2020, https://www.bruegel.org/2020/03/the-fiscal-consequences-of-the-pandemic/
[viii] IMF, World Economic Outlook, April 2020, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
[ix] Voir L.M. Ball, “Hysteresis in Unemployment: Old and New Evidence”, NBER, March 2009, https://www.nber.org/papers/w14818.pdf
[x] Voir B. Eichengreen, “The Human-Capital Costs of the Crisis”, Project Syndicate, April 10, 2020 (https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-pandemic-erosion-of-human-capital-by-barry-eichengreen-2020-04) et J. Rothstein, “The Lost Generation? Scarring after the Great Recession”, Working Paper, UC Berkley, May 2019 (https://eml.berkeley.edu/~jrothst/workingpapers/rothstein_scarring_052019.pdf)
📂 L’intégralité du dossier est disponible en version PDF : Dossier Covid ERMEES